
Petite histoire de la vie associative : place à l’ère de la « cyber-tribu » !
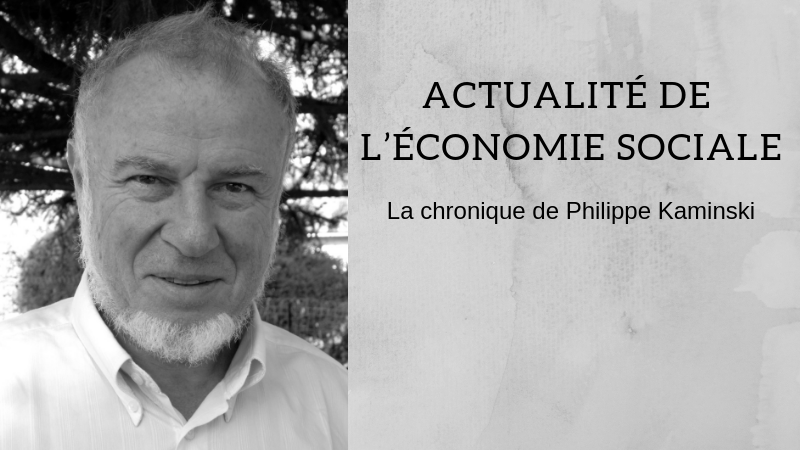
La vie associative est entrée, avec le déploiement des réseaux sociaux, dans une nouvelle ère. Après la plume d’oie, la circulaire et le bulletin, place à la virtualité, comme une réaction de liberté, comme un retour du balancier vers l’ouverture et le papillonnage. Est-ce bien ou mal ? Difficile à dire… Analyse de notre expert.
Tribune libre et hebdomadaire de Philippe Kaminski
Le présent document est une refonte complète d’un texte publié en 2006. J’y exprimais alors l’idée que nous venions d’entrer dans une nouvelle ère de la vie associative, la quatrième. Treize années plus tard, je ne puis que confirmer ce diagnostic. Le déploiement des « réseaux sociaux », survenu durant ce laps de temps et touchant à la fois toutes les couches de la population et tous les pays du monde, a parachevé le basculement vers ce « quart âge » de l’association dont les contours et les traits caractéristiques se précisent peu à peu.
Mais nous manquons de recul pour pouvoir en apprécier toutes les conséquences. Et puis, qui peut anticiper, aujourd’hui, ce que seront devenus les réseaux sociaux dans dix, vingt, ou trente ans ? Nos réflexions sont d’autant plus brouillées que la plupart des gérontes qui nous gouvernent, qu’ils soient gérontes par l’état civil ou par l’esprit, n’ont pas pris la mesure de la mutation et en sont restés, mentalement, au temps de la transmission papier. Du fait de l’allongement de la durée de la vie, du conservatisme des institutions et de l’inertie des textes votés, les lois et règlements adaptés à cette époque révolue continuent de s’appliquer, comme un canard sans tête qui poursuit sa marche. Ceci n’est pas sans poser de réels problèmes !
De quoi parlons-nous ?
Il est important de s’entendre sur les termes que nous utilisons. Par « vie associative », j’entends le mode de vie de ces personnes qui ont choisi de s’engager volontairement dans une aventure collective désintéressée, et non le mode de fonctionnement d’organismes gestionnaires qui, en France, ont adopté le statut juridique de la loi de 1901. Je sais bien qu’entre l’amicale de quartier, qui est au cœur de mon propos, et la vaste organisation au statut associatif mais qui ne compte aucun adhérent, il y a toutes les nuances de l’arc-en-ciel, et qu’il est difficile de tracer une limite précise entre les « vraies » où règne un véritable esprit associatif et les « fausses » qui en sont dépourvues.
Jadis le mot d’association évoquait plutôt l’entreprise, où les associés se regroupent pour produire ou pour vendre, alors que les groupements de personnes réunies autour d’un but non lucratif étaient nommés sociétés, cette racine se retrouvant dans l’expression latine affectio societatis. Les mots ont depuis changé de sens, association et société ayant quelque peu interverti leurs rôles, entraînant maints risques de confusion.
Dans les nomenclatures statistiques d’activités, les associations qui nous intéressent n’ont jamais été définies que négativement, par exclusions successives. On commence par isoler les activités non marchandes, puis on en retire tout ce qui est public ou majoritairement contrôlé par l’État, puis tout ce qui relève des cultes, puis de la politique, puis du syndicalisme. Et on prend ce qui reste.
Pour parler de vie associative, il faut également que d’autres conditions soient réunies ; mais nul n’a pu en dresser un catalogue sans tomber dans un dogmatisme réducteur. Car nous ne sommes pas dans le domaine du droit, encore moins dans celui de la sociométrie, mais plus trivialement dans une sorte de rhétorique sociale, où l’on ne peut dépasser le stade de la ressemblance ou de l’analogie. Retenons simplement qu’il faut, autant dans l’esprit que dans les faits, que l’essentiel des conditions suivantes soit simultanément réuni : liberté pour les membres de quitter le groupe, volonté de recrutement et de formation de nouveaux adhérents, règles internes écrites, enfin gouvernement de type parlementaire. De là naît une sorte d’ingénierie sociale, intelligible dans tous les pays et toutes les cultures, qui façonne des types de comportement que l’on retrouve sous toutes les latitudes.
Voisine des conseils de ville ou de canton, des assemblées de paroisse ou de métiers, ayant aussi quelques traits communs avec les sectes, l’association s’en distingue par la nature de son objet social, qui rassemble sans obliger, et qui donne naissance à un être collectif nouveau, autonome, que les adhérents ont à cœur de porter et de faire fructifier indivis. L’affectio societatis les conduit à rester en relation et à se rencontrer ; il n’y a pas d’association qui tienne sans instrument de liaison ni sans réunions régulières. Autrement dit, la vie associative ne peut exister que dans des groupes d’effectif relativement faible, ou, si le nombre de membres est très important, dans des sections locales.
Pourquoi y-a-t-il eu des périodes successives, bien distinctes, dans l’histoire de la vie associative ? C’est que l’ingénierie sociale de l’association se nourrit de la technologie ambiante et de son économie. Lorsque les moyens nécessaires à la mise en relation des membres et à la tenue de leurs réunions font place à de nouvelles techniques accessibles à un coût raisonnable, il peut s’ensuivre que les conditions d’exercice de la vie associative changent du tout au tout, et que l’association elle-même change profondément de nature.
Première ère associative : la plume d’oie
Je ne prétendrais pas dater les origines de la vie associative ; certains les attribuent à la Réforme, d’autres remontent plus loin encore. Toujours est-il qu’au XVIIIe siècle, la France est couverte de sociétés savantes, de sociétés de pensée et de salons littéraires. On a coutume de dire que la loi Le Chapelier et la police de Fouché ont brutalement interrompu ce processus, si bien qu’un demi-siècle plus tard Toqueville décrira la France, comparée en cela à l’Amérique, comme un désert associatif. J’aimerais disposer d’éléments quantitatifs pour discuter de cette hypothèse ; mais je suis enclin à croire que l’on fait une trop belle part à l’influence du jacobinisme et que le reflux de l’association en Europe n’a duré que le temps des guerres napoléoniennes et de la grave crise économique qui les a suivies. Les mouvements de 1848, sensibles à travers tout le continent, révèlent au contraire une renaissance vigoureuse et omniprésente du fait associatif.
Quoi qu’il en soit, il n’était pas aisé de s’associer, que ce soit en 1780 ou en 1830. Il était difficile de réunir des personnes de villes différentes, car les transports étaient rares, lents et chers. Il était difficile de communiquer, car le papier était cher, le port du courrier également. De toutes façons, il fallait savoir écrire et en avoir le goût ; cela ne pouvait donc concerner qu’une petite élite. La fabrication du papier à partir de bois et non plus de chiffon, à partir de 1820, et la révolution des transports par le chemin de fer et le bateau à vapeur, à partir de 1850, ne vont pas significativement modifier les conditions d’existence de l’association. Les réunions ne pouvaient être que très locales, et orales.
J’appellerai cette époque de précurseurs celle « de la plume d’oie ».
Le coup d’envoi de la mutation vers la seconde ère associative fut donné en Grande Bretagne, le 1er octobre 1870. Ce jour-là, les Postes britanniques créent un tarif réduit de moitié pour les journaux, circulaires et cartes postales. Par circulaire, il faut entendre un pli ouvert, en général préimprimé, complété à la main et envoyé en nombre. Quant à la carte postale, une innovation née un an plus tôt en Autriche, il ne s’agissait alors que d’un petit imprimé officiel en carton, vendu par la Poste, dont une face était réservée à l’adresse et l’autre au texte.
Deuxième ère associative : la circulaire
Puissance économique dominante, l’Angleterre devient en fin 1870, après la défaite de la France face à la Prusse, l’unique superpuissance du globe. La simple division par deux du tarif postal de base va y provoquer en peu d’années une explosion du trafic : publicité, vente par correspondance, petites annonces, et bien sûr vie associative, vont connaître un développement fulgurant qui se propagera progressivement au continent. Parallèlement, les déplacements urbains deviennent beaucoup plus faciles, grâce à l’éclairage des rues au gaz et au développement des omnibus. Il devient désormais possible au plus grand nombre de « sortir le soir » et les réunions associatives vont se multiplier.
Les papetiers vont fabriquer et vendre des carnets à souche préimprimés pour les réunions des sociétés : il suffit d’y compléter à la plume le lieu et la date, de plier, d’écrire l’adresse et de timbrer. Tous les domaines sont concernés par cette frénésie de réunions : charité, éducation, tempérance, sports et jeux, fêtes et bals, arts et sciences, histoire naturelle, tourisme, collections… La France suivra avec un décalage d’environ vingt ans, et c’est dans les années 1890 que vont s’y créer les premiers réseaux associatifs structurés.
Ce second âge de la vie associative, que j’appellerai celui « de la circulaire », durera en gros jusqu’aux années 1960, c’est à dire tant que la voiture, le téléphone, la télévision et les grandes surfaces n’auront pas pris la première place dans nos modes de vie, tant que la domination du courrier postal, du chemin de fer, du petit commerce et de la presse écrite ne sera pas menacée.
Troisième ère : le bulletin
Lorsque cela survient, nous sommes dans la seconde moitié des « trente glorieuses », et de nombreux changements de société accompagnent ces mutations technologiques : développement progressif de l’individualisme, réduction de la famille à sa dimension nucléaire, retrait rapide de l’encadrement social assuré jusqu’alors, chacun de son côté, par l’Église catholique et le Parti communiste… Tout cela constituera le bouillon de culture dans lequel va se développer, à une vitesse foudroyante, un nouveau modèle associatif qui sera théorisé vers la fin des années 1970.
Mais le véritable déclencheur de la seconde mutation de la vie associative est à l’œuvre depuis de nombreuses années déjà. Il a déjà détrôné la circulaire, ou du moins en a changé la nature, lui apportant du texte pouvant couvrir plusieurs pages : c’est la ronéo, qui fera ensuite place à la photocopieuse.
Le duplicateur à alcool était connu depuis très longtemps ; mais ses médiocres performances n’ont jamais pu être améliorées, et son utilisation est restée confidentielle. En revanche, la ronéo dont la diffusion se fait au cours des années 1950 permet d’emblée à la plus petite des associations de dupliquer, à un coût modique, de véritables textes et donc d’envoyer à ses membres un véritable bulletin. Ce qui était annuel et limité aux associations riches devient mensuel et à la portée de tous. Nous sommes entrés dans une ingénierie sociale toute différente : c’est le troisième âge, celui « du bulletin ».
Pour celles et ceux qui ont manipulé une ronéo, quelle nostalgie ! Ces soirées interminables, passées à cogner comme un sourd sur la vieille machine à écrire pour bien percer le stencil, puis à tourner la manivelle, se faire gicler des flots d’encre grasse sur les doigts et les vêtements, retirer des paquets de feuilles d’un affreux papier buvard coincées en nombre entre les cylindres, puis assembler ces pages toutes plus ou moins tachées, plus ou moins imprimées de guingois… les voilà, les heures héroïques de la vie associative, les authentiques souvenirs du front !
Technologie et Sociologie
À son tour, l’ère du bulletin s’achève. Comment appeler celle qui prend forme sous nos yeux ? L’ère de « la cyber-tribu » ? Je ne sais ; mais on en sent bien les contours, car la transmission électronique a fait exploser le biotope favorable à la survie du bulletin.
Chaque mutation a provoqué un mouvement de balancier, un déplacement des frontières, entre l’association et son milieu environnant. La plume d’oie, ultra élitiste, élevait une barrière nette entre ceux qui savaient la manier et les autres ; c’était la « gentry » des clubs anglais, dotée d’un rituel d’adhésion très exigeant, conférant une appartenance forte.
À l’inverse, la circulaire ouvre sur un plus large public. Elle permet de s’étendre, de recruter ; l’idée conductrice n’est plus de sélectionner chez les pairs, mais d’accueillir, pour former et émanciper, puis de favoriser l’essaimage. L’admission perd sa valeur initiatique ; le cercle des membres se double d’une auréole aux contours variables, formée des amis des membres, des occasionnels : ce sont les « sympathisants », qui ne sont là que pour les grandes occasions, mais qui font le nombre, le succès, la visibilité de l’association.
Le bulletin marque au contraire un retour vers la fermeture. Il n’a plus la logique de la circulaire, car il coûte cher à fabriquer. Même s’il reste très artisanal, c’est déjà une industrie, avec ses contraintes. Il faut du temps et de l’organisation. Il faut payer le papier, l’encre, la machine, le local… ou utiliser les installations d’une entreprise, d’une école, d’un syndicat, plus ou moins officiellement, plus ou moins clandestinement. Il faut donc des cotisations pour financer les dépenses, il faut une adhésion formelle pour manifester sa complicité avec l’appareil qui produit le bulletin. De là découle la nécessité de dessiner et de défendre des frontières ; on apprend vite à exclure, à scissionner, à excommunier.
La nature même du bulletin va bien dans ce sens ; on a la place d’écrire, de théoriser, d’y figer sa pensée. L’ère du bulletin est celle des appartenances exacerbées ; l’association devient le pouvoir du pauvre, et pour nombre de Présidents ou de simples militants, le déversoir de leur ego, la compensation de leurs frustrations personnelles ou professionnelles.
La cyber-tribu nous apparaît dès lors comme une réaction de liberté face à cette oppression du bulletin, comme un retour du balancier vers l’ouverture et le papillonnage.
Sur la Toile, on peut accéder à tout, sans payer de cotisation, on peut en sortir et y revenir librement, ne pas avoir à adhérer formellement, à s’engager ; on s’y constitue un univers de relations par affinités aux contours imprécis et sans cesse redessinés. On prend le temps de l’essai, de l’observation. Cela ne se traduit pas par une diminution du volume des activités ; mais celles-ci sont le fruit de coalitions de circonstance, non d’équipes stables et labellisées.
Je ne sais si c’est un bien ou un mal. Les choses trouveront peu à peu un équilibre que nous ne situons pas encore très bien aujourd’hui. Ce qui est certain, c’est que le discours associatif écrit à la fin des années 1970 apparaîtra de plus en plus décalé.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
- La scolarisation des filles en Afrique : la robe et les chansons (13/05)
- Experts, scientifiques, charlatans et bonimenteurs (II) (06/05)
- Experts, scientifiques, charlatans et bonimenteurs (I) (29/04)
- Cette Dame qu’on veut Nôtre (22/04)
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, notamment en lien avec l’ESS.

































