
« Ombre (Eurydice parle) » d’Elfriede Jelinek : anéantissement mythique

Les éditions de l’Arche viennent de publier une traduction française, signée Sophie Andrée Herr, de Schatten (Eurydike sagt), paru en Allemagne en 2013 : Ombre (Eurydice parle). Nous y retrouvons toute la rage, les pulsions destructrices et la haine mortelle de l’écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek.
Ouvrir une œuvre d’Elfriede Jelinek, c’est accepter de recevoir à la face un interminable et violent vomissement de mots dévastateurs, sordides. Elfriede Jelinek le sait ; Elfriede Jelinek le souhaite. Elle invoque une ironie sous-jacente que l’on peine, dans la crudité d’un langage imprégné par la haine de l’autre, de tout autre, à percevoir.
Il y a cette langue, puissante, si drue, aussi fascinante qu’écœurante. Nous la savions écrivaine, bien avant que le prix Nobel vienne couronner sa carrière en 2004, bien avant que le théâtre national de Strasbourg renomme une salle à son nom, le mois dernier. Ses incantations déprédatrices n’épargnent personne, fusant d’un seul trait, naturelles – comme si elle n’éprouvait nul besoin de se relire, ni de se corriger. La traductrice a fort à faire pour traduire ses sons, ce flux, ces mots expulsés de la colère furieuse ; elle y parvient non sans talent mais ne peut empêcher le lecteur de se perdre dans ce torrent de fiel.
De l’ombre naît la parole
Il faut du courage pour publier un tel texte ; les éditions de l’Arche, nous le savons, n’en manquent pas. Rarement violence n’a éclaté avec une telle pornographie, au sens étymologique de ce terme. Nous connaissions et admirions la vertigineuse violence ontologique, inscrite dans le fer de la vie faite langue, du poète et peintre Nicolas Rozier. Nous découvrons l’impétuosité psychologique sans abîme, le grincement d’ongles dans la pénombre, d’Elfriede Jelinek. Dans sa pièce, violence et sexualité s’étreignent en une ruée de coups dissolvants.
Ombre (Eurydice parle) est la reprise d’une thématique bien connue des lecteurs d’Elfriede Jelinek, celle de la dissolution de soi, appliquée à un mythe non moins connu : Orphée et Eurydice. L’auteure n’envisage le monde que sous des rapports de domination, à l’image de ceux qui régnèrent entre ses parents et dont – de son propre aveu, lors d’un entretien avec Nicole Bary – elle ne se remit jamais totalement. La seule échappatoire consiste à disparaître, à devenir « ombre ».
Elfriede Jelinek applique curieusement ce rapport de domination à Orphée et Eurydice, celle-ci devenant – sous le prisme contemporain d’un certain féminisme systématique – la victime « de l’injonction patriarcale du mythe », qui dépossèderait les femmes d’elles-mêmes. « N’a-t-elle pas son mot à dire, Eurydice ? Elle parle enfin », écrit l’éditeur sur sa quatrième de couverture, avant de préciser dans son introduction : « Elfriede Jelinek donne libre cours à cette voix féminine longtemps restée dans l’ombre. »
C’est précisément de cette ombre – personnelle, totale – que la parole naît. L’histoire actualisée de ce mythe antique situe Eurydice en acheteuse compulsive moderne, dont le mari, Orphée, est une rock star harcelée – victime consentante – de groupies quasi prépubères au sexe généreusement ouvert, béance en rut composée d’excitation, de sueur et de foutre. Mordue par le serpent de la peur, Eurydice s’enfonce dans l’ombre, devient ombre, échappant enfin au contrôle de celui qui a fait d’elle son objet obsessionnel, jusqu’à venir la rechercher dans cet état d’apaisante déperdition charnelle.
Perception remarquable du processus de chosification
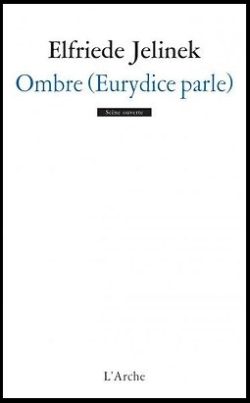 Il est fascinant de constater combien certains passages résonnent avec l’actualité, les actualités : « Il ne me laissera pas en rester là. Ce n’est pas lui qui m’a faite, mais il ne me laissera pas ne pas être. Il voudra me fourrer à nouveau dans mon être, je vois la chose venir. » (p. 23) Comment ne pas penser à toutes ces personnes, notamment au philosophe Louis Althusser, dont nous avons récemment commémoré le centenaire, qui détruisent et tuent à l’heure de la séparation, parce que celle-ci leur apparaît précisément intolérable ?
Il est fascinant de constater combien certains passages résonnent avec l’actualité, les actualités : « Il ne me laissera pas en rester là. Ce n’est pas lui qui m’a faite, mais il ne me laissera pas ne pas être. Il voudra me fourrer à nouveau dans mon être, je vois la chose venir. » (p. 23) Comment ne pas penser à toutes ces personnes, notamment au philosophe Louis Althusser, dont nous avons récemment commémoré le centenaire, qui détruisent et tuent à l’heure de la séparation, parce que celle-ci leur apparaît précisément intolérable ?
Elfriede Jelinek décrit avec justesse ce processus d’appropriation, de chosification de l’autre – être prétendument aimé – jusque dans l’acte créatif : la disparition d’Eurydice ne devient-elle pas un exutoire inventif pour l’art musical ? La douleur de la perte est dès lors perçue comme première sur la douleur de celui qui est perdu. Gloire aux vivants qui peuvent encore vampiriser ceux qui les entourent afin de nourrir leur souffrance indispensable à leur survie !
L’écrivaine connaît bien ce prisme psychologique qui anéantit toute possibilité d’altérité, qui empêche de reconnaître à l’autre une égale dignité. La logique d’une fuite par la disparition, qu’elle traduit autant par la dématérialisation de ses textes (publication sur internet) que par le fait de rester cloîtrée dans son appartement (en raison, dit-elle, d’une agoraphobie), s’impose comme la conséquence inévitable d’une lutte, non plus seulement des classes, mais inhérente à toute relation humaine. Ce qui ne l’empêche pas, par ailleurs, de continuer à s’exprimer et à publier, signe qu’elle ne s’embarrasse étrangement pas d’une éventuelle dichotomie entre disparition et surexposition – une apparente contradiction qui n’est pas sans rappeler Emil Cioran.
De la lutte des classes au combat de tous contre tous
Nous ne trahissons aucun secret en écrivant qu’Elfriede Jelinek est excessive, jusqu’à poser certains actes sulfureux, aux conséquences parfois terrifiantes. Son soutien au meurtrier Jack Unterweger a connu un retentissement certain, y compris en France, mais il reste d’ordre “personnel”. Sur le plan plus littéraire, c’est davantage son choix extrême du communisme contre d’éventuelles résurgences fascistes qui pose question. Le rejet d’une dictature passe-t-il par l’adhésion à une autre, également terrifiante ? Elle prit ainsi sa carte au parti communiste autrichien (KPÖ) entre 1974 et 1991, après que les terribles purges staliniennes eurent été dévoilées et alors que Léonid Brejnev – « Staline le petit », pour paraphraser Victor Hugo – était au pouvoir en URSS. Le dictateur russe avait déjà commencé à réhabiliter le « Grand Guide des peuples » et avait notamment réprimé, six ans plus tôt, le Printemps de Prague et toute possibilité de liberté d’expression, entraînant le départ progressif de nombre d’écrivains et intellectuels tchèques – à commencer par Milan Kundera en 1975.
Qu’est-ce qui peut ainsi pousser Elfriede Jelinek à ne considérer le monde et toute relation humaine que sous le prisme de l’opposition et du pouvoir, poussé à l’extrême ? D’où lui vient une telle colère, une telle rage dans l’écriture ? Beaucoup se sont risqués à des explications. Bottons en touche et constatons simplement que, à raisonner comme elle, il n’y a alors que la servitude ou l’annihilation (nous ne parlons évidemment pas ici des purges communistes), le silence rampant ou l’expression de la haine.
Une fois compris le prisme dans lequel Elfriede Jelinek circonscrit ses personnages, et par conséquent le mythe, une fois perçue la valeur de cette langue qui boucle jusqu’à l’overdose, que reste-t-il ? Le sentiment d’une injustice profonde pour ce pauvre Orphée qui n’en méritait pas tant. Il y a dans l’interprétation psychologique une faiblesse, qu’on pourrait qualifier de partialité, au sens où elle ne nous donne pas de contempler les réalités à une bonne hauteur – ce qu’elle voit et conçoit ne manque pas de justesse, mais ce n’est qu’un membre dans un corps qui le déborde de toutes parts. Plus encore, l’appréhension par la psychologie dépend moins de l’objet contemplé que de la capacité de l’analyste. Elfriede Jelinek nous inflige en conclusion du présent texte de lire « absolument tout » de Sigmund Freud, « ça vous apprendra ». Derrière la pointe d’humour se cache (à peine) une réalité évidente : l’œuvre dont elle se sert ironiquement est celle du père de la psychanalyse, et non de tout autre. Les références à Adelbert von Chamisso et à Ovide, évidentes pour qui a lu le texte de l’écrivaine (pourvu que l’on connaisse Peter Schlemihl et la mythologie), ne suffisent pas à offrir un réel contrepoids.
Tout est psychologique !
L’enfermement dans un prisme unique interroge. Si la condamnation du chanteur peut sembler évidente, en raison de la chosification de l’être aimé (« il a dû m’accorder à sa tessiture, ce n’était pas la mienne ») ou de ses aventures avec des « taquineuses de minou », nous peinons à adhérer à ce combat si propre à notre temps en ce qu’il consiste perpétuellement à s’en prendre à l’autre pour ne pas avoir à s’affronter soi-même – une variante, en somme, du triptyque “victime / bourreau / juge” que nous évoquions dans Points de non-retour [Thiaroye] d’Alexandra Badea, sauf qu’il n’est plus question ici de juge, Elfriede Jelinek n’endossant pas tout à fait (et heureusement) le rôle.
On pourrait rétorquer avec Honoré de Balzac : « Nous sommes habitués à juger les autres d’après nous, et si nous les absolvons complaisamment de nos défauts, nous les condamnons sévèrement de ne pas avoir nos qualités. » Ou encore, plus explicitement, avec Jules Renard : « Quand on peut voir si nettement les défauts des autres, c’est qu’on les a. »
Elfriede Jelinek plaque sur « le chanteur » le parfait déroulé psychologique du prisme adopté ; il n’existe aucun espace de respiration. Tout est psychologique, enfermé, déjà mort. Eurydice sait toujours ce que son chanteur pense, éprouve, va faire… Il n’a donc pas voix au chapitre ; il n’est d’ailleurs même pas nommé. Il est le chanteur-mâle-dominant, celui d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il est celui qui empêche la femme de passer de l’état d’objet à celui de sujet. Il est l’objet de toutes les projections de la femme en voie de disparition, d’un pur discours de celle qui se pense alors comme « l’inconscient », alors même que, dans un mouvement radicalement contradictoire, elle ne cesse de poser des jugements sur ce qui l’entoure – c’est à se demander quelle définition l’auteure a du mot « conscience », si elle le dissocie ainsi de la faculté de tout jugement moral (que son personnage assène jusqu’à l’excès). L’homme, in fine, n’est pas un personnage mais une idée, et une idée repoussoir, l’auteure, dans une démarche volontaire mais peu honnête car dissimulée, ne conférant la dignité de personnage qu’à Eurydice.
Questions (obsessionnelles) autour de la reprise du mythe
Orphée est donc réduit à la seule titulature de chanteur. Eurydice existerait parce que l’écrivaine la fait vivre aujourd’hui quand elle a été réduite au silence par le passé. Qui dit « femme sans parole » dit évidemment, pour notre époque, « récit patriarcal ». Évidemment. Et qu’importe cette mythologie qui regorge de figures féminines essentielles telles qu’Antigone ou Phèdre ! Il y aurait beaucoup à discuter autour de ce point, mais l’auteur de cette critique étant lui-même un homme, il n’a ipso facto pas voix au chapitre – pour un temps indéterminé.
Restons donc sur le plan littéraire et mythologique. Tout mythe est évidemment susceptible d’être repris, compris et interprété à l’aune de son temps. Dans notre critique de Médée black de Michel Azama, nous évoquions deux approches du mythe : la première, conventionnelle, consiste à repartir du mythe antique afin de lui donner des consonances contemporaines ; la seconde, plus récente, consiste à affubler de noms antiques des « héros » résolument actuels. Selon cette classification nécessairement schématique, l’Eurydice d’Elfriede Jelinek se situe davantage dans la seconde catégorie, bien que l’intrigue semble suivre le récit ancestral, de la piqûre du serpent à la recherche d’Orphée au pays des ombres.
L’Eurydice présente est tellement prisonnière de la compréhension qu’en a Elfriede Jelinek que nous peinons à voir le moindre lien avec celle antique. À aucun moment le mythe n’oppose Orphée à Eurydice, selon la dialectique étriquée de la lutte des sexes, de ce combat de tous contre tous. Ce qui frappe au terme de notre lecture est précisément la grandeur du mythe fondateur, qui échappe à toute vision rétrécie, bridée, univoque et absolutisée. S’il était bien la figure centrale, ce qu’on peut éventuellement déplorer sans procéder à un divorce belliqueux, Orphée ne s’est jamais construit en conflit avec Eurydice.
Martèlement d’idées ou exploration du drame humain
Cette réappropriation volontairement outrancière des mythes (et nous supposons qu’Elfriede Jelinek elle-même pourrait revendiquer fièrement cette outrance), et plus généralement de toute œuvre du passé, n’est pas sans épuiser le lecteur-spectateur contemporain. Pascal Adam s’en est fait l’écho en commençant par citer une phrase, terrifiante selon nous, de Marceau Deschamps-Ségura : « Le fait de reprendre des textes du passé véhicule et maintient un état de fait – notamment raciste et sexiste – qui est problématique et dont il faut se détacher au plus vite. » Elfriede Jelinek ne fait pas autre chose en distordant à ce point et à son compte le mythe antique. D’aucuns lui donneront raison.
Au fond, le prétexte du mythe sert davantage aujourd’hui au martèlement d’idées, les siennes bien entendu, impérieuses et souveraines, sous couvert de politique, plus qu’à l’exploration du drame humain, existentiel, vertigineux, complexe universel, donc humble. Il faut relire et méditer les mots de T.S. Eliot, cités par Pascal Adam et que nous reproduisons en partie, confiant au lecteur le soin d’aller lire la citation en son entier : « Au théâtre, nous sommes, depuis plusieurs générations, sous la domination du “drame d’idées”. […] Me rappelant la remarque de Mallarmé — que la poésie est faite, non pas d’idées, mais de mots —, je suis tenté de suggérer que le drame est fait non pas d’idées, mais d’êtres humains. »
Et puisque Pascal Adam sert de point focal en cette ultime partie de l’article, citons ce qu’il écrit, dans une autre chronique dont il a le secret, au sujet de la réduction des arts passés à notre seule compréhension nombriliste : « Nous ne voulons plus que parler de notre époque, nous ne voulons plus parler que de nous. C’est un nombrilisme géant. Nous ne faisons, sous couvert d’ouverture, que toujours réduire l’écart. Le fait passe même inaperçu, ou presque, que les grands auteurs du passé ne traitaient presque jamais frontalement leur époque, et qu’ils cherchaient l’écart. Par la fable, la métaphore. Nous sommes bien plus malins : en supprimant l’écart, nous rabattons sur nous le passé, nous supprimons le passé. Qu’il est doux d’être un grand créateur, et tous ensemble nous avons raison tout seul. Nous supprimons la différence, mais en gueulant que rien autant qu’elle ne nous importe. C’est à n’en pas douter un coup de génie. D’ailleurs, nous sommes des génies. C’est certain. »
La talent littéraire d’Elfriede Jelinek n’est plus à prouver, d’autres l’ayant couronnée jusque dans les hautes sphères. Pourquoi fallait-il que sa rage s’exprime en une application systématique, exiguë et haineuse d’une idée fixe à l’épaisse et riche réalité humaine, passée et présente, universelle ? Certains y verront un engagement féministe ; nous y percevons l’anéantissement de tout humanisme.
.
Elfriede JELINEK, Ombre (Eurydice parle), L’Arche, 2018, 120 p., 14 €.
.


































Rétroliens/Pingbacks