
“Matières fermées” de William Cliff : une humble et précieuse écriture

Le dernier recueil du poète belge William Cliff est un seul et même poème, comme une longue promenade en compagnie d’un ami intime. Dans une langue à la fois précieuse et populaire, Matières fermées raconte le déploiement de la souffrance, imprégnée d’une dimension fraternelle et mystique. Un livre élégamment précaire, puissamment sombre, qui sait aussi remonter en enfance. Une « confidence universelle ».
Une version abrégée de cette critique a paru dans le numéro 46 de la revue Nunc, d’automne 2018,
consacré à Pascal Quignard, Philip K. Dick et Goudji.
Lire un poème de William Cliff, poète belge de langue française, c’est un peu comme faire avec un ami une longue promenade au cours de laquelle l’on se confie plus aisément, une longue déambulation qui n’a d’autre but que de durer assez pour laisser à l’intime le temps de se livrer se dévoiler. Et prendre le temps qu’il faut pour approcher le cœur de l’être, pour, de périphérie en périphérie, gagner chacun le centre de l’autre et de soi.
Matières fermées, qui est bien un seul poème (de 248 pages et de 217 sonnets ou « quasi-sonnets » répartis en 8 « liasses »), recherche et atteint de nouveau ce but. Fait de récits de voyages plus modestes (les récits et les voyages) que ceux (les voyages) plus lointains auxquels William Cliff avait habitué le lecteur, traversé de bulletins de santé et même de séjours à l’hôpital, parcouru des douleurs et trésors de l’enfance gembloutoise, des émerveillements et des rencontres décisives (celle en particulier du poète catalan Gabriel Ferrater), il est tout entier une confidence et un partage, disant la joie comme la souffrance, pour ne pas faire mentir la vie qui les recèle toutes deux, semble toutes deux les aimer.
L’amitié ne se nourrit-elle pas des détresses et déboires partagés ? Ne sort-elle pas grandie des joies et enthousiasmes échangés, de l’étonnement (de la stupeur même) confié devant l’irréductible beauté du monde ?
Partir de soi
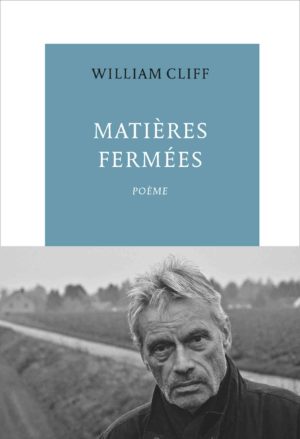 Le début du long poème de William Cliff rappelle singulièrement celui des Rêveries du promeneur solitaire. Inaugurant sa première promenade, Rousseau écrit : « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même ». William Cliff écrit quant à lui : « Me voilà déjeté, misérable séquelle, / méprisé, conspué, honni de tout le monde » (sonnet 1*). Pourtant, le livre de W. Cliff n’est ni un plaidoyer pro domo ni une longue lamentation. Si l’auteur en effet livre ses douleurs (nombreuses) et ses joies (plus rares), c’est qu’elles lui font rejoindre et ressentir celles de tous ceux qu’il croise suffisamment longtemps pour partager leur sort. Car le poète est finalement plus encombré de soi que des autres : « La réitération de moi-même me pèse » (149*).
Le début du long poème de William Cliff rappelle singulièrement celui des Rêveries du promeneur solitaire. Inaugurant sa première promenade, Rousseau écrit : « Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même ». William Cliff écrit quant à lui : « Me voilà déjeté, misérable séquelle, / méprisé, conspué, honni de tout le monde » (sonnet 1*). Pourtant, le livre de W. Cliff n’est ni un plaidoyer pro domo ni une longue lamentation. Si l’auteur en effet livre ses douleurs (nombreuses) et ses joies (plus rares), c’est qu’elles lui font rejoindre et ressentir celles de tous ceux qu’il croise suffisamment longtemps pour partager leur sort. Car le poète est finalement plus encombré de soi que des autres : « La réitération de moi-même me pèse » (149*).
Mais bien qu’il soit sans complaisance pour « ce je haïssable et beaucoup prostré » (sonnet 31), pour tout ce qui relève de « moi-même » (car au bout de moi-même il n’y a que même et jamais rien de nouveau), le poète constate :
« ‘La vie réelle de l’homme gît en lui-même.’
a écrit Senancour, et n’a-t-il pas raison ?
ne nous faut-il pas être à nous-même un poème ?
Malgré tous les détours de la situation ? » (86)
Cette subjectivité là, loin d’être un épanchement narcissique, une manifestation d’orgueil, correspond simplement à la vérité de la personne, à la vérité de la vie et c’est peut-être la mission de la poésie que de dire, avec les armes et l’émotion qui lui sont propres, cette vérité :
« Les contrariétés qui pèsent sur la vie,
les traverses qui blessent, les forces du mal,
nous essayons d’en guérir par la poésie
que nous écrivons pied à pied tant bien que mal.
Pied à pied nous marchons dans le vers du poème,
et c’est à chaque fois comme s’il nous aidait
à graver la vérité de la vie quand même
elle nous fait trembler dans ce que l’on était » (143)
La solitude certes est dite sans ambages, avec ce ton sincère et cru qui caractérise la poésie de William Cliff et que l’on trouve aussi chez d’autres comme Georges Haldas. Le poète genevois écrit ainsi dans Sans feu ni lieu :
« Où je vis nul n’habite
et nul ne peut répondre
aux questions que je pose
La ville est étrangère
et le fleuve des yeux
se perd dans le brouillard
Tout le sel disparaît
Les fontaines les gares
ont perdu leur secret
La rencontre se fait
de moins en moins probable
Et nos regards eux-mêmes
se remplissent de sable »
Mais qui est seul et pauvre reçoit, s’il accepte ce don, des yeux pour voir la solitude et la pauvreté de ceux qu’il croise, pour la voir et la partager. Si bien que W. Cliff, s’il est souvent seul, sait bien dire et faire aimer la solitude de ce voisin qui, comme lui, veille dans la nuit :
« Oh ! quelle avidité il a dans le regard !
C’est qu’il se sent si seul dans la nuit désolée !
et de voir quelqu’un d’autre qui veille si tard
verse quelque douceur dans son âme éveillée. » (79).
Matières fermées le dit bien : il faut partir de soi, et ce mouvement est à la fois inaugural et final. Prendre d’abord pied sur cette terre qu’est soi, faire qu’elle ne mente pas, pour aller ensuite à la rencontre d’autres terres, d’autres sois. Mais qui n’a pas labouré sa terre ne peut goûter celle des autres.
La vie la voix des pauvres gens
Avec souvent ces « mots des pauvres gens » que chantait Ferré (« Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid »), Matières fermées amène jusqu’à la lumière du poème la vie usée, vaincue de ceux qui sont familiers de la douleur. Il y a comme une sorte de recueillement du poète devant ces vies brisées.
Ainsi, il y a cette mère dont le fils s’est suicidé :
« Quant à sa femme elle est tout à fait effondrée
que son fils enivré se soit donné la mort,
dont elle est rentrée chez son mari habiter
ne pouvant plus porter toute seule son sort.
Elle qui était jadis si autoritaire,
comme un petit enfant à présent ne sait faire
qu’ouvrir la bouche pour recevoir la becquée » (82).
Il y a aussi cet homme qui a eu un « burned out » :
« ‘Il a eu un burned out’. Voilà que tout s’explique
sauf ce qu’il porte en lui et qui est sans réplique. » (89).
Il y a cette femme espagnole enfin qui faisait la vaisselle dans un restaurant parisien fréquenté par le poète du temps de sa jeunesse :
« À ses mains elle avait des gants de caoutchouc
d’un rose pâle qui ne valaient pas trois sous
[…] Alors on mesurait cette immense détresse
que certains êtres doivent prendre dans leurs flancs
quand la bêtise humaine affreusement les blesse
comme elle fait avec tant de pauvres enfants… » (133 et 134).
« Le monde est une souffrance déployée », écrit Michel Houellebecq dans Rester vivant : le long poème qu’est Matières fermées fait voir ce déploiement, en lui donnant cependant une dimension, une valeur fraternelles et mystiques qui montrent que W. Cliff a gardé de son éducation catholique ce qui est peut-être l’essentiel : l’« option préférentielle pour les pauvres » et la configuration au Christ. Ainsi écrit-il, durant la Semaine sainte :
« Aujourd’hui trente mars de ‘peineuse semaine’,
je pense à Jésus sur son gibet de douleur,
je pense à tous ces pauvres que la mort entraîne
malgré qu’ils soient si jeunes dans la profondeur… » (87).
Car certains sont trop pauvres pour refuser le secours que Dieu leur promet :
« En ce jeudi saint de la ‘peineuse semaine’,
ne sachant que faire sous un ciel bruineux,
j’entrai à Saint-Médard pour y asseoir ma peine
et l’abriter un peu de ce temps cafardeux.
[…] observant doucement un homme à grise mine
[…] oh ! qu’il restait longtemps dans la pâle lumière
qui tombait des vitraux de l’église impassible !
on le sentait privé de celle qui naguère
accompagnait encor sa vie dans cette ville… » (92).
C’est ainsi que le poète, se reconnaissant pauvre, se reconnaît fils :
« Pauvre Maman ! oh ! si patiente et courageuse !
[…] tu as prié pour nous malgré notre incroyance
et demandé à Dieu un peu de sa clémence
pour que nous arrivions enfin à bonne escale. » (208).
Et encore :
« Eh bien ! soyez bénis, vous mon père et ma mère
qui m’avez jeté dans ce pays de malheur
[…] Me voilà écrivant, misérable poète,
grâce à vous, oui j’écris ces vers alexandrins
par lesquels je voudrais déjouer ma défaite
sous le poids de ce soir qui me crève les reins » (216).
La langue de William Cliff
C’est une langue à la fois précieuse et populaire que celle de W. Cliff. On y rencontre des termes rares issus peut-être des conversations que les enfants avaient avec leur mère : « Ainsi par notre mère nous avions parfois / des mots extraordinaires que nous proférions / ingénument avec notre accent gembloutois » (23). Quant au père, il est dit de lui qu’il « avait prégné sa femme en lui faisant l’amour » (21).
Mais cette préciosité fraie avec toute la trivialité du quotidien, avec tout ce qui fait une vie ordinaire (le ton de W. Cliff rappelle parfois celui de Georges Perros) :
« Las ! mon frère en hiver il n’y a rien à faire !
il faut bien se nourrir avec ce que l’on a,
par exemple un vieux chou qui empue l’atmosphère
malgré les ingrédients que l’on y ajouta. » (29).
Cela n’enlève rien à l’unité du long poème qu’est Matières fermées, unité qui se manifeste parfois par la poursuite d’une même phrase d’un sonnet à l’autre. Ce vaste déploiement semble être le seul vêtement dans lequel le poète puisse faire entrer l’ensemble de sa vie, avec toutes ses polarités contradictoires (préciosité et grossièreté – ce second terme n’étant pas à prendre en mauvaise part ; solitude et fraternité ; désespoir et foi).
La forme « française » choisie par W. Cliff (des sonnets ou quasi-sonnets – car la succession de deux quatrains et deux tercets n’est pas toujours respectée), la régularité de l’alexandrin, semblent la forme et l’armature (le tuteur) qui seules permettent de faire tenir ensemble cette coexistence de la déliquescence et de la joie. Et elles impriment ce rythme de la marche, de la déambulation que nous évoquions plus haut :
« Et ne lui faut-il pas marquer avec le rythme
la danse de la langue que l’on aime entendre ?
le poète ne doit-il pas quand il récite
faire que l’on ouïsse une cadence grande ? » (109).
Regardez les oiseaux du ciel
Étrange est le titre du livre de William Cliff, étrange demeure-t-il même après qu’il a tenté de l’expliquer :
« Pourquoi ce titre étrange Matières fermées ?
Parce qu’étant vraies elles ne sont pas ouvertes
et conservent ainsi leurs puissances innées
qui ne sont pas à portée des têtes trop prêtes
à expliquer toujours ce qu’on ne peut comprendre. » (59).
Peut-être s’agit-il de manifester ainsi toute la valeur de ce que recèle la part secrète et pas assez dite de tout un chacun ?
Quoiqu’il en soit, le poème de W. Cliff n’est pas fait que de cette descente dans l’intimité de l’être. Car le poète dit à plusieurs reprises la force et la consolation qu’il trouve à la fréquentation des arbres et des oiseaux. Les premiers « se tiennent debout sur le flanc des coteaux / avec leurs grands corps noirs solides et terribles / qui élèvent leurs bras magnifiques et beaux / comme pour nous dire des choses indicibles. » (102). Quant aux seconds pleins de ferveur et de vitalité, semblant vouloir reproduire et multiplier la vie, ils le conduisent à poser cette question : « Et nous les hommes chantons-nous donc assez fort / pour marquer que nous sommes fiers de notre sort ? » (97).
Un sonnet de facture à la fois précieuse et naïve, qui rappelle un peu Francis Jammes, répond à cette invite :
« Avec mon pauvre corps abattu, abîmé,
merci, mon Dieu, de m’accorder cette journée,
et ce trait de soleil qui éclaire la vie,
et ce grand cèdre qui mugit sa symphonie.
Avec mon pauvre esprit empêtré, raviné,
merci, mon Dieu, de me pousser dans la journée
sans savoir si j’en ferai une poésie
capable de chanter votre gloire infinie.
Et avec ces oiseaux rapides qui poursuivent
je ne sais quel dessein dans leur course furtive,
avec le parlement de cette tourterelle
dont le roucoulement vient frapper mon oreille,
merci, mon Dieu, d’être encor présent à moi-même
et de pouvoir vous offrir ce simple poème. » (49)
Le long poème-confidence de William Cliff semble désigner dans ce consentement et cette gratitude, dans cet étonnement de vivre, ce que cherchent en secret nos « matières fermées ».
William Cliff, Matières fermées, La Table ronde, 2018, 248 p., 16 €
* Tous les sonnets sont mentionnés ultérieurement par leur seul numéro.
.

































