
“Marcher jusqu’au soir” : Lydie Salvayre passe la nuit avec Giacometti

Lydie Salvayre a passé toute une nuit enfermée dans un musée. Une expérience qu’elle relate dans son nouveau livre, Marcher jusqu’au soir (éditions Stock). Un récit précieux, profondément intime, qui s’ouvre à l’universel.
En 2018, les éditions Stock ont lancé la collection “Ma nuit au musée”, invitant des écrivains à passer une nuit enfermés au musée Picasso de Paris et à coucher leurs impressions en mots. À ce jour, cette initiative insolite a donné naissance à deux récits, autant réflexion intime qu’interrogation sur l’art. À la suite de Kamel Daoud et son Le peintre dévorant la femme, c’est Lydie Salvayre qui s’y est « collée » – un verbe qui lui va parfaitement – avec Marcher jusqu’au soir.
Giacometti ou l’essence même de l’art
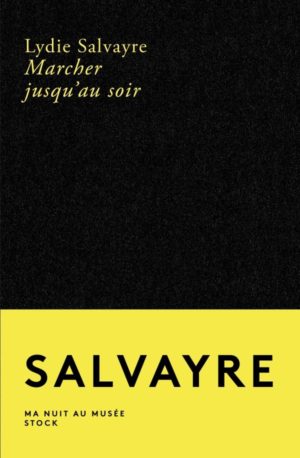 Dans un premier mouvement, l’écrivaine a refusé le projet parce qu’elle n’a aucune inclination pour les musées où les œuvres sont entassées, figées, leur singularité propre étouffée, pour ces institutions où se fabrique bien souvent du sensationnel financé par des « crapules » (dixit). Elle exècre ces temples de la culture dite légitime qui impose un goût et s’oppose à la culture populaire, la sienne. Selon elle, l’art doit être offert à tous les yeux, être « désemmuré » et greffé au cœur du quotidien. Et puis elle a trop à faire pour se consacrer à ça ; et puis les gens s’en « contrefoutent » de ce genre d’écrit, sans intérêt dit-elle. Elle finit cependant par accepter l’exercice, une façon peut-être de défier sa timidité face aux œuvres d’art, cette distance originelle qui lui vient de son milieu pauvre et pas du tout intellectuel.
Dans un premier mouvement, l’écrivaine a refusé le projet parce qu’elle n’a aucune inclination pour les musées où les œuvres sont entassées, figées, leur singularité propre étouffée, pour ces institutions où se fabrique bien souvent du sensationnel financé par des « crapules » (dixit). Elle exècre ces temples de la culture dite légitime qui impose un goût et s’oppose à la culture populaire, la sienne. Selon elle, l’art doit être offert à tous les yeux, être « désemmuré » et greffé au cœur du quotidien. Et puis elle a trop à faire pour se consacrer à ça ; et puis les gens s’en « contrefoutent » de ce genre d’écrit, sans intérêt dit-elle. Elle finit cependant par accepter l’exercice, une façon peut-être de défier sa timidité face aux œuvres d’art, cette distance originelle qui lui vient de son milieu pauvre et pas du tout intellectuel.
Sans présence humaine, dans le sinistre silence du musée, elle se maudit d’avoir cédé, elle ne s’y sent pas à sa place, son imagination est sèche, cette « expérience à la con » est décidément une véritable corvée. C’est quand elle cesse de s’invectiver que ses pensées s’ébrouent et vagabondent… vers le passé, sa mère toute bonté, son père pétri de méchanceté, cet homme violent qui l’effrayait et dont, chaque jour, elle souhaitait la mort… vers cette sculpture de Giacometti auprès de laquelle elle s’est installée et qu’elle considère comme « l’essence même de l’art » (p.20), L’Homme qui marche.
C’est le 10 octobre 1901, à Borgonovo dans le Canton des Grisons en Suisse, que naît Alberto Giacometti. Il sera l’aîné de quatre enfants. Son père, Giovanni, artiste peintre, le pousse à découvrir l’art et à aiguiser un talent inné. Ses premières œuvres sont des portraits de sa famille et de ses amis, peintures marquées par l’absence de décor, par une palette quasi monochrome et sombre, par nombre de détails et retouches sur les visages, comme des brouillons tâtonnant vers la perfection – la grande histoire de sa vie. Il étudie à l’École des Beaux-Arts de Genève avant de rejoindre Paris, en 1922, la capitale des arts où foisonnent des artistes de tous genres. Il y fréquente l’atelier d’Antoine Bourdelle à Montparnasse et découvre le cubisme auquel il n’adhérera jamais vraiment, s’intéressant à l’art africain et aux statuaires grecque et égyptienne.
En 1926, il emménage dans sa « caverne-atelier », sise dans le XIVe, et ne la quittera plus malgré son exiguïté. C’est en 1927 qu’il expose pour la première fois, au Salon des Tuileries. En 1930, il se rapproche des surréalistes avant de s’en éloigner quelques années plus tard pour poursuivre sa quête de représentation de la réalité se concentrant sur la figure humaine. Il s’affirmera avec un style caractérisé par de hautes sculptures filiformes dont la plus célèbre, celle qui est considérée comme son chef-d’œuvre est effectivement L’Homme qui marche. Giacometti connaîtra les honneurs à la fin de sa vie, avec notamment les prix Carnegie et Guggenheim, avant de s’éteindre le 11 janvier 1966.
Beauté dans la relation
Son intérêt singulier pour Giacometti conduit Lydie Salvayre à une réflexion sur l’art et sa fonction : est-il là pour décorer, faire étalage de luxe et d’opulence ? Sert-il à interroger, à bouleverser ? Et qu’en est-il de la notion de « beau », de ce jugement de valeur qui se veut homologation et qui parfois enferme celui qui le prononce, étouffe l’œuvre qui en est l’objet en même temps que son auteur ?
« Nous vivions dans un monde qui définissait l’être par l’avoir, et la beauté par son prix […]. L’art n’était-il pas précisément ce qui ne se peut évaluer, ce qui est précisément inestimable en termes financiers ? » (p.89)
D’un point de vue philosophique, la beauté exalte, elle peut sauver le monde, elle est promesse de bonheur et de consolation, son rôle semble être de nous faire oublier notre condition de mortels. Rappelons ici que la beauté est moins dans l’objet que dans le lien intime qui la lie à qui l’admire. La beauté naît d’une relation, est relation. Ainsi une œuvre sombre, écorchée, austère peut-elle être vue belle. Les goûts se transforment, les canons esthétiques d’hier ne sont plus ceux d’aujourd’hui. Et l’art a ceci de particulier d’être à la fois temporel, s’inscrivant dans une époque et ses revendications, ses dénonciations, ses humeurs, ses doutes, et intemporel en questionnant notre rapport au monde, à l’autre et à nous-mêmes.
L’art est un moyen de voir. Si tout nous dépasse, nous déroute, il est recherche de sens, de vérité, de nudité essentielle, existentielle même. C’est de cette façon que Giacometti concevait son travail, s’efforçant inlassablement de toucher le réel au plus près. Il tentait de pénétrer le secret des êtres, cette présence intérieure, ce caractère unique qui se dérobe. Toute sa vie, il a recherché le chef-d’œuvre ultime dont l’insaisissabilité marque les limites de la création, comme une métaphysique de l’impossible elle-même érigée en œuvre.
Mouvement vital
Giacometti personnalise le refus de catégorisation – tout comme Lydie Salvayre –, de définition qui fige, par l’humilité qu’il avait chevillée au corps. Il ne se voyait ni sculpteur ni peintre et était peu satisfait de son ouvrage, une radicalité qui lui faisait assumer ce qu’il considérait comme des échecs, s’en amusant, poète-enfant. C’est le vivant qu’il poursuit du bout de ses doigts parce que pour lui l’homme vaut plus que tout. Un chemin sans fin, tout sujet échappant à l’œuvre, la dépassant peut-être, laissant l’artiste au creux d’un insondable mystère.
La sculpture L’Homme qui marche qui fascine Lydie Salvayre en est un bel exemple : un homme énigmatique, tout en longueur, dépouillé, esquissé, absolument solitaire, décharné et vulnérable, si fragile, affiné à l’extrême, préfiguration de l’effacement. Non pas « un » homme mais « l’ » homme – une essence, une condition – en mouvement, comme si cesser de marcher signifiait mourir, un miroir de nous-mêmes qui marchons jusqu’au soir de notre existence. Le mouvement, c’est la vie… et la vie, un art ?
« L’Homme qui marche marchait vers la mort, comme moi, comme nous, mais lui le savait, et ce savoir lui courbait l’échine et le faisait infiniment modeste. Il savait que sa vie le menait au néant, et que toute la poésie du monde, tout l’art du monde, tout l’or du monde et toute la philosophie du monde n’y changeraient strictement rien. » (p. 185)
Lydie Salvayre nous offre un récit – obtenu de haute lutte dans tous les sens du terme – précieux, profondément intime, qui s’ouvre à l’universel. Elle avoue être à maturation lente dans bien des domaines de sa vie, méfiante vis-à-vis des diktats culturels, suspectant ce qui est érigé en culte. Confessant une navrante inaptitude à l’oral, elle use d’un style à la fois direct et flamboyant, au vocabulaire fleuri de mots rares, d’une langue au charme suranné exquis. La belle façon dont elle questionne notre relation à l’art est concrète, pertinente et suscite nos propres débats intérieurs.
« Une sculpture n’est pas un objet, elle est une interrogation, une question, une réponse, souligne Gioacometti. Elle ne peut être ni finie ni parfaite. »
Lydie Salvayre, Marcher jusqu’au soir, Stock, coll. “Ma nuit au musée”, 224 p., 18 €

































