
Mais qu’est-ce qui nous fait courir ?
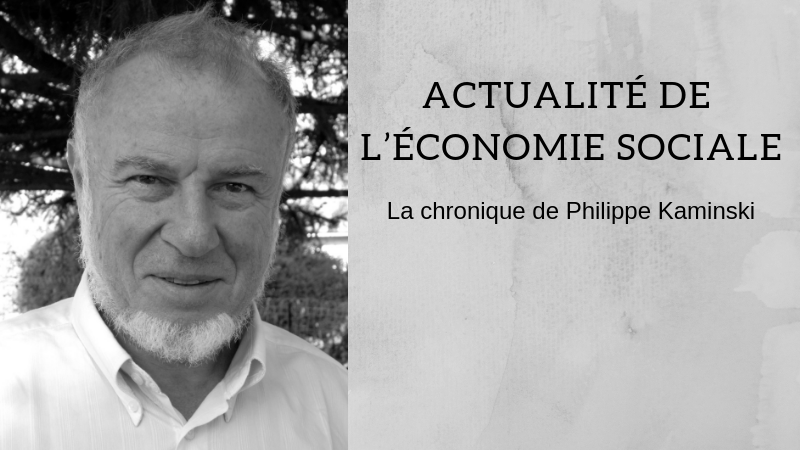
Prisonniers d’une logique individualiste et libérale, les Français perdent peu à peu sur ce qui les constitue, à savoir une culture, des trésors nationaux, à commencer par le premier d’entre eux : la langue française. Au nom d’un prétendu sens de l’Histoire, on fait table rase de tout ce qui nous unit et bâtit le collectif. Un combat pour retrouver nos racines a-t-il encore du sens aujourd’hui ?
Actualités de l’économie sociale
Il me faut commencer par tordre le cou à un mythe qui a la vie dure : celui du battement d’ailes du papillon dont les effets seraient sensibles à l’autre bout de l’Univers. Je ne sais d’où provient cette fadaise qui permet de justifier n’importe quoi. Depuis l’Éthique à Nicomaque, qu’il est si aisé de lire de travers, les divagations sur la causalité des événements ne cessent de faire des nœuds dans les esprits les plus rétifs au bon sens.
Non, les volettements des lépidoptères de mon jardin n’ont jamais déterminé mes pensées ou mes actes, et encore moins ceux des vanesses d’Australie ou de Zanzibar. On pourra toujours dérouler à l’infini une chaîne de causes/conséquences les plus farfelues, mais on ne pourra jamais remonter dans l’autre sens plus de deux ou trois crans. C’est tout ce qui distingue le possible du probable ; l’un ne relève que de l’abstraction, tandis que l’autre est soumis au réel. Le calcul des probabilités, avec ses archétypes que sont le dé ou la roulette du casino, ne peut nous fournir qu’un modèle, une représentation simplifiée, que la réalité suivra plus ou moins bien. Et lorsque l’aléa subi (c’est à dire l’imprécision de l’instrument de mesure) dépasse l’aléa qu’on veut observer, on n’observe rien du tout. Ce qui était possible au plan théorique devient alors, sinon impossible, du moins privé de sens.
Ceci posé, je n’en suis que plus libre pour dénoncer les effets certains, non pas du vol des papillons, mais de l’émission continue de signaux convergents par des foyers d’irradiation, même lointains. Lorsque j’entends, à mon grand dépit, de jeunes Africains francophones déclarer qu’ils veulent aller chercher leur avenir dans un pays voisin anglophone, je sais que ce parti-pris ne résulte pas de témoignages réels ou d’analyses argumentées. Je sais qu’il ne faut y voir que l’écho de la fâcheuse tendance des Français à se dénigrer eux-mêmes. Et à force de répéter le même refrain toxique, il se trouve des oreilles innocentes pour l’entendre et finir par l’enregistrer comme un principe premier.
Cette auto-flagellation, si commune chez les Français, a depuis longtemps atteint la masse critique qui lui permet d’être entendue, en fond sonore, partout dans le monde. Il ne faudrait pas cependant y voir une propension générale au masochisme. Chez beaucoup des nôtres, la complaisance dans la dépréciation de la langue française et des divers symboles nationaux est en fait une manifestation d’orgueil individualiste ; je ne brocarde pas la France parce que c’est la France, mais parce que c’est mon pays, un pays qui m’a été imposé sans que je l’aie demandé. Or je tiens à me construire moi-même, à n’être que ce que j’ai décidé d’être. Je veux choisir les communautés auxquelles je souhaite adhérer, et en changer quand cela me plaira. Je mets ma fierté où je veux, et je refuse par principe de la mettre là où m’imposerait d’aller.
Une telle profession de foi libertaire ne va pas sans son pendant libéral : les sociétés, les nations, les langues, les villes, les cultures, les paysages, ont toujours évolué. Que ces choses-là continuent à se transformer, sous nos yeux, n’a rien que de très normal. Pourquoi devrait-on s’en formaliser, chercher à les maintenir comme elles sont, ou les faire revenir à ce qu’elles furent ? Ce qui compte, c’est d’y tirer son épingle du jeu, d’y défendre et d’y faire prévaloir ses intérêts. Seule doit compter ma réussite individuelle, ma capacité à m’adapter aux changements. Je n’ai à défendre que mes propres biens, mon confort, et l’art de vivre certes, mais uniquement celui que j’aurais choisi.
Quels arguments opposer à cette marée montante, quand on se sent et qu’on se veut amoureux de sa langue et de son patrimoine ? Il est difficile, voire cruel, de s’attacher à défendre un trésor collectif que ses autres héritiers raillent et vilipendent !
Et il est à l’inverse très facile, lorsqu’on proclame que le trésor est menacé, qu’il faut le préserver, de se faire basculer du mauvais côté de l’argumentation. La conservation peut être aisément mise en position de faiblesse quand on l’oppose au mouvement, comme la tradition par rapport au progrès, comme l’ancien par rapport au nouveau, comme en général le contre par rapport au pour. Il faut être singulièrement plus malin, ou nettement plus nombreux, pour pouvoir l’emporter.
Ce ne sont pas que les puissances de l’individualisme qui se dressent face à nous. L’Histoire est pleine de ces foules en furie qui réclament que du passé l’on fasse table rase. Si l’égoïste trouve son contraire en celui qui abandonne toute autonomie au profit d’un collectif protecteur mais totalitaire, ni l’un ni l’autre ne nous sont favorables. Pourquoi un composé des deux, une sorte d’intermédiaire, nous le serait-il davantage ? Il faut chercher ailleurs.
Longtemps, la classe intellectuelle était, dans sa majorité, persuadée de l’existence d’un sens de l’Histoire. La seule ambition possible était d’en être l’avant-garde. On ne pouvait modifier la route, mais on pouvait au moins marcher parmi les précurseurs, se donner l’illusion de hâter l’avènement de l’inéluctable révolution. On doit bien reconnaître que ce n’est pas très motivant, et il n’est pas étonnant que nombre de ces chevau-légers aient passé leur temps à s’entre-épurer et à pourchasser chez leur plus proche voisin l’ennemi de classe qui sommeille. Mais au moins constituaient-ils un foyer irradiant de première grandeur.
Face à eux, les « réactionnaires » (ceux qui réagissent) devaient se contenter d’être les papillons de la farce. Ils n’avaient qu’un atout, la fierté prométhéenne de sentir qu’ils se dressaient, non pour suivre un scénario déjà tout écrit, mais pour dominer le cours de l’Histoire, pour l’infléchir, voire pour l’arrêter.
Après un moment de flottement, les libéraux-libertaires ont pris la place des marxistes dans le rôle d’accompagnateurs profiteurs de la marche du monde. Celle-ci n’est plus dictée par une idéologie, mais laissée libre de suivre son cours vagabond. Leur position est-elle solide ? Inexpugnable ? Les amoureux de la langue et du patrimoine en seront-ils, une fois encore, réduits à la défensive et enfermés dans leur rôle de chevaliers à la Don Quichotte ?
Nous sommes dans la bataille. Je ne sais qu’une chose, que les battements d’aile des papillons ne servent à rien. Il faut pouvoir investir la citadelle et se mettre au centre de l’irradiation. Le désir de marquer les temps de son empreinte, que chacun porte peu ou prou au fond de soi-même, sera-t-il suffisant pour séduire assez de libertaires et les faire changer de camp ? Le salut de ce qui nous est cher en dépend. Sinon, l’on saura qu’une fois de plus, les civilisations sont mortelles et que les plus belles choses peuvent avoir une fin. Comme disait la chanson, la lutte continue…
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Lettre à Paul St-Pierre Plamondon : “Il vous faudra innover, tout en retrouvant vos racines”
– Solidaire ou solitaire ?
– Retour à l’émancipation ?
– Des ressources pour construire le lien social ?
– LET’S GROW
– “Affaire CGT vs Smart” : lois de la jungle et innovations sociales
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































