
“L’ombre de la terre” de Christine Fizscher : qui protègera la mèche qui faiblit ?

Comment vivre dans une existence fragmentée ? Avec L’ombre de la terre, Christine Fizscher invite son lecteur à une méditation sur la mémoire et l’oubli, sur la douleur de l’absence, sur l’être humain à la lumière vacillante. Un recueil poétique pétri par l’absence et la solitude, publié aux éditions Dumerchez. On peut cependant regretter le caractère parcellaire et superficiel de ce journal, son confinement dans des aperçus d’états d’âme et des considérations inabouties et elliptiques.
Lectrice au sein de plusieurs maisons d’édition (Gallimard, Flammarion, Julliard, Plon), déjà auteure de La nuit prend son temps (Seuil, 2007) et de La dernière femme de sa vie (Stock, 2011), Christine Fizscher publie aux éditions Dumerchez L’ombre de la terre, un recueil marqué par l’absence, les absents, par l’hésitation, chez ceux « qui restent », entre la mémoire et l’oubli, tant la première avive la douleur de la perte, refuse la plaie refermée, quand le second semble offrir une douce apathie. Vécue comme succession d’instants, de moments, de périodes, la vie apparaît composite et fragmentée : instants, moments et périodes se succèdent et se recouvrent, les suivants effaçant et bâillonnant les précédents.
Après une ouverture ensoleillée dans l’ultime et presque langoureuse exultation de l’été grec (« vieillards somnolents aux seuils / de leurs boutiques obscures. Buissons d’odeurs, / cimetière haut penché vers la mer, / solitude bleue »), le recueil se fait plus méditatif, plus “noir et blanc” (« Puis la couleur s’absente / Quand au ciel la mer s’unit »), l’auteur semblant rechercher la solitude et l’ombre, l’ombre de la terre, l’ombre de sa vie – l’ombre d’elle-même.
Tous ces thèmes sont, hélas (car l’écriture ne manque pas d’élégance ni le regard d’acuité), traités de façon non pas fragmentée, car après l’écriture pourrait réitérer et manifester le caractère fragmenté de la vie, mais trop superficielle, par manque, nous semble-t-il, d’exigence et de précision. Soit une manifestation des travers d’une certaine poésie, excessivement expressionniste et imprécise, éludant et aseptisant la puissance de vérité du langage poétique. On en vient ainsi à attendre de Christine Fizscher un nouveau recueil plus abouti car son regard et son écriture comportent une réelle authenticité.
La douloureuse mémoire des absents
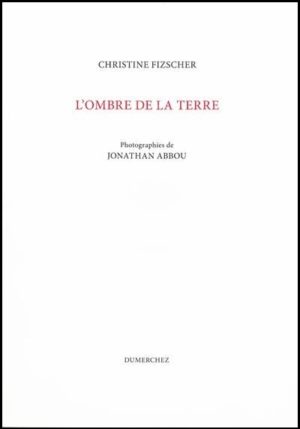 Bien que le thème soit avancé de manière très, trop elliptique, au point que le lecteur de bonne volonté est conduit à développer lui-même (et parfois pour lui-même) le thème ainsi esquissé, l’on comprend que pour l’auteure, l’absence surgit plus douloureuse encore d’avoir été un moment ignorée, d’avoir semblé un temps surmontée. Nous ne sommes pas maîtres en effet de notre mémoire qui a son langage et surgit en son propre temps, qui d’une certaine manière « souffle où elle veut » et peut affleurer soudainement à la conscience et attirer à elle, invinciblement, celle qui croyait avoir oublié l’absent, « au moins avoir oublié le manque de toi ». C’est ainsi que sa mémoire, avivée par la voix du disparu, vient emplir le jour de son absence : voix qui ne semble demeurer et durer que pour dire encore et encore la disparition. Voix qui, d’une certaine manière, ne subsiste que pour dire et rappeler qu’elle est la voix de personne, c’est-à-dire une déchirure. Paul Celan disait : « La rose de personne » (Die Niemandsrose).
Bien que le thème soit avancé de manière très, trop elliptique, au point que le lecteur de bonne volonté est conduit à développer lui-même (et parfois pour lui-même) le thème ainsi esquissé, l’on comprend que pour l’auteure, l’absence surgit plus douloureuse encore d’avoir été un moment ignorée, d’avoir semblé un temps surmontée. Nous ne sommes pas maîtres en effet de notre mémoire qui a son langage et surgit en son propre temps, qui d’une certaine manière « souffle où elle veut » et peut affleurer soudainement à la conscience et attirer à elle, invinciblement, celle qui croyait avoir oublié l’absent, « au moins avoir oublié le manque de toi ». C’est ainsi que sa mémoire, avivée par la voix du disparu, vient emplir le jour de son absence : voix qui ne semble demeurer et durer que pour dire encore et encore la disparition. Voix qui, d’une certaine manière, ne subsiste que pour dire et rappeler qu’elle est la voix de personne, c’est-à-dire une déchirure. Paul Celan disait : « La rose de personne » (Die Niemandsrose).
On comprend alors pourquoi l’auteure dit à cette voix qui vient creuser un puits dans le jour : « Et j’ordonne à ta voix de se taire, de s’effacer ». On comprend le désir d’abandon, d’immobilité, de passivité, surtout que ce désir se teinte d’une certaine sensualité :
« N’être plus qu’un arbre du parc
Une ramure sous le vent
Nue, sans cesse caressée,
Racines enfouies. »
Désir ambigu cependant car contrarié, contredit par le désir tout aussi vif et impérieux de conserver en soi le nom qui a disparu des registres des hommes (« … sur le bottin son nom / ne se trouve plus. »), qui a perdu toute réalité sociale, qui n’a plus la force de l’évidence. La participation active du lecteur aidant, on peut prêter à l’auteure l’insinuation de cette question étrange mais féconde : de celui qui disparaît et de celui qui reste, qui oublie l’autre ? Et même, qui veut le quitter ? Le poème suivant tremble de cette interrogation :
« Vraiment tu veux que blanchissent
tous mes souvenirs avec toi ?
Ils sont assez peu nombreux
pour que je les chérisse,
de toi de moi amoureux. »
La ligne brisée du temps
On retrouve ce tremblement, ce questionnement, cette hésitation dans l’appréhension du temps. Celui-ci se présente comme un espace incertain, un terrain vague : il n’est pas l’occasion d’une construction progressive, d’une édification (passât-elle par une décrépitude extérieure, apparente) mais il est une suite incohérente de fragments, une ligne qui se brise en pointillés :
« À hésiter,
Je demeure en suspens
Dans cet espace
Entre la vie et la mort de chaque fragment
Du temps qui passe. »
Mais, en suppléant à nouveau au caractère trop lacunaire de sa réflexion sur ce point, l’on peut penser que, comme le faisait Guillevic, Christine Fizscher écrit « contre le temps », c’est-à-dire contre la marche du temps, son avancement qui fait que les instants se succèdent et se recouvrent, le suivant effaçant et bâillonnant le précédent. L’écoulement du temps est donc bien (dé)perdition de matière, ce que dit bien le motif romantique de la fuite du temps.
Il n’éteindra pas la mèche qui faiblit
Une lumière incertaine, précaire et expirante parfois, traverse le recueil. Absence et solitude font de la délaissée comme une pièce qui demeure allumée dans l’attente du retour de l’aimé, ou de sa bienheureuse irruption. Qu’il tarde et l’extinction s’impose et s’installe :
« Éternelle attente d’un être
En quête du mien.
…
La solitude monte
Par ondes brèves,
On dirait que des ampoules en moi s’éteignent. »
C’est en réalité chaque être humain qui est une lumière vacillante, un petit feu précaire et le dire, y consentir, est déjà sagesse et beauté. Voici donc que le monde est peuplé de « femmes-lumignons » et « d’hommes-veilleuses », dont la vie, la croissance et l’être tiennent du prodige « sous le ciel qui s’abaisse chaque jour ». Dans deux vers que nous trouvons très justes, très beaux, Christine Fizscher qualifie ainsi l’humaine et pauvre condition, laissant cependant entrevoir la secrète promesse de son assomption :
« Nous, de si petits feux sur la terre
Si nous ne sommes que sur la terre »
Comme si chacun d’entre nous était porteur d’une intime flamme, pauvre, manquant chaque jour de s’éteindre mais mystérieusement protégée par une main secourable qui la garde du vent mauvais, comme si la pauvre flamme de nos vies avait un protecteur, un qui, comme le dit Isaïe (42, 3), « n’éteindra pas la mèche qui faiblit ».
On regrettera finalement que Christine Fizscher n’ait pas davantage creusé les différents thèmes qu’elle évoque : l’absence des êtres chers et la fragmentation du temps, la façon qu’elles ont de creuser un gouffre intime dans la personne ; la précarité de la lumière et de la vie terrestres, ce qu’elle suscite d’angoisse et de solitude, le plus grand amour et la plus grande espérance qu’elle appelle. On regrettera surtout qu’elle ne les ait pas exprimés, ces thèmes, avec les armes et l’évidence du langage poétique et se soit trop plu à donner des aperçus brumeux de ses états d’âme. On aurait aimé, au fond, qu’elle nous en dise plus, qu’elle nous mène plus avant dans son cheminement intérieur.
Et de cela la poésie est non seulement capable mais même responsable et redevable : avec les armes qui lui sont propres (l’émotion, l’étonnement, la recherche de la beauté), la poésie a une fin qui n’est pas moins noble et qui n’est guère différente de celle de la philosophie, bien que celle-ci ait aussi ses propres armes, en premier lieu le recours à la raison : dire la vérité, dire la vérité de la réalité, le dire en exigeant de soi intégrité, sincérité et précision. C’est à ce prix que la lame tranchante de la poésie peut atteindre le cœur des choses, le cœur de l’être, le cœur du monde.
Christine Fizscher, L’ombre de la terre, Éditions Bernard Dumerchez, 2019, 43 p., 15 €


































Rétroliens/Pingbacks