
La seconde de mes deux morts de Charles Gide
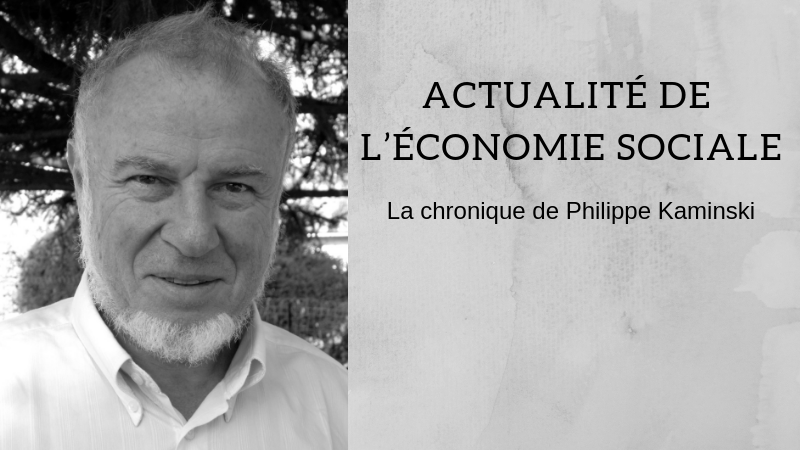
Sous la forme amusante de l’anecdote, ou plutôt du conte qui contient sa vérité propre, Philippe Kaminski raconte la double mort de Charles Gides, comme un constat d’échec de la pensée du dirigeant historique du mouvement coopératif français, théoricien de l’économie sociale et président du mouvement du christianisme social. Après avoir été la victime d’une exécution sommaire et humiliante sur une frontière de l’Europe de l’Est, voilà le père fondateur de l’économie sociale et solidaire devenu la proie de l’humidité et de la mérule — allégorie dans la caverne.
Tribune libre et hebdomadaire de Philippe Kaminski*
Serge s’appelait bien Serge. Ses amis le reconnaîtront aisément. Les noms des autres personnages ont été modifiés, ainsi que ceux des lieux, afin de donner au récit un petit air de fiction. Mais à part ces artifices, les événements se sont déroulés exactement comme je les raconte.
Serge s’est éteint le 12 janvier 2014, après comme l’on dit pudiquement « une longue maladie ». Je le fréquentais depuis longtemps, mais nous n’étions devenus réellement proches que depuis une petite dizaine d’années. Nous fréquentions les mêmes réunions à Paris et les mêmes colloques ailleurs. Et surtout, je logeais chez lui lorsque j’allais faire mes cours à l’IUT de Bordeaux, établissement qu’il avait lui-même dirigé avant de prendre sa retraite.
Il me réservait le dernier étage de sa maison de ville, juste au-dessus des pièces où sa compagne Henriette donnait ses leçons d’ikebana ; les portes étaient alors closes, et il ne fallait surtout pas faire de bruit. Quand sonnait l’heure de la fin de la séance, les élèves, pour la plupart des dames d’âge mûr, envahissaient l’escalier, ramenant chez elles tout ou partie de leur savante œuvre du jour. Cela réveillait les nombreux chats de la maison qui se mettaient à courir en tous sens. Serge et moi, qui attendions sagement au rez de chaussée, généralement autour d’une bouteille de cognac, savions à ce signal que nous pouvions monter dans la bibliothèque. Celle-ci occupait tout le premier étage, couloirs et recoins compris. Chaque pouce carré de chaise, de canapé ou de guéridon y était occupé par des dossiers ouverts ou des piles de documents ; mais ce n’était que décor de théâtre, car avec mon esprit pervers j’ai pu vérifier d’un séjour à l’autre que les pages n’étaient jamais tournées.
Serge était un vétéran de l’étude de l’Économie Sociale. Lorsque celle-ci prit nom et consistance, il l’auscultait déjà depuis longtemps, sous d’autres costumes de scène, travail communautaire d’abord, puis autogestion. Il était entré dans l’entourage d’Henri Desroche par la porte du marxisme, que l’un et l’autre franchirent plus tard dans l’autre sens ; mais on sait que nul n’en sort complètement. Il fut un temps rédacteur en chef de la Revue des Études Coopératives, fonction qu’il dut quitter dans des conditions confuses qui lui ont laissé un souvenir amer. En fait, plus que par l’idéologie, il était porté par un idéalisme confinant à l’irénisme, et son cheminement vers ce qu’il faut de réalisme et de scepticisme se fit avec douleur, par une succession d’épreuves personnelles pénibles. Il croyait à l’autogestion autant qu’il l’étudiait, et il vécut avec déchirement le moment où il fut bien forcé de convenir que ses rêveries yougoslaves et algériennes s’étaient fracassées sur le mur du centralisme bureaucratique. Il croyait à la sincérité et à la transparence du monde coopératif, et découvrit à ses dépens qu’on y cultive autant qu’ailleurs le mensonge, la calomnie et la violence. Lorsque Henriette fut élue présidente d’une des fédérations d’ikebana (car il y en plusieurs, rivales et à couteaux tirés), il comprit que le monde associatif ne vaut pas mieux.
Et c’est lorsqu’il fut éconduit, fort peu élégamment, du CIRIEC où il s’était beaucoup investi, qu’il me sembla qu’il se raccrochait à moi, comme s’il se cherchait un grand frère de remplacement. Mais j’étais largement son cadet et je ne tenais pas du tout à tenir ce rôle qu’avant moi Desroche, puis Fournier (longtemps président du CIRIEC, après avoir été celui, entre autres, de la SNCF) avaient si mal joué. Je me tenais donc à une certaine distance, qu’il cherchait pour sa part à réduire ; et pour ce faire, connaissant ma passion de collectionneur, il se mit à me parler des trésors qui dormaient dans sa cave. Il ne s’agissait pas de bouteilles, mais de liasses de documents sur l’autogestion et sur les coopératives qu’il avait accumulés au cours des lustres écoulés et qu’il était peut-être bien le seul à avoir conservés. Un jour, nous regarderons cela ensemble, m’assurait-il.
*
Ce jour n’est jamais venu. Quelques mois après la disparition de Serge, Henriette qui était au courant de nos intentions me demanda si je voulais bien me charger du tri et de l’enlèvement des archives du sous-sol de la maison. J’acceptai d’emblée, tout en entrevoyant fort bien les difficultés de l’exercice : aucune raison professionnelle ne m’appelait plus à Bordeaux dont j’étais éloigné de 900 kilomètres, je n’avais pas de place chez moi et un premier tour d’horizon de mes amis et connaissances s’avérait négatif. Chacun cherchait à réduire son exposition au papier et numérisait à mort. Les institutions faisant explicitement profession de conserver l’Histoire ne pouvaient me dire non, mais refusaient de se prononcer en l’absence d’inventaire détaillé. Cela ne m’étonnait guère mais ne m’encourageait pas beaucoup. Mais par devoir de mémoire vis-à-vis du défunt, il me fallait aller au front. J’obtins un petit financement de mes amis de l’ADDES et je fis un premier voyage en octobre 2015.
Que tout était beau, que tout semblait simple, avant d’avoir commencé ! Henriette m’emmena dans la zone industrielle de Mérignac acheter des cartons ad hoc, puis nous fîmes une halte déjeûnatoire tranquille place des Quinconces et, pleins d’entrain, lampe torche à la main, nous descendîmes par une étroite échelle de bois pour prendre la mesure du travail d’Hercule qui nous attendait.
C’était épouvantable ! Il y avait des mètres cubes et des mètres cubes de cartons d’âge canonique noyés de poussière qui tombaient en lambeaux au premier contact. Il nous fallait les remonter tant bien que mal, un par un, pour les mettre à la lumière et en inventorier le contenu. On ne détectait aucune régularité géologique dans l’empilement ; les âges comme les provenances géographiques (Serge avait beaucoup voyagé, jadis) s’y côtoyaient, indice qu’on les avait plusieurs fois remués. Mais d’après Henriette, plus personne n’y était redescendu depuis environ vingt ans.
Le lendemain soir, après avoir déplacé et trié je ne sais combien de quintaux de papier et pris presque autant de douches, il me fallait prendre congé et me rendre à l’évidence : j’étais loin d’avoir fini. Beaucoup de belles choses avaient été découvertes et soigneusement rangées, bien plus avait été emmené en déchetterie ; Serge avait tout conservé, des mémoires d’étudiants aux paperasses administratives les plus futiles. Une seconde expédition, en janvier 2016, se solda par un constat identique : plus on en récupérait, plus il en restait à trier. En attendant leur enlèvement, les cartons propres furent entreposés dans le grand salon du rez-de-chaussée, cachés par des couvertures, coincés sous une fenêtre par un grand canapé.
*
Serge nous avait quittés voici deux ans déjà, il fallait vite en finir et surtout trouver aux documents récupérés une destination utile et intelligente qui puisse justifier notre travail. Mais ce fut l’inverse qui advint. Lassitude, éloignement et difficultés de toute sorte firent leur funeste besogne. Les mois passèrent, puis les saisons, sans qu’Henriette et moi ne trouvions ni envie ni disponibilité pour reprendre notre chantier. Et comme plus personne ne m’en parlait, que personne ne semblait en attendre une issue ou y porter le moindre intérêt, les choses en restèrent au point mort. Ce n’est qu’en novembre 2017 que des problèmes dans le règlement de la succession convainquirent Henriette de l’urgence de vider la cave, et je dus refaire une fois de plus le voyage.
Entre temps, elle avait cessé ses cours d’ikebana et était partie vivre ailleurs. La grande maison de Bordeaux, désormais inoccupée, avait subi des infiltrations d’eau qui ne purent être détectées que trop tard, et une partie des cartons qui restaient en bas en avait été victime. Le taux de récupération fut donc nettement plus faible et je dus à contrecœur porter en déchetterie bien de trésors de littérature que l’humidité avait endommagés. Le soir venu, tout n’était pas vidé, loin s’en faut, mais l’état de ce qui restait ne laissait guère d’espoir et tout ce reliquat fut condamné d’office au pilon. Et je promis que les quarante cartons propres, inventoriés et estampillés qui attendaient au salon seraient très bientôt enlevés.
Promis, juré, craché. Mais qu’est-ce qu’une promesse ? Le prometteur propose, suppose, et les événements disposent. J’avais bien d’autres chats à fouetter, et nulle part pour stocker tout ce papier. Et de nouvelles semaines passèrent sans qu’il ne se passe rien, jusqu’en mars 2018, où un nouveau coup de fil d’Henriette me faisait comprendre que cette fois, l’urgence était devenue super-urgente. Je n’avais pas le choix. Inutile de se tourner vers l’ADDES où tout le monde avait oublié l’affaire. Il me fallait trouver une solution d’attente, en région parisienne de préférence. Je me tournai alors vers mon ami Wassily, qui venait de louer une écluse désaffectée près du port de Gennevilliers.
*
Wassily, c’est le libraire de l’impossible. Il achète du livre ancien par conteneurs et les revend à l’unité sur Amazon. Il n’utilise aucun dispositif logistique ou informatique sophistiqué, uniquement ses bras costauds, sa bonne humeur et le système D. Comme il a besoin de beaucoup des mètres carrés de stockage, que l’espace est à Paris une denrée rare et hors de prix, et qu’il n’a jamais d’argent, il doit se rabattre sur des endroits improbables, inaccessibles et hors marché, et le plus extraordinaire c’est qu’il en trouve.
Nous fîmes d’autant plus aisément affaire qu’il devait justement envoyer un camion ramasser la bibliothèque d’un ancien couvent près d’Angoulême. Je pris à ma charge une large quote part des frais de transport et le chauffeur fit un crochet jusqu’à la maison de Serge d’où il débarrassa mes encombrants cartons. Voilà enfin une bonne chose de faite, pensais-je… mais mon soulagement allait être de bien courte durée.
Je m’arrangeai pour passer à l’écluse. Non pour l’arrivée du camion, dont l’horaire était imprévisible, mais j’étais là le lendemain de son déchargement. Il y a certains de vos cartons qui ont souffert de l’humidité, m’avait prévenu Henriette au téléphone. Je trouvai cela curieux, voire inquiétant ; ils étaient au sec, dans le salon ! Auraient-ils été victimes de l’incontinence des chats ? Effectivement, plusieurs cartons étaient en bien mauvais état, comme s’ils avaient baigné dans un liquide brunâtre. On n’aurait jamais dû les mettre dans le camion, me dis-je, et en même temps j’imaginais la scène, le chauffeur restant garé en double file dans la rue étroite, deux pièces et un couloir à traverser, le poids des livres, en plus, peut-être, était-ce la nuit ? Bref, ce qui était fait était fait, il ne servait à rien de penser que l’on eût pu faire autrement.
Après ouverture des cartons litigieux, je compris le désastre. Ces livres rongés, comme dissous dans une liqueur marron, j’en avais manipulé de semblables, au fond de la cave. Et dans la pénombre je n’y avais pas prêté davantage attention. De toutes façons tout ce qui était abîmé allait partir dans l’heure suivante à la prochaine navette déchetterie. Et puis, le mal ne s’était peut-être pas encore vraiment propagé. Mais là, je le voyais sous mes yeux, en pleine lumière, ayant dévasté des cartons propres et bien rangés. Ce n’était pas de l’humidité, c’était le diable, la peste ; c’était la mérule !
*
L’écluse était dépourvue de sirènes, mais ce fut comme s’il y en avait. Tout virtuel qu’il fut, le tocsin se mit à sonner à tout va. La mérule dans un dépôt de livres, c’est comme une fouine dans un poulailler ; le pire du pire. J’eus vite fait de séparer les cartons sains, une bonne moitié quand même. Prévenu, Wassily arriva. Pour la première fois, son visage naturellement hilare était blême. Il alla chercher une nourrice de fuel (l’écluse n’étant raccordée à aucun réseau, tout y fonctionnait sur groupe électrogène), la répandit sur les cartons atteints que nous avions préalablement entassés sur un des quais, et alluma un brasier qui d’ailleurs montra bien des récalcitrances à s’enflammer. Puis tous les sols furent frottés à l’eau de Javel, ainsi que l’intérieur du camion. Ce n’est qu’après la fin de l’auto da fé que nous partageâmes une bouteille de gnôle réparatrice qui nous réconcilia avec le monde d’ici-bas.
Le malheureux Charles Gide y fut immolé deux fois. D’abord dans le tout premier carton, le plus facile à remplir, celui qui contenait les livres non pas de la cave, mais de la bibliothèque où Serge rangeait les nouveautés. On y trouvait deux séries complètes des rééditions financées à partir de 1997 par la Délégation à l’Économie Sociale. Ces ouvrages de fabrication récente, à couverture pelliculée, avaient été quasiment digérés par le parasite et réduits à l’état de pâte molle et informe. Seule la cellophane avait survécu. Le papier plus ancien, contenant davantage de bois, résiste beaucoup mieux. Triste fin en tous cas pour ces exemplaires, aujourd’hui introuvables, dont le faible tirage a été presque entièrement souscrit par des organisations de l’Économie Sociale où ils n’ont été lus par personne. Le bilan de cette opération, qui avait mobilisé d’importants moyens, n’est pas reluisant.
Et dans un autre carton se trouvaient 120 exemplaires (oui, cent vingt !) du numéro spécial que la REC avait consacré à Charles Gide pour le cinquantenaire de sa mort (le numéro 209). Serge, qui était alors le rédacteur en chef de la revue, les avait conservés pour lui. Je doute qu’il en reste beaucoup, en dehors de la Bibliothèque Nationale, du Musée Social et de moi-même… Nous aurions pu en sauver ; tous n’étaient pas atteints par le maudit champignon assassin. Mais l’heure n’était pas à la délicatesse ; comme disait Koutouzov, la terre brûlée, c’est la terre brûlée !
Je n’ai pas enquêté pour comprendre comment la mérule avait fait le chemin de la cave au salon. Je n’ai pas voulu en savoir plus. À l’heure où j’écris cet article, le restant des cartons rescapés dort toujours dans une pièce du bâtiment de l’écluse, et Wassily me demande régulièrement ce que je compte en faire.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
- La première de mes deux morts de Charles Gide (08/04)
- Scandale du parachute doré à Audiens : récurrence du superlucratif dans le non lucratif (01/04)
- Grand Débat au Labo de l’ESS : sobriété ou boulimie ? (15/03)
- Ce que veulent les entreprises de l’ESS des pays du Sud (18/03)
- Ces gougnafiers qui nous pourrissent l’existence (11/03)
- Hébétude et Voilàtude (04/03)
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, notamment en lien avec l’ESS.

































