
La scolarisation des filles en Afrique : la robe et les chansons
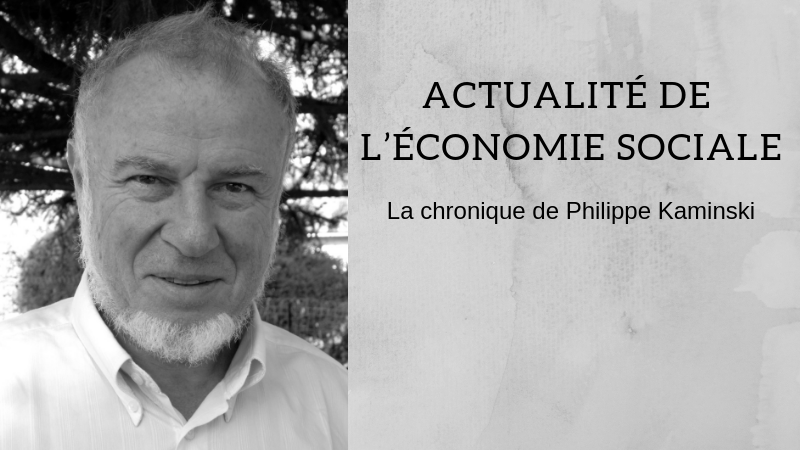
La scolarisation des filles en Afrique fait régulièrement l’objet de programmes des Nations Unies. On y trouve des chiffres invérifiables, des objectifs qui mélangent tout et qui seront vite oubliés, et de la glose indigeste qui sera recyclée de rapport en rapport jusqu’à la nuit des temps. La réalité, elle, est très différente : destins croisés de trois jeunes filles.
Tribune libre et hebdomadaire de Philippe Kaminski*
La scolarisation des filles en Afrique et dans d’autres pays dits « du Sud » fait régulièrement l’objet de programmes des Nations Unies. En général je ne m’attarde pas sur le sujet. On y trouve des chiffres invérifiables, des objectifs qui mélangent tout et qui seront vite oubliés, et de la glose indigeste qui sera recyclée de rapport en rapport jusqu’à la nuit des temps. De plus, je n’ai jamais vu en l’école une divinité intouchable, qu’il serait sacrilège de soumettre à la critique et à l’évaluation. Cependant l’histoire exemplaire de Marguerite, en tous points véridique, vaut d’être contée et méditée.
Le père de Marguerite n’était pas un mauvais bougre. Mais il était près de ses sous et il n’en avait pas énormément. Aussi, après avoir scolarisé ses trois premiers garçons, il se demanda s’il fallait en faire autant de la petite Marguerite. C’était sa première fille, mais la seconde de la mère, qui était sa troisième épouse (vous me suivez ?). Or la sœur aînée, Pervenche, n’allait pas à l’école. Marguerite devait-elle suivre l’exemple de ses frères, ou celui de sa sœur ?
Deux filles du village étaient allées jusqu’au collège. Mais là, elles s’y firent engrosser. Devenues mères avant leur quatorzième anniversaire, elles durent cesser leurs études, sans avoir obtenu le moindre diplôme. Cela donnait à réfléchir. Finalement le père choisit la voie de la prudence et annonça qu’il garderait Marguerite à la maison. Car, décidément, mettre une fille à l’école, ce n’est pas rentable.
Mais Marguerite était d’humeur joueuse, et curieuse de toute chose. Elle se lia d’amitié avec une de ses voisines, Violette, qui partageait les mêmes goûts mais qui, elle, fréquentait l’école. Tous les matins, Violette enfilait son uniforme, une robe bleue et un chemisier blanc, et Marguerite l’accompagnait jusqu’à l’entrée du groupe scolaire. Quand sonnait la cloche, les portes se refermaient, et Marguerite restait un moment dehors sur le perron, le temps de voir monter les couleurs en haut du mât et d’entendre la classe entonner l’Abidjanaise. Et le soir, Violette lui racontait tout ce que la maîtresse avait dit pendant la journée. Et surtout, elle lui apprenait les chansons que les écoliers venaient eux-mêmes d’apprendre. Les deux fillettes chantaient ensemble en se promenant dans les rues, le soir tombé, avant que vienne l’heure du dîner.
Marguerite n’était pas spécialement jalouse de Violette, sauf de sa robe. Elle aurait tellement voulu avoir, elle aussi, une robe bleue. Certes, grâce à Violette, elle n’ignorait rien de ce qui se faisait à l’école, mais elle n’en était pas, parce qu’elle n’avait pas la robe. Elle avait peu à peu développé de l’école une image à la fois ludique et magique ; c’était le lieu de la robe et des chansons, mais un lieu qui lui était interdit.
La mère de Marguerite avait une sœur, opératrice ou agent technique, je ne sais, dans une société de services d’entretien et de propreté de la banlieue parisienne. C’est-à-dire qu’elle passait sa vie entre le seau et la serpillière, et cela lui permettait d’envoyer chaque mois quelques sous au village. Elle réussit à convaincre sa sœur de la rejoindre pour goûter au paradis de l’opulence européenne. L’Africaine emmena ses deux filles et elles s’installèrent toutes trois chez la sœur, dans une tour HLM de Sevran.
La mère devait partir tous les matins à cinq heures pour rejoindre, en 90 minutes de train et de bus, la tour de bureaux de Disneyland où un contremaître malien la terrorisait. Elle rentrait tard le soir après sa journée de ménages, retrouvant ses deux filles qui, la journée durant, avaient été livrées à elles-mêmes et à l’école publique et obligatoire. Mais dans cette école, il n’y avait ni robe ni chansons.
Cette existence de galère dura une dizaine années, que chacune vécut bien différemment. La mère, résignée, parvenait à faire bonne figure face à la fatigue et aux vexations, grâce à son inébranlable foi en Dieu. Marguerite, toute à la nostalgie de son village d’enfance, s’accrochait désespérément à l’école, malgré tous les obstacles qu’il lui fallut surmonter. Elle obtint brillamment son brevet, alors que l’image enchantée de la robe et des chansons ne l’avait jamais quittée. Quant à la sœur aînée, que le charme de l’éducation nationale n’avait guère réussi à éblouir, elle se trouva vite un autre lieu d’épanouissement dans une des bandes du quartier où d’habiles pédagogues l’aidèrent à gravir les échelons de la délinquance.
Vint enfin le temps des premières vacances au pays. Marguerite retrouva Violette qui rentrait à l’école normale, se préparant à une carrière d’institutrice. Tout en elle témoignait d’une heureuse continuité allant de l’insouciance de l’enfant aux bonnes résolutions, modestes et raisonnables, de la jeune fille. Mais chez Marguerite, les épreuves et le déracinement avaient forgé une volonté de fer qui ne s’accommodait plus des limites du cadre villageois. Elle postula pour une bourse et partit poursuivre ses études à Montréal.
Et que devint Pervenche, la sœur aînée ? Eh bien, la société africaine la reprit en mains. Elle fut prestement mise en rééducation chez une tante sévère où l’on travaillait la terre du matin au soir et où l’on ne faisait qu’un repas par jour. Ce traitement vigoureux, qui aurait été impensable en Seine-Saint-Denis, réussit là-bas au-delà de toute espérance. Elle est aujourd’hui mariée, bien installée et surtout élève ses quatre enfants de manière exemplaire. Elle a gardé des souvenirs précis du 9-3 et de ses miasmes dont elle me parle avec le ton d’un alcoolique guéri et repenti.
Quant à Marguerite, elle dirige aujourd’hui une importante société d’import-export. Elle m’a raconté sa passionnante histoire autour d’une bouteille de champagne. Nous avons beaucoup parlé d’Abidjan et de ce que nous pourrions faire pour aider au développement de cette Côte d’Ivoire que nous aimons. Et nous y avons glissé quelques considérations sur l’éducation des filles.
Violette, Marguerite, Pervenche, trois chemins que je laisse à mes chers lecteurs le soin de dénouer. Aucun ne risque de figurer comme exemple dans un programme des Nations Unies. Et je sais pourquoi tous ces programmes resteront arides et sans consistance : c’est qu’il n’y est question ni de robe, ni de chansons.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
- Experts, scientifiques, charlatans et bonimenteurs (II) (06/05)
- Experts, scientifiques, charlatans et bonimenteurs (I) (29/04)
- Cette Dame qu’on veut Nôtre (22/04)
- La seconde de mes deux morts de Charles Gide (15/04)
- La première de mes deux morts de Charles Gide (08/04)
- Scandale du parachute doré à Audiens : récurrence du superlucratif dans le non lucratif (01/04)
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, notamment en lien avec l’ESS.


































Rétroliens/Pingbacks