
Haruki Murakami et les musiques du hasard

CRITIQUE – Les éditions Belfond ont publié simultanément deux ouvrages de Haruki Murakami, deux condensés d’une œuvre si particulière, au singulier. Première personne du singulier est un recueil de huit nouvelles aux accents autobiographiques, Abandonner un chat. Souvenirs de mon père livre avec pudeur les souvenirs du père en instantanés de vie. Des mots poétiques, l’émotion à fleur de texte.
Haruki Murakami est un homme discret, voire secret, peu enclin à laisser la porte s’entrouvrir sur l’intime. Ses deux derniers livres, Première personne du singulier et Abandonner un chat, s’aventurent sur le terrain du « je », cèdent du terrain à la transparence et nous parlent de l’auteur en touches pointillistes, en fragments de nostalgie. Est-ce la réflexion d’un homme vieillissant ? L’expression d’une sensibilité si humaine ? Il est vrai qu’une lancinante réflexion sur l’identité traverse son œuvre : comment se dessinent les contours du « je » ?
Qui est « je » ?
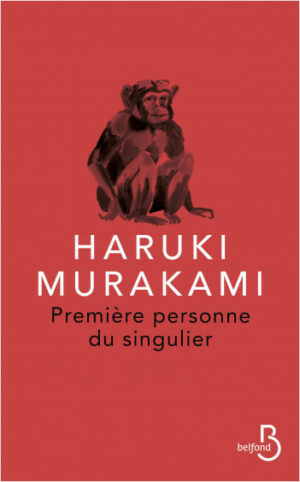 Première personne du singulier est un recueil de nouvelles qui peut se voir comme une autobiographie en éclats. Les gimmicks de l’auteur, ses petites mélodies intérieures, s’y retrouvent : les notes de jazz, les coups de batte de base-ball, l’écriture, des hommes perdus, des femmes résolues et l’inévitable musique du hasard.
Première personne du singulier est un recueil de nouvelles qui peut se voir comme une autobiographie en éclats. Les gimmicks de l’auteur, ses petites mélodies intérieures, s’y retrouvent : les notes de jazz, les coups de batte de base-ball, l’écriture, des hommes perdus, des femmes résolues et l’inévitable musique du hasard.
Dans « Sur un oreiller de pierre », le narrateur se souvient d’une jeune femme rencontrée alors qu’il n’avait pas vingt ans, là où il travaillait en marge de ses études. Une nuit passée avec elle lui a laissé un recueil de haïkus et le nom d’un autre homme qu’elle criait pendant l’amour – « Un simple nom peut parfois être source d’un intense bouleversement. »
« La crème de la crème » relate un rendez-vous manqué, peut-être une méchante blague, et l’étrange chemin qui a mené le narrateur dans un petit parc vers un vieil homme qui eut ces mots énigmatiques : « Un cercle qui possède un grand nombre de centres. » Le jeune homme qu’il était à l’époque s’est-il vu révéler le sens de l’existence ?
Sur de sémillantes notes de bossa-nova et de tubes des Beatles, l’auteur, dans « Charlie Parker plays bossa-nova » et « With the Beatles », se penche sur les rêves avortés et le temps qui passe.
« Ce que je trouve curieux dans le fait de vieillir, ce n’est pas que moi-même je prenne de l’âge. Et pas non plus que le jeune moi du passé soit devenu vieux, avant même que j’en aie eu conscience. Je suis plutôt déconcerté de voir comment tous ceux de ma génération ont vieilli, comment les jolies filles, si pleines d’entrain que je connaissais, sont à présent assez avancées dans la vie pour avoir deux ou trois petits-enfants. »
En se souvenant de la première équipe de base-ball dont il a été fan, les Yakult Swallows, l’auteur revient sur ses débuts en écriture et le recueil de poèmes dédiés à son équipe, recueil qui n’a intéressé aucun éditeur et est devenu objet de collection une fois le nom de son auteur au firmament. Il s’attache également à la leçon tirée des nombreux matchs perdus, véritable sagesse de vie : « Car dans la vie il y a plus de défaites que de victoires. Et la véritable sagesse consiste davantage à apprendre à être un bon perdant qu’à savoir vaincre. »
La très belle et déconcertante nouvelle « La confession du singe de Shinagawa » met le narrateur en présence d’un singe-serviteur dans une antique auberge thermale. À l’instar d’amis perdus de vue de longue date, ils passent la nuit à fumer et à boire en dissertant sur la vie, l’amour et l’étrange rituel dudit singe qui, pour satisfaire ses désirs inassouvis, vole aux femmes qu’il aime une partie de leur nom.
Première personne du singulier pose la question de l’identité. Le narrateur a pour manie de revêtir un costume-cravate de temps à autre, pour une heure, et de déambuler dans la ville, au hasard. L’interrogation effleure le décalage qui peut exister entre l’être intérieur et l’être extérieur, entre qui nous sommes et l’image que nous renvoyons au monde, ce subtil pas de côté qui fait que l’on ne se sent pas toujours soi-même. Si je suis une première personne du singulier, qui est donc le reflet dans le miroir ? Qui aurais-je été si j’avais pris une autre direction ?
Les instantanés d’une vie
 La question de l’identité est aussi au cœur de Abandonner un chat : qui est ce « je » de hasard ? Par quoi se définit-il ? Cette question est venue bouleverser Haruki Murakami à la mort de son père, avec qui le dialogue était rompu depuis plus de vingt ans, et l’a poussé à réfléchir à la filiation et au sens de sa vie.
La question de l’identité est aussi au cœur de Abandonner un chat : qui est ce « je » de hasard ? Par quoi se définit-il ? Cette question est venue bouleverser Haruki Murakami à la mort de son père, avec qui le dialogue était rompu depuis plus de vingt ans, et l’a poussé à réfléchir à la filiation et au sens de sa vie.
« Bien entendu, j’ai de nombreux souvenirs de mon père. Comment pourrait-il en être autrement, étant donné que, depuis ma naissance et jusqu’à ce que je m’envole du nid à dix-huit ans, nous avons vécu côte à côte dans notre modeste demeure? Et comme il en va de même, je suppose, pour la plupart des pères et des fils, certains de ces souvenirs sont heureux, d’autres beaucoup moins agréables. Mais ceux qui me restent les plus vivants en mémoire n’appartiennent à aucune de ces catégories. Il s’agit plutôt de scènes parfaitement ordinaires de la vie de tous les jours. »
Les scènes choisies par l’auteur nous dressent le portrait d’un homme que son fils tente de comprendre, tente de cerner pour en vérité se définir, lui. L’exercice est autant pudique qu’émouvant.
Il y a le regard, inoubliable, lancé par le père à la chatte qu’il venait d’abandonner sur la plage à deux kilomètres de la maison familiale. La chatte était dans le jardin au retour du père et du fils. Haruki Murakami se souvient du regard stupéfait et admiratif de son père saluant le courage de l’animal.
Il y a la passion de son père pour les haïkus, beauté et épure en rempart à la brutalité de la guerre pour laquelle il a été enrôlé à l’âge de vingt ans faute d’avoir rempli les papiers nécessaires, une guerre dont il reviendra meurtri et dont il racontera à son fils un unique épisode, l’exécution d’un prisonnier chinois dont il a trouvé l’attitude exemplaire.
« Le lourd fardeau que portait mon père depuis très longtemps – un traumatisme, selon la terminologie actuelle -, il me l’a en partie transmis. À moi, son fils. C’est ainsi que fonctionnent les relations humaines, c’est ainsi que fonctionne l’histoire. Il s’agit d’un transfert d’héritage, et aussi d’un rituel. »
Chiaki Murakami est né en 1917, deuxième fils d’une fratrie de six garçons. Son père étant prêtre, il était destiné à suivre la même voie. La guerre en a décidé autrement, il est devenu professeur de japonais. Son parcours scolaire fut excellent, il adorait étudier et en attendait autant de son fils. Mais le fils ne s’implique avec passion que dans les domaines qui lui plaisent, conscient de ne pas répondre aux espoirs de son père – y répond-on jamais ?
« Encore aujourd’hui, oui, à ce jour encore, je continue d’éprouver la sensation – ou tout au moins des résidus de celle-ci – d’avoir toujours déçu mon père, d’avoir trahi ses espérances. »
Malgré les multiples divergences qui se sont amplifiées au fil du temps jusqu’à la rupture de dialogue – « Notre ressemblance tenait peut-être au fait qu’il nous était impossible d’exprimer nos pensées directement. » –, l’auteur se rend compte du lien indéniable qui existe entre son père et lui, un lien tissé de ces petits riens qui l’ont formé, qui ont fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui.
« Je suis le fils ordinaire d’un homme ordinaire. C’est parfaitement évident. Mais au fur et à mesure que j’ai approfondi cette réalité, j’ai été convaincu que nous sommes tous le fruit du hasard, et que tout ce qui a eu lieu dans ma vie et dans celle de mon père a été accidentel. Et pourtant, nous, les humains, ne vivons-nous pas en considérant comme la seule réalité possible ce qui n’est après tout que le simple fait du hasard ? Autrement dit, chacun de nous n’est qu’une goutte de pluie, anonyme parmi une multitude de gouttes qui tombent sur une vaste étendue de terre. Juste une goutte. Une goutte unique, qui possède son individualité, mais qui peut être remplacée. Et chacune de ces gouttes a ses propres sensations, elle a sa propre histoire et elle a la responsabilité de transmettre ce dont elle a hérité. Nous ne devons pas l’oublier. »
Le court opus est superbement illustré par Emiliano Ponzi dont le dessin se caractérise par des lignes épurées, des à-plats de couleurs fortes, des personnages aux visages peu définis. L’univers de l’artiste se marie à merveille à celui de l’auteur qui se pique d’approcher l’essentialité de la vie, qui illumine la banalité de la réalité d’éclats de fantastique. Chez l’un comme chez l’autre, place est laissée à notre imagination.
Première personne du singulier et Abandonner un chat contiennent l’essence de l’écrivain et de l’homme Haruki Murakami, à savoir une réflexion sur ce qui fonde l’humain et sur les petites musiques du hasard. L’auteur se penche sur le passé, levain agissant qu’il nous faut accepter, non regretter, qui éclaire notre présent pourvu que nous lui accordions de l’attention. Interroger la réalité, notre rapport au monde, regarder le père, c’est se regarder soi et avoir la possibilité de dissiper les ombres. Mais, attention, point n’est besoin de tout comprendre, laissons les mystères de la vie l’enchanter, parce que ressentir est suffisant, comme l’exprime Haruki Murakami à propos de l’écriture : « Dans mon domaine, l’écriture, ce qui compte davantage que l’intelligence, c’est la liberté d’esprit, l’acuité de l’intuition. »
.
Haruki Murakami, Première personne du singulier, trad. Hélène Morita, Belfond, 2022, 15p., 21€
Haruki Murakami, Abandonner un chat. Souvenirs de mon père, trad. Hélène Morita, Belfond, 2022, 64 p., 17€
.
DÉCOUVRIR TOUTES NOS CRITIQUES DE LIVRES

































