
Francophonie : les forces en présence
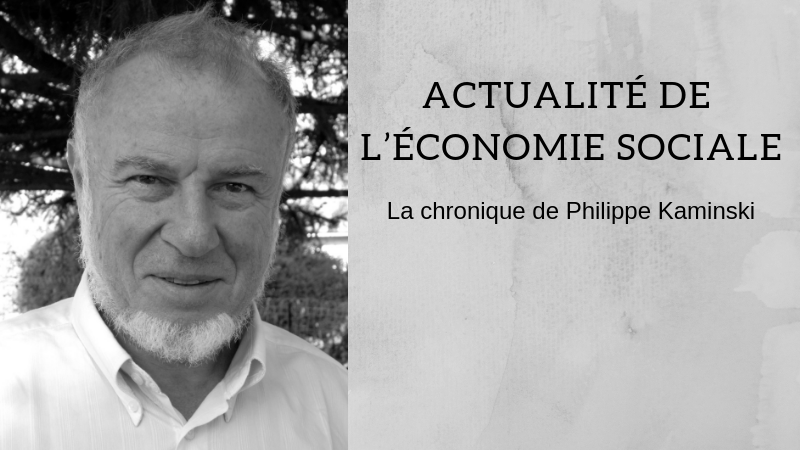
À une époque où la diversité est louée unanimement, qu’elle soit sociale ou culturelle, la langue française fait l’objet d’un assaut récurrent d’ennemis, y compris en son sein. Comment expliquer un tel paradoxe ?
Actualité de l’économie sociale
Donc, l’édition 2022 du mois de la Francophonie sera morose, et ce n’est pas l’Économie Sociale qui pourra contribuer à l’égayer. Mais profitons-en pour faire un tour d’horizon, en nous limitant au territoire français métropolitain, des différentes forces en présence et des différents théâtres d’opérations.
Ceux-ci sont, en première analyse, au nombre de cinq, fatalement quelque peu interdépendants :
– la défense de la langue française proprement dite, notamment contre l’invasion des anglicismes et américanismes ;
– la défense des langues régionales, des accents et des expressions locales ;
– la défense et la promotion de l’utilisation du français dans les relations internationales ;
– la promotion de la « préférence francophone » dans les domaines les plus divers de l’activité économique, des relations sociales ou de la vie culturelle ;
– enfin, la Francophonie arborant sa majuscule, c’est-à-dire les institutions officielles et au premier rang, bien sûr, l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie).
Ne nous attardons pas sur la question de savoir au nom de quoi certains, peu nombreux, sont prêts à mouiller leur chemise pour la langue française, alors que d’autres n’en font aucun cas. Ne cherchons pas non plus à étendre à l’infini notre problématique vers la sociologie, la géopolitique ou l’histoire longue ; qu’il nous suffise de décrire qui fait quoi, qui est fort et qui ne l’est pas, où sont les blocages et où sont les atouts, enfin quelles sont les perspectives d’évolution.
Bientôt soixante années se seront écoulées depuis la parution du pamphlet d’Étiemble, Parlez-vous franglais ? En ces soixante ans, combien le monde a changé ! Le mot de francophonie n’existait pas encore. Et cependant, le diagnostic porté alors n’a pas vieilli. La situation de la langue française s’est certes fortement aggravée, mais la nature des attaques qui lui sont portées, leur provenance, leur délétère récurrence ne semblent pas avoir varié d’un iota. Notre sinologue rimbaldien et trotskyste avait parfaitement décrit la rage d’une partie des élites françaises à dénigrer leur langue, à s’y essuyer les pieds, et à lui préférer en toute circonstance le sabir atlantique, si moderne, si efficace, si friendly.
Cette permanence de la corrosion du français par ceux qui devraient naturellement en être les plus fidèles soutiens semble défier les facteurs démographiques, économiques ou technologiques qu’on met généralement en avant pour expliquer l’évolution des sociétés. Il semblerait qu’il en soit de même pour les quelques Hurons qui défendent notre langue avec acharnement. Il faut rester prudent en la matière, car ils sont trop peu nombreux pour relever d’une analyse statistique. Néanmoins on reste frappé, quand il arrive de discuter avec certains, de voir combien ils en sont restés à la France des années Étiemble. Ils cultivent une sorte de nostalgie suraiguë d’un âge d’or du rayonnement français qui n’a jamais existé, ou alors au temps lointain de Rivarol.
Pourtant, les mouvements d’opinion en faveur de la préservation des sites, des espaces naturels ou du patrimoine en général rencontrent de plus en plus d’écho. D’où vient que la langue française n’en profite pas ? C’est que, je pense, les trésors à protéger ont affaire à des pollueurs, parfois conscients, parfois non, alors que le français subit, en plus, l’assaut de véritables ennemis. Et il est plus facile de se liguer contre des comportements que tout le monde condamne que contre des adversaires déterminés qui font montre d’une certaine logique.
Prenons le cas des océans, qui viennent de faire l’objet d’un sommet international. La nécessité de les protéger a peu à peu gagné l’ensemble des esprits ; cela n’a pas fait disparaître la pollution, mais la majorité des pollueurs admet désormais que c’est mal de dégrader l’environnement marin et qu’il leur faudra nécessairement, plus ou moins vite, changer de comportement. Et s’il existe toujours des pollueurs cyniques et retors, il n’en sera néanmoins aucun pour revendiquer ses pratiques haut et fort, et proclamer que l’océan est intrinsèquement mauvais, donc qu’il est bien de l’abîmer. Or c’est ce qui se passe avec la langue française.
Car si certains la voient comme un monument en péril, si la grande majorité de ses locuteurs y sont relativement indifférents, si les institutions censées la défendre se défaussent trop souvent de leurs responsabilités, il existe des minorités actives qui la perçoivent comme une puissance oppressive à abattre. Ces dernières années, deux mouvements sont venus renforcer cette mouvance qui était jusqu’ici surtout le fait des publicitaires, de la presse féminine et des écoles de commerce : le courant dit « décolonial » et l’écriture dite « inclusive ».
Face à cette offensive, le rempart législatif et réglementaire apparaît particulièrement ténu. La « loi Toubon », qui était dès l’origine mal ficelée, n’est plus guère appliquée. Durant une première période, déjà lointaine, les associations habilitées à signaler les manquements les plus visibles à l’obligation de s’adresser au public en français ont pu, à travers une structure ad hoc dénommée « Droit de comprendre », faire systématiquement condamner les contrevenants par les tribunaux. Mais un beau jour, la Direction chargée de la répression des fraudes (DGCCRF), manquant de moyens, décida de ne plus s’occuper des dossiers ne portant que sur la loi Toubon. Il n’y avait sans doute pas là de mauvaise intention, mais personne n’ayant pris le relais, les associations se sont retrouvées seules, sans soutiens techniques ni juridiques, et surtout sans argent. Elles ont rapidement baissé les bras. Si elles avaient pu recruter des milliers d’adhérents, nul doute qu’elles auraient pu rétablir un rapport de forces en leur faveur. Mais nous revenons là au problème précédent…
Aujourd’hui, les procès sont rares, et souvent perdus. Les juges semblent ignorer la loi, ou alors ils sont persuadés que le combat pour le français est une lutte d’arrière-garde et que de toutes façons le globish triomphera. C’est ainsi que l’École normale supérieure, qui avait mis en place un cursus d’enseignement entièrement en anglais, a non seulement gagné son procès contre une association qui ne faisait que la rappeler à la loi, mais a obtenu d’elle, en plus, un dédommagement, récupérant ainsi à son profit la maigre subvention que l’État avait versé à cette association. Un comble !
Il existe une Commission de terminologie qui est chargée de proposer des équivalents français aux différents termes nouveaux, presque toujours anglo-saxons, qui accompagnent les innovations techniques et les progrès des sciences. Les avocats des administrations et collectivités prises en flagrant délit (ou plutôt en flagrant délire) de franglitude ont forgé un argument spécieux en faveur de leurs clients : si un terme étranger n’est pas traduit par la Commission de terminologie, c’est qu’il est libre d’utilisation par un service officiel. Et des juges ont gobé cette ânerie. Sont bien entendu dans ce cas tous les mots anglais d’usage courant : let’s conduisant à l’affreux Let’s Grau qui souille Le Grau-du-Roi, only qui nous a donné le stupide palindrome Only Lyon qui désespère Perrache ou easy qui nous transporte d’aise dans le RER avec le passe easy navigo.
Face à la démission de la Justice, que peut-on espérer des institutions ? L’Académie française est, très récemment et pour la première fois, montée au créneau. Il faut s’en réjouir, mais cela reste très limité. Rien ne bougera, me semble-t-il, sans un mouvement populaire d’une certaine ampleur. Reste à savoir comment le susciter, et là, j’avoue ne pas connaître la recette miracle.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– La francophonie des giboulées
– Tu finiras PAD, mon fils
– Dansons la densité
– Une Clef peut-elle en cacher une autre ?
.
Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































