
FABER LE FABERRANT
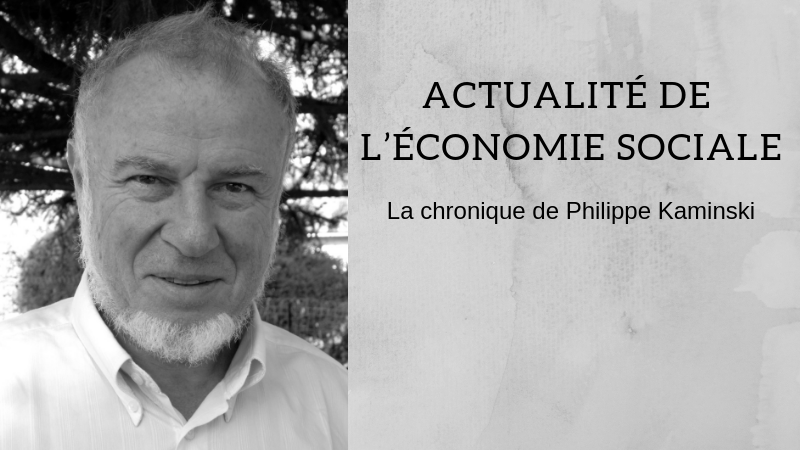
Danone vient d’annoncer un plan de licenciements qui met à mal son image d’entreprise philanthropique, proche de l’économie sociale, défendue par son président-communicant-fabulateur éthique, Emmanuel Faber. L’occasion de se rappeler que l’ESS ne se juge pas à ses intentions, réelles ou auto-proclamées, ni à son « impact social », mais d’abord à ses règles de fonctionnement.
Actualités de l’économie sociale
Dès que j’ai appris l’existence d’un plan de licenciements chez Danone, j’ai pensé composer une petite chronique assassine sur cette entreprise modèle et sur son PDG (pardon, sorry, son CEO), l’impayable Homo Faber, jailli bien avant Cro-Magnon du tréfonds des forges de Vulcain pour parcourir à la vitesse de l’éclair (surgelé) la courbe de l’Évolution et devenir l’Homo Sapiens Omnibenevolens dont tous les jeunes HEC doivent désormais s’inspirer.
Las, beaucoup d’autres manieurs de plume ont eu la même idée. Et tous ces commentateurs, de quelque bord qu’ils se réclament, se sont gaussés avec plus ou moins de malice de la mésaventure de ce flamboyant Faber, champion des discours de responsabilité sociale et environnementale, obligé de céder devant le froid réalisme de ses actionnaires qui font passer la rentabilité des capitaux investis avant le lyrisme sociétal.
Certainement, Faber le fabulateur en avait trop fait, irritant aussi bien les classiques pour lesquels l’entreprise doit d’abord satisfaire ses clients et gagner de l’argent, le reste n’étant que fioriture, et les sceptiques pour lesquels les proclamations généreuses de l’entreprise Danone ne pouvaient être que du boniment, toutes les sociétés cotées en Bourse étant par nature des monstres assoiffés de profit.
Même les idéalistes, ceux qui espèrent voir l’entreprise et les bonnes intentions se donner bientôt la main pour convoler vers un monde idyllique de bonheur partagé, qui portent aux nues depuis des années le fabuleux Faber, voyant en lui le chevalier immaculé et invincible de l’éthique managériale nouvelle, se résignent et laissent entendre qu’il faudra aller se chercher ailleurs un autre modèle.
Aussi fort que soit mon désir naturel de me distinguer du consensus dominant, je ne puis cette fois que me ranger à l’avis général. Et m’efforcer néanmoins de trouver d’autres angles d’approche.
*
D’abord, il est stupide, et stérile, de donner à la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) et au profit une dimension morale, la première étant le Bien, le second un Mal plus ou moins nécessaire.
Jadis, la fierté du métier, l’excellence professionnelle, le fait d’acquérir et de conserver une bonne renommée, s’imposaient naturellement à toute entreprise et constituaient pour elle, au même titre que le profit, sa raison d’être. Il n’y avait pas besoin de théoriser une quelconque RSE ; ces choses allaient de soi.
Mais, à mesure que l’entreprise se multinationalise, se financiarise, qu’elle se sépare au gré des foucades du marché de pans entiers de ses activités et qu’elle en achète de nouvelles, que les marques les plus connues passent de mains en mains, la notion ancestrale de métier perd de sa consistance. Un vide se crée alors. L’entreprise, ou plutôt le groupe, ressent le besoin de se définir, de se donner une finalité, une identité qui perdure au-delà des modifications incessantes de son périmètre. D’où la naissance de la RSE, qui avant de devenir une obligation bureaucratique et le terrain d’expression des communicants, visait à combler le vide laissé par la disparition du métier.
Cette disparition peut être complète, et c’est le cas de Danone, ou seulement esquissée, notamment lorsque deux activités voisines ou complémentaires se trouvent réunies à la suite de fusions. Mais les publicitaires semblent ne pas faire ce genre de distinction ; tous les groupes suivent les mêmes modes, utilisent le même vocabulaire. Une banque restera une institution financière, même si elle fait aussi de l’assurance ; un pétrolier qui se diversifie dans le gaz liquéfié ou l’électricité restera un énergéticien. Mais dans leur RSE, ils deviendront l’une et l’autre des « équipes d’hommes et de femmes unies par le même engagement à construire ensemble une société accueillante, résiliente, inclusive et décarbonée ». Chez Danone, il ne subsiste qu’un seul produit, le yaourt, qui se soit perpétué dans l’entreprise depuis les origines. Tout le reste, l’emballage, le verre, les biscuits, les potages, les plats cuisinés, la bière, les pâtes, les fromages, avec dans chaque cas des marques emblématiques, a été absorbé puis cédé, acheté puis revendu. Le groupe a été présent en Chine avec une gamme de produits, s’est retiré du pays, y est revenu plusieurs années après avec des produits entièrement différents. On comprend que l’identité de l’entreprise n’ait pas toujours été évidente à percevoir. Il y avait donc de forts besoins et, pour y répondre, un virtuose du discours humanitaire et de l’emphase théâtrale comme était l’Homo Faber ; on comprend dès lors que Danone ait été le paradis de la RSE dans sa version hallucinée.
L’empire Danone a été façonné par la dynastie Riboud, le patriarche Antoine puis son fils Franck. Quand Faber est arrivé en 2014, le tsunami financier était déjà passé plusieurs fois en France ; il le transportera à l’étranger, notamment aux États-Unis, où acquisitions et cessions se firent à un rythme d’enfer. L’actionnariat devint lui aussi, conséquemment, de plus en plus international. Et les actionnaires américains ne sont pas, contrairement à ce que l’on pense souvent, que des activistes spéculateurs. Ce sont pour l’essentiel des caisses de retraite, très sensibles aux questions d’éthique et de bien-pensance environnementale, mais aussi de rentabilité, car elles ont des pensions à verser régulièrement à leurs souscripteurs. Sur le premier point, Faber avait de quoi les satisfaire, même s’il avait tendance à en faire un peu trop. Mais il n’était pas question pour autant d’oublier le second point, et il n’y avait rien de plus normal que cela soit rappelé à Faber. Les âmes sensibles auront jugé que cela s’est passé de manière brutale, voire inhumaine ; disons que c’était de manière capitaliste, et il n’y a rien à ajouter.
À part cela, Danone n’est ni meilleur, ni pire que son grand rival Nestlé, ou que ses concurrents américains. Danone dépense des fortunes en publicité, use de toutes les ficelles de la mercatique pour exploiter au mieux la crédulité du consommateur, se débarrasse des produits à faible marge et appelle « innovation » tout ce qui peut lui permettre de les augmenter. Il se permet de jouer sur les mots « nature » et « naturel » dans sa communication, tout en utilisant à foison colorants, arômes artificiels, exhausteurs de goût et conservateurs que ses laboratoires de recherche ne cessent de perfectionner. Et son service de réponse aux consommateurs est champion toutes catégories de la langue de bois, de la dissimulation et de la défausse. Mais, je me répète, Nestlé et les autres en font autant.
*
Quant à la fameuse loi PACTE qui a introduit le statut spécifique d’entreprise « à mission », il serait bon qu’elle ne sorte pas indemne de l’affaire. L’objectif, au moins implicite, était de distinguer parmi les entreprises capitalistes celles qui, par leurs finalités, pourraient être rapprochées de l’Économie Sociale. Le seul fait d’avoir choisi (entre autres) Danone montre que le législateur, ainsi que les instances chargées d’appliquer la loi, n’ont rien compris à ce qu’est l’Économie Sociale.
Celle-ci ne se juge pas à ses intentions, réelles ou auto-proclamées, ni à son « impact social ». Elle se juge d’abord à ses règles de fonctionnement, et surtout à ses fruits, qui se nomment entre autres préférence pour l’activité, maintien de celle-ci, stabilité, territorialité ; tout le contraire de ce que fait Danone, qui privilégie l’instant, la mobilité, le changement. Il est des secteurs de l’économie où ces qualités-là sont supérieures aux précédentes ; mais pour ce qui est des produits alimentaires de grande diffusion, on peut en douter.
Ceux qui ont un certain âge se souviennent de ce qu’ont pu représenter, au fil de leur jeunesse et des années qui ont suivi, puis pour leurs enfants, voire leurs petits enfants, des produits emblématiques comme le Carambar, la bière Kronenbourg, les petits beurre LU, les pâtes Panzani… Derrière chacune de ces marques qui ont défié le temps et traversé les générations, on imagine volontiers une entreprise, une usine de fabrication qui a la même durée, et derrière, une famille qui se transmet la propriété de l’usine de père en fils ou de mère en fille. Ou pourquoi pas, ici ou là, une coopérative ouvrière. Il ne nous apporte rien en revanche d’apprendre que ces marques ont été rachetées par Danone, malaxées dans des structures financières puis revendues à d’autres groupes pour faire de la plus-value. Cela nous fait à peu près la même chose que quand nous avons compris que le père Noël n’existe pas.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Don, contredon et abandon
– Mais qu’est-ce qui nous fait courir ?
– Lettre à Paul St-Pierre Plamondon : “Il vous faudra innover, tout en retrouvant vos racines”
– Solidaire ou solitaire ?
– Retour à l’émancipation ?
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































