
Enquête sur les dérives néfastes du contrat de coréalisation
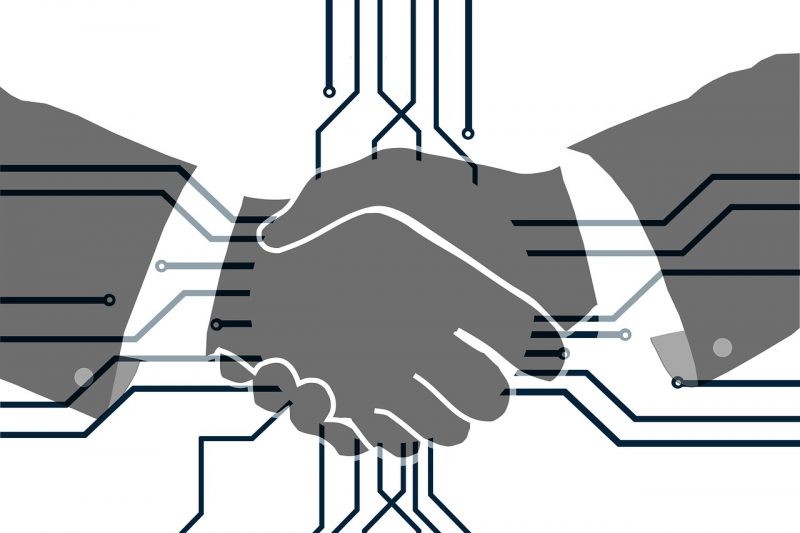
Le contrat de coréalisation est de plus en plus utilisé par des théâtres, du fait de l’accroissement de la demande et de l’émergence de nombreux lieux de spectacle à petite capacité. Profession Spectacle a mené une vaste enquête, recueillant de nombreux témoignages sur les dérives d’un tel fonctionnement du point de vue des artistes* : le contrat de coréalisation, souvent proposé aux novices, cache en effet parfois une réalité autrement différente de ce que suppose le terme « co-réalisation ».
Mise à jour : avril 2019
Entre désillusion et loi du marché, quels sont les risques liés à un tel contrat et quelle logique préside à son expansion actuelle, surtout à Paris et Avignon ?
Quand un théâtre décide de représenter un spectacle, trois types de contrats sont à sa disposition : le contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle, le contrat de coproduction et le contrat de coréalisation. Ce dernier, sous couvert d’offrir la possibilité à une troupe ou à un artiste de jouer, contient des risques rarement énoncés avec clarté.
Cession des droits et/ou coproduction
Tout contrat est conclu entre producteur (celui qui fournit le spectacle) et un organisateur de spectacles (le théâtre), aussi appelé le diffuseur.
Dans le contrat de cession de droits d’exploitation, aussi appelé contrat de vente de spectacle :
- le producteur s’engage à donner, dans un lieu dont dispose l’organisateur, un certain nombre de représentations moyennant une somme forfaitaire. Il dispose du droit de représentation du spectacle, c’est-à-dire qu’il confirme avoir passé avec les auteurs des conventions de cession de leurs droits. Il prend à sa charge toutes les formalités liées à son statut d’employeur de plateau : embauche, rémunérations, etc.
- l’organisateur fournit le lieu de représentation en ordre de marche : plateau technique, personnel au service des représentations…
Un tel contrat est parfois le complément d’un contrat de coproduction ; il est alors l’aboutissement des relations entre le producteur et le coproducteur. Son intérêt est que, le producteur étant payé au forfait, il ne subit aucun risque financier si le spectacle ne fait pas un nombre d’entrées important. L’organisateur, quant à lui, n’a pas à réaliser un partage des recettes, la vente du spectacle étant réglée sur la base d’un forfait et non de manière proportionnelle.
Le contrat de coproduction a pour but de réunir plusieurs partenaires en vue de concevoir, financer, produire et exploiter une création. Il permet donc de regrouper des moyens financiers et matériels pour monter le spectacle et lancer son exploitation. Il est généralement le fruit d’une relation à moyen terme, liée à un contrat de cession ou de coréalisation. Le coproducteur joue un véritable rôle d’accompagnateur artistique auprès du producteur (compagnie, troupe, artiste).
Spécificités du contrat de coréalisation
Dans un contrat de coréalisation deux conditions sont requises :
- le producteur apporte, moyennant une quote-part de la recette réalisée par le spectacle, un spectacle entièrement monté ;
- l’organisateur fournit le lieu de représentation en ordre de marche, c’est-à-dire le plateau technique, y compris le personnel nécessaire au déchargement et rechargement, montage et remontage, et au service des représentations.
La différence avec le contrat de cession réside dans le mode de règlement du prix de vente du spectacle. Dans un contrat de cession, le producteur perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de la vente, tandis que dans un contrat de coréalisation, il perçoit une rémunération proportionnelle aux recettes, assortie ou non d’un minimum garanti. A la sécurité du premier contrat répond les incertitudes du second.
Contrairement à la coréalisation, le contrat de coproduction consiste en un apport de la part d’un coproducteur pour la création du spectacle, avant la signature de contrat permettant la diffusion du spectacle, c’est-à-dire pendant la phase de production du spectacle.
Quant au contrat de coréalisation, il est surtout bénéfique à l’organisateur puisqu’il lui permet de minimiser les risques d’exploitation en assurant un minimum garanti. Le producteur du spectacle gagne, quant à lui, le simple droit de jouer…
Une inavouable location de salle ?
Le contrat de coréalisation, utilisé massivement par de nombreux théâtres et lors de festivals – comme c’est le cas dans le Off d’Avignon –, apparaît comme la porte d’entrée vers un hypothétique succès pour bien des artistes et compagnies. Claude Vonin, violoniste et comédien, se souvient de l’expérience qu’il a tentée dans un théâtre du quartier latin : « Au niveau juridique, c’est propre. On nous propose d’avoir la chance de nous représenter à Paris et on nous fait miroiter un espoir. Mais en réalité le système est pernicieux. Si les recettes ne couvrent pas les frais de location de salle, l’artiste doit couvrir lui-même cette somme. »
« Location de salle »… le mot est lâché. Pourquoi ? Parce que l’avance d’argent donnée au théâtre par l’artiste et la non garantie de recettes à son égard reviennent à payer pour avoir une salle où se représenter. « Mon contrat stipulait que je devais remettre dix chèques équivalant à 50 % du coût de la salle en ordre marche pour la totalité des représentations, soit 6 700 euros hors taxes, plus un chèque de 800 euros de garantie matériel, en cas de dégradation… tout ça pour 20 représentations seulement ! », raconte Ludmila**, metteure en scène et comédienne. Le théâtre, situé à l’ombre du Châtelet, lui promet d’ouvrir son réseau de journalistes et d’autres diffuseurs potentiels. « J’ai reçu le fichier presse deux jours avant la fin, une bonne moitié des contacts n’était pas actualisée. Au total, j’ai perdu plus de 3 000 euros. »
Au cours de notre enquête, nombreux sont les témoignages qui vont dans ce sens. En effet, la coréalisation est réelle quand les risques sont partagés, mais en cas de perte, l’artiste assume seul le coût financier. Le versement d’une garantie a priori, remboursée à la fin du contrat sauf si l’artiste doit de l’argent au théâtre, se retourne souvent contre lui. Le bilan est un travail artistique à perte. « Tous les artistes sont perdants dans ce système, confirme Claude Vonin. C’est d’autant plus difficile quand on se représente en solo car tout repose sur une seule personne pour la communication, préparer le spectacle, assurer les frais. »
Une carte de visite qui coûte cher
Finalement, la coréalisation ressemble à l’achat d’un service : une salle avec moyens techniques et techniciens. Pour Claude Vonin, la coréalisation théâtrale « permet avant tout d’acheter une carte de visite » : le CV mentionne les représentations à Paris, à Avignon… Les théâtres n’hésitent d’ailleurs pas à en faire leur accroche lors de la présentation du contrat, au risque de ne plus voir les enjeux financiers. Créer et se faire connaître, oui, mais à quel prix ? Ludmila, après avoir épongé sa dette, a ainsi dû renoncer à toute nouvelle mise en scène.
D’un côté donc, ce système s’apparente à une location de salle qui ne dit pas son nom ; de l’autre, le contrat se présente souvent sous un aspect bien différent de sa réalité. Les théâtres qui utilisent abondamment ce type de contrat semblent davantage faire commerce de spectacles, plutôt que remplir une mission de service public (c’est-à-dire de bien commun – il n’est pas ici question d’argent public), au service de l’art et la culture.
Notoriété renversée
Si la notoriété d’un théâtre se fonde normalement sur la qualité de ses représentations, et donc sur celle des artistes, le contrat de coréalisation renverse la donne : la notoriété d’un artiste tient dorénavant au lieu où il joue ! Le vice d’un tel fonctionnement est qu’il n’est dès lors plus besoin d’avoir du talent : l’argent ouvre les portes de certains lieux peu scrupuleux quant à la qualité.
C’est le cas de Victor*, qui a mis en scène une pièce contemporaine qu’il juge aujourd’hui mauvaise : « Mon travail était, avec le recul que me donne l’expérience, de piètre qualité. Je n’avais pas assez travaillé, mais ma jeunesse et mon enthousiasme me poussaient à passer à l’acte. Un véritable programmateur n’aurait jamais sélectionné ma pièce ; malheureusement, il y en a un qui l’a fait, quand il a vu que j’acceptais tous les termes du contrat. Je me suis retrouvé, à 25 ans, avec une dette de plusieurs milliers d’euros. » Il lui faudra près de trois ans pour s’en remettre. S’il regrette que sa pièce ait été représentée à l’époque, il préfère regarder aujourd’hui cet échec comme l’un des moteurs de sa création artistique actuelle.
L’envers du décor ou le marché du divertissement
Comment a-t-on pu en arriver à un tel système ? Il y a probablement une loi économique qui sous-tend la dynamique : le jeu de l’offre et de la demande. Le nombre grandissant d’artistes, de troupes et de compagnies, notamment grâce au régime de l’intermittence, a généré une forte demande, que l’offre – pourtant en augmentation, avec par exemple plus de 300 spectacles en moyenne rien qu’à Paris, contre 70 à la fin des années 60 – n’est guère en capacité de suivre.
Certains théâtres en profitent, voire en abusent. Il n’est ainsi pas rare que, les recettes des spectacles suffisant à peine à équilibrer leurs comptes, des théâtres choisissent logiquement d’augmenter leur nombre : et c’est ainsi que certaines standing ovation sont brutalement coupées par les comédiens eux-mêmes, en raison d’une pièce qui s’apprête à commencer dans la foulée. Le théâtre devient alors un marché de divertissements, où chacun vient consommer avant d’être sommé de quitter les lieux au plus vite, pour la mise en place d’un nouveau produit et l’accueil de nouveaux consommateurs.
Autre victime de l’ombre : les techniciens
Pire encore, cette logique de « produire plus pour gagner plus », qui anime certains théâtres, ne se fait pas au détriment des seuls comédiens : plusieurs techniciens – permanents ou intermittents – nous ont ainsi parlé de leurs conditions de travail déplorables. Il ne s’agit évidemment pas de faire une généralité. Toutefois, la pratique semble se généraliser parmi nombre d’entre eux.
Un jeune régisseur son et lumière, Jackson, nous fait part de sa douloureuse expérience dans un théâtre privé parisien : « Au niveau de ma charge de travail et proportionnellement à mon salaire, j’étais largement perdant ». Engagé en CDD, il gagne alors entre 1300 et 1400€ net, pour 11 à 12 heures de travail par jour. Un contrat en CDI, qui lui permettrait d’avoir des heures supplémentaires rémunérées, lui est constamment refusé. « Les spectacles s’enchaînaient, du mardi au dimanche, du matin au soir, certains commençant à 22h45 pour finir après minuit ». Se plaignant du rythme trop intense, il s’entend répondre : « Ça se passe comme ça dans le milieu du spectacle ! Si ça ne vous va pas, vous n’avez qu’à changer de métier ». Ce qu’il a dû faire, à son grand regret.
Si le contrat de coréalisation permet une mise en relation entre les producteurs de spectacle et les diffuseurs, il révèle dans le même temps une logique qui n’est pas sans interroger l’ensemble des pratiques inhérentes au spectacle vivant : l’accroissement du nombre d’intermittents, par exemple, fragilise les artistes et la création, en livrant les premiers aux mains de certains théâtres peu scrupuleux de leur travail ou de leur situation. Ils deviennent des proies idéales pour ces théâtres qui peuvent ainsi remplir leurs salles à perte, sans se soucier d’offrir à l’artiste un moyen de gagner sa vie par son art et non seulement grâce au régime mis en place par l’État, pour ceux qui sont intermittents. Comme le disait justement Beaumarchais, « pour pouvoir créer, encore faut-il au préalable pouvoir dîner ». Ce que la coréalisation ne permet généralement pas.
Louise ALMERAS & Pierre GELIN-MONASTIER
* Cet article traite les risques que le contrat de coréalisation comporte du point de vue des artistes, non des théâtres. Certains théâtres en usent et en abusent ; d’autres l’utilisent avec déontologie.
** Le prénom a été modifié.


































ce n’est pas le principe même du contrat de co-réalisation qui est en cause, mais bien son dévoiement…
au départ, ce type de contrat peut permettre d’échapper à un taux de TVA majoré applicable dans le cadre de vente d’une prestation de service. certains lieux, et non des moindres à Avignon (je ne peux pas me permettre de les citer), quasiment des lieux institutionnels, se font les champions de ces locations de salle déguisées, allant jusqu’à, pour certains, exiger à la charge des artistes accueillis l’accueil téléphonique du public et le gardiennage des lieux…… j’en ai fait l’amère expérience en qualité d’administrateur …..
Le problème de fond ne viendrait-il pas du fait qu’une salle ça se loue ? Tout comme on loue un appartement, une salle des fêtes pour un mariage…
Le problème ne viendrait il pas du fait à en croire l’article qu’il y a confusion entre un producteur et une salle (diffuseur selon votre article) ?
Le problème ne viendrait il pas de « l’esprit » français qui bien pensant ne peut accepter qu’il y a un marché ? Et qu’à force de s’en cacher il confond réalité et illusion.
Le problème ne viendrait il pas aussi du fait que les salles que vous incriminez et repris en cœur par les lecteurs/artistes sont aussi pauvres que ceux qu’ils reçoivent ?
Et lorsqu’un spectacle, par exemple en corealisation où l’artiste grâce à cela vend son spectacle, propose t’il de partager à la petite salle modeste une part de cette vente qu’il n’aurait pas obtenu sans l’aide de cette salle ?
Enfin vous parlez de « mission publique », sont elles aidées par l’état et les contribuables pour remplir cette fonction ? Et si oui sur un même pied d’égalité ?
Je pense que pour avoir une bonne vision des choses il faudrait egalement demander à l’autre partie leur point de vue, pour plus de pertinence. Car à priori il n’y a pas que d’un côté les tres méchantes salles et les tres gentils artistes.