
Elif Shafak tisse les légendes contre l’oubli

Dans son douzième roman, L’île aux arbres disparus (Flammarion), aux engagements toujours aussi passionnés, Elif Shafak nous enchante avec l’histoire d’un Roméo et Juliette chypriotes et questionne l’hérédité épigénétique tant de l’humain que du végétal. Entre onirisme et réalisme, elle nous ravit d’un « Il sera une fois… » riche de sagesses.
Elif Shafak est une auteure d’origine turque qui a le courage de ses opinions et celui de s’opposer au régime dictatorial imposé par Erdoğan. À ses yeux, la littérature est résistance et n’a pas de frontière ; tous ses romans témoignent de l’ardeur de ses engagements que ce soit pour donner une voix aux laissés-pour-compte, aux marginaux – voir Bonbon Palace et 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange –, encore pour, en intellectuelle féministe, militer pour le droit des femmes – voir La Bâtarde d’Istanbul, Crime d’honneur et Trois filles d’Ève. Ses prises de position politiques et sociales – elle a fait son coming-out en révélant sa bisexualité, un crime en Turquie – l’ont emmenée sur les routes de l’exil sans pour autant la réduire au silence. Elif Shafak continue ses combats et use de sa plume pour dire, dénoncer, hurler les abus, les injustices et les violences, avec son style unique qui mêle avec brio le rêve à la réalité.
« Il était une fois… »
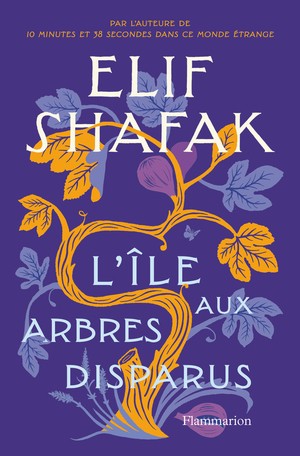 L’île aux arbres disparus est avant tout une histoire de l’amour sous ses diverses formes. Celui qui naît entre Kostas et Defne commence comme un conte de fées en l’an 1974 à Chypre, « une île si belle et si bleue que les nombreux voyageurs, pèlerins, croisés, marchands qui en tombaient amoureux souhaitaient ne plus jamais en repartir, ou tentaient de la remorquer par des cordes de chanvre jusque dans leur pays. » Kostas, le Grec, s’éprend de Defne, la Turque. Sur leur amour plane l’ombre d’une dette de sang qui fait d’eux des ennemis, c’est un amour maudit, un amour banni. Même si Kostas sait qu’il ne pourra jamais avouer à sa mère, très croyante et superstitieuse, qu’il aime une jeune Turque musulmane, il croit en un avenir et trouve un endroit pour rencontrer Defne loin de la malveillance de certains regards. Ils ont dix-sept ans, rien n’est impossible. Ils se retrouvent au Figuier Heureux, une taverne cosmopolite gérée par Yiorgos, un Grec, et Yusuf, un Turc, également un couple clandestin.
L’île aux arbres disparus est avant tout une histoire de l’amour sous ses diverses formes. Celui qui naît entre Kostas et Defne commence comme un conte de fées en l’an 1974 à Chypre, « une île si belle et si bleue que les nombreux voyageurs, pèlerins, croisés, marchands qui en tombaient amoureux souhaitaient ne plus jamais en repartir, ou tentaient de la remorquer par des cordes de chanvre jusque dans leur pays. » Kostas, le Grec, s’éprend de Defne, la Turque. Sur leur amour plane l’ombre d’une dette de sang qui fait d’eux des ennemis, c’est un amour maudit, un amour banni. Même si Kostas sait qu’il ne pourra jamais avouer à sa mère, très croyante et superstitieuse, qu’il aime une jeune Turque musulmane, il croit en un avenir et trouve un endroit pour rencontrer Defne loin de la malveillance de certains regards. Ils ont dix-sept ans, rien n’est impossible. Ils se retrouvent au Figuier Heureux, une taverne cosmopolite gérée par Yiorgos, un Grec, et Yusuf, un Turc, également un couple clandestin.
« C’était un lieu chargé d’histoire, avec ses petits miracles bien à lui. Ici, on partageait les récits des triomphes et des épreuves, on tirait un trait sur des règlements de compte anciens, le rire se mêlait aux larmes, des promesses et des aveux étaient confirmés, des péchés et des secrets confessés. Entre ses murs, des inconnus devenaient amis, les amis des amants, d’anciennes flammes se rallumaient, des cœurs brisés se réparaient ou se brisaient à nouveau. Nombre de bébés sur l’île ont été conçus après une soirée festive à la taverne. Le Figuier Heureux avait touché tant de vies de tant de manières insoupçonnées. »
Son nom lui vient du figuier poussant au milieu de l’espace dînatoire, un arbre symbole d’abondance, de richesse naturelle et de survie, gardien de la mémoire des hommes.
Ficus carica
Témoin de l’histoire des hommes, le figuier est l’une des principales voix du roman, voix organique qui est voix de sagesse.
« Les arbres sont des gardiens de la mémoire. Entremêlés à nos racines, cachés dans nos troncs, courent les tendons de l’histoire, les décombres de guerres où personne n’a rien gagné, les ossements des disparus. »
Les arbres s’enroulent autour des vestiges du passé, recueillent ce qui est tu, tel le figuier de la taverne venu au monde en 1878, qui a assisté à des agressions, à des guerres, qui a vu des troupes épuisées et assoiffées, des hordes de criquets, une bibliothèque réduite en cendres, la naissance de l’organisation nationaliste grecque – l’EOKA –, la résistance turque. Il a assisté, impuissant, à la partition de l’île en deux morceaux, le nord et le sud, en 1974, « une langue, une mémoire, un scénario différents s’imposaient de part et d’autre ». Il a assisté au départ de Kostas, poussé loin de l’île par sa mère terrorisée à l’idée de perdre un autre fils, Kostas si sensible, trop sentimental. Parti pour deux semaines, pense-t-il, chez un oncle à Londres, il ne reviendra que vingt-cinq ans plus tard, retenu là-bas par le silence de Defne et parce que « les ponts n’apparaissent dans nos vies que lorsque nous sommes prêts à les franchir ».
Les renaissances
Vingt-cinq ans ont passé sans altérer en rien les sentiments qu’éprouvent Defne et Kostas l’un pour l’autre. Kostas est devenu spécialiste de la botanique évolutive et de l’écologie, Defne est archéologue. Nul besoin d’une étincelle lorsque le feu ne s’est pas éteint. Le couple affiche cette fois son amour à la face du monde et s’installe à Londres emportant dans le voyage une pousse du figuier qui se meurt. La jeune pousse grandit en même temps qu’Ada, le bébé de l’amour, l’enfant de la renaissance, tous deux entrent en résonance.
La question qui se pose alors est celle de la violence de l’exil, du déracinement et de la façon dont les douleurs restées secrètes se transmettent aux enfants.
« Car c’est cela l’effet qu’ont sur nous les migrations et les relocalisations : quand on quitte son foyer pour des rivages inconnus, on ne continue pas tout simplement comme avant ; une partie de soi doit mourir à l’intérieur pour qu’une autre puisse tout recommencer. »
Elif Shafak interroge ce qui construit notre identité, particulièrement la mémoire transgénérationnelle, aucune génération n’est une page neuve.
« Où commence-t-on l’histoire de quelqu’un quand chaque vie se compose de plus d’un fil, quand ce qu’on appelle naissance n’est pas le seul début, ni la mort exactement une fin ?«
« Si les familles ressemblent à des arbres, comme ils disent, des structures arborescentes aux racines mêlées et aux branches individuelles adoptant des angles bizarres, les traumatismes familiaux ressemblent à de la résine épaisse, translucide qui coule d’une entaille dans l’écorce. Ils coulent à travers les générations. »
Comme l’écrivait Ovide : « Un jour cette douleur te sera utile », utile pour cerner les dysfonctionnements, pour entendre les manques qui blessent, pour guérir les chagrins, pour renaître en assemblant les pièces du puzzle de notre vie, « parce que dans la vraie vie, à la différence des livres d’histoire, les récits ne nous arrivent pas complets mais par pièces et morceaux, segments brisés et échos partiels, une phrase entière ici, un fragment là, un indice caché entre les deux. Dans la vie, à la différence des livres, nous devons tisser nos histoires à l’aide de fils aussi fins que les capillaires des ailes de papillon. »
L’écriture d’Elif Shafak balance entre le conte et le réalisme pour nous parler du kismet, le destin, et de la façon dont nous y agissons. Dans ce roman dédicacé « aux émigrants et aux exilés de tous les pays, les déracinés, les ré-enracinés, les sans-racines », elle se lève contre les fondamentalismes, les nationalismes et les ghettos de toutes sortes et plaide pour une reconnexion au monde, aux autres, à l’indispensable solidarité. C’est par la voix d’un arbre qu’elle fait entendre les silences, les tabous – « aucune captivité n’est éternelle » – et qu’elle fait appel à ce qu’il y a de meilleur en nous, notre humanité.
« Même les arbres d’espèces différentes font preuve de solidarité entre eux sans tenir compte de leurs dissemblances, et on ne peut pas en dire autant de quantité d’humains. »
Elle nous parle d’exils, de mémoire, de résistances, d’identité et d’amour sans ton moraliste mais avec bienveillance et lucidité.
« Nous redoutons le bonheur, voyez-vous. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que dans l’air, dans les vents étésiens, un échange mystérieux est à l’œuvre, de sorte qu’à chaque parcelle de plaisir succède une parcelle de souffrance, à chaque éclat de rire une larme prête à rouler, parce qu’ainsi va ce monde étrange, et donc nous tentons de ne pas paraître trop heureux, même les jours où c’est le sentiment que nous éprouvons en notre for intérieur. »
.
Elif Shafak, L’île aux arbres disparus, traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquet, Flammarion, 429 p., 22 €
.

































