
De l’art d’être humain
Les éditions de La Peuplade nous offre avec Les ombres filantes, de Christian Guay-Poliquin, un roman à la voix originale, authentique et vibrant de nature, qui se veut une réflexion sur le bouleversement de notre monde et sur les valeurs qui comptent. Si le livre flirte avec le catastrophisme ambiant, il est cependant soutenu par un revigorant souffle d’espoir.
La Peuplade est une sympathique maison d’édition québécoise fondée en 2006 par Mylène Bouchard et Simon Philippe Turcot, passionnés d’art, qui ont toujours vécu entourés de créateurs, amoureux des mots, eux-mêmes écrivains. La petite entreprise devenue grande, conquérant les lecteurs européens, se veut un espace de création et de dialogue qui aime explorer de nouvelles voies, faire entendre de nouvelles voix, avec un intérêt particulier pour les peuples du Nord, aux voix fortes et singulières qui interrogent les notions d’identité, d’appartenance et de territoire. J’y ai découvert des écritures atypiques, des textes exceptionnels qui secouent, (r)éveillent et bouleversent, notamment l’incandescent et magnétique Ténèbre de Paul Kawczak, le dérangeant Homo Sapienne de Niviaq Korneliussen, l’intrigant Le lièvre d’Amérique de Mireille Gagné, l’émouvant Agathe d’Anne Cathrine Bomann et les romans interpellant au style dépouillé de Christian Guay-Poliquin.
Nous retrouvons, dans Les ombres filantes, le narrateur des deux précédents romans de l’auteur. Après Le fil des kilomètres, dans lequel il trace la route pour se rendre au chevet de son père malade, et Le poids de la neige, où un accident et un rude hiver le retiennent dans un petit village, le voici marchant au mitan d’une dense forêt.
La forêt
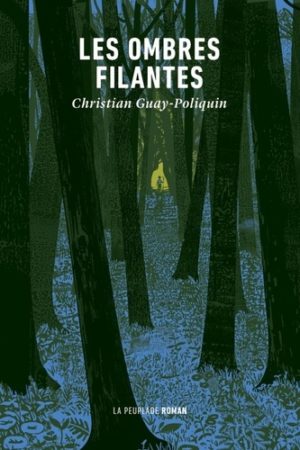 Pendant des années, l’homme a « réparé, rafistolé, réanimé des voitures, des tracteurs, des camions-bennes », toute sa vie tournant autour de la mécanique. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à réparer, le monde semble s’être arrêté, une panne a transformé la vie en survie. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à sauver si ce n’est soi-même – « […] les gens se méfient, les gens calculent, les gens sont armés. »
Pendant des années, l’homme a « réparé, rafistolé, réanimé des voitures, des tracteurs, des camions-bennes », toute sa vie tournant autour de la mécanique. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à réparer, le monde semble s’être arrêté, une panne a transformé la vie en survie. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à sauver si ce n’est soi-même – « […] les gens se méfient, les gens calculent, les gens sont armés. »
« Je songe à l’éternelle danse des proies et des prédateurs. À la guerre lasse du hasard et de l’inexorable. À la loi du plus fort, du nombre et de la nuit. »
Comme la plupart, l’homme tente de rejoindre le camp de chasse de sa famille, au plein cœur de la forêt, peut-être un dernier bastion de paix. Il ignore depuis combien de temps il est parti, « le temps m’échappe. Le décor se renouvelle. Les distances se dilatent. » Il s’est délesté de beaucoup, ne gardant que ce qui lui permet d’espérer. Il chemine dans une forêt, aussi belle que sauvage, autant amie qu’ennemie, lieu antique et mythique, magique et mystique, personnage à part entière du roman. On s’y perd ou on s’y ressource, on y devient bête sauvage ou on s’y retrouve.
« Elle est le commencement et la fin. Elle précède les regards, elle leur succédera. Elle est l’épicentre, le nœud, le refuge et la geôle. Elle fascine autant qu’elle effraie. Sous sa chape, les rencontres sont rares et décisives. Le temps est sa force vive. Son désordre ensorcelle, ses ombres se confondent, ses murmures fusent de toutes parts. Elle est l’envers de ce qui pense. Elle est l’instinct, le geste, le frisson. Toutes les âmes rêvent de s’y perdre. Mais aucun être ne sort indemne de son étreinte. Elle est la solution la plus simple, la plus totale, la plus opaque aux calculs des cœurs inquiets. »
L’homme y rencontre Olio, gamin de douze ans malicieux, aux pulsions violentes, nullement effrayé, qui l’aide à retrouver son chemin. Olio est réticent à se raconter et pose plus de questions qu’il n’y répond. Ils pérégrinent ensemble, s’apprivoisent et croisent un vieil homme qui pêche, membre d’une communauté de gens de son âge qui ont fui la ville et ses mouroirs bien avant la panne pour vivre en paix ; deux sœurs qui vivent en autarcie dans une clairière et qui se méfient des hommes ; un groupe d’hommes, de femmes, d’enfants qui ressemble à une secte, dirigé par un homme aux cheveux longs, au regard comme fou ; un couple avec leur bébé, l’homme blessé par balle au moment de leur fuite de la Station, lieu censément sûr où des clans se sont formés, générant confusion et répression. Dans un monde où il est difficile de se fier à quiconque, où la menace se cache partout, c’est un réel soulagement pour l’homme d’arriver à destination et de retrouver sa famille.
La famille
« Elle est exclusive et acharnée. La forêt est sa loi. Les ombres sont l’échiquier. Son règne descend des temps anciens et elle en est fière. Elle refuse d’admettre qu’en ces lieux rien n’est acquis ni ne dure. Pourtant, elle n’est pas seule à chercher la lumière ici-bas. Tous les jours, elle besogne, elle chasse, elle dévore et troque ce qu’elle tue. Ses membres sont bruyants mais avisés. Pour ne pas s’entretuer, ils se tiennent comme un seul corps. Et quand ils rient, la terre tremble. »
Dans un premier temps, la famille est un havre, une bénédiction. Chaque membre a une tâche bien définie, succès d’une bonne entente. Ils vivent en autarcie et se défient des autres, rendus sans pitié par la survie.
« Pendant un instant, l’impression persiste que chacun autour de cette table joue un rôle, sans jamais déroger au personnage qu’on lui a assigné. Que nos échanges sont orchestrés selon une mécanique bien particulière. Que notre acharnement à la chasse et aux travaux est salvateur mais aliénant. Comme s’il y avait une forme de pénitence volontaire dans notre façon de vivre. Je me demande ce qu’on fait ici, à l’écart du monde, comme des naufragés prisonniers d’un océan de verdure. »
Ils sont comme ces grands cèdres qui penchent tous un peu mais qui se tiennent ensemble. Cependant, la famille, parce qu’elle protège et opprime à la fois, est un équilibre fragile et la cohabitation peut s’avérer compliqué. Le sentiment de protection et la routine réconfortante retrouvés ne satisfont pas l’homme. Rester, c’est se perdre – « Rester ici est plus fou qu’aller n’importe où. »
Alors, il devient urgent de se sauver de la famille pour se sauver soi, quitter un petit royaume étouffant à la force illusoire, un château de cartes – « On lutte pour que rien ne change et on se tient tout en s’entredéchirant. »
Le ciel
« Il domine le monde, prodigue la lumière et échappe aux ombres d’ici-bas. Constellé de points de fuite, il est fait d’espérances, de prières, de lendemains inavoués. Les récits qu’il a fait naître n’ont jamais péri. Personne n’en a épuisé le sens. Dieu des temps anciens ou oiseau de métal, il abrite tout ce qui est hors de portée. Il surplombe les destins, il élève les cœurs, il écrase les corps. »
Le périple accompli par l’homme, véritable odyssée, a contribué à le redéfinir. La nature, la forêt, où il connaît un dépouillement extrême, l’aident à recentrer ses pensées, à se retrouver hors du bruit du monde. Grâce à Olio, qui a un rôle de révélateur, de prisme, il découvre une part de lui qu’il ignorait, sa fibre paternelle, un lien filial qui donne de la consistance à ses jours et ouvre sur l’avenir, un horizon à nouveau.
Les ombres filantes n’est plus vraiment, pour nos temps, une dystopie tant il possède un effrayant parfum de réalité. Christian Guay-Poliquin est un peintre d’atmosphères talentueux qui nous fait entrer dans la peau de son narrateur, ressentir les tensions souterraines et le sentiment d’urgence inhérent à notre époque. Son écriture sèche, concise, où affleure une certaine poésie, aide à mettre l’accent sur un nécessaire retour à l’essentiel, à plus de simplicité, d’authenticité. Dans une société dénuée d’artifices, des défis sont à relever, il est primordial de trouver en nous la force de transformer nos vies, étant donné que la menace ne vient pas du climat mais bien des hommes. Le roman, vertigineux, nous plonge au plus intime de la perte de repères où nous sommes ombres filantes, formes floues éphémères. Il s’agit ici de survie dans un monde qui s’effondre, également de survie relationnelle, les alliances étant vitales pour se garder sauf. L’auteur interroge le comment vivre ensemble tout en conservant le lien à soi et réaffirme que c’est l’altérité qui nous fonde.
.
Christian Guay-Poliquin, Les ombres filantes, La Peuplade, 2021, 344 p., 20 €.
.
Lire toutes nos critiques de livres

































