
Dansons la densité
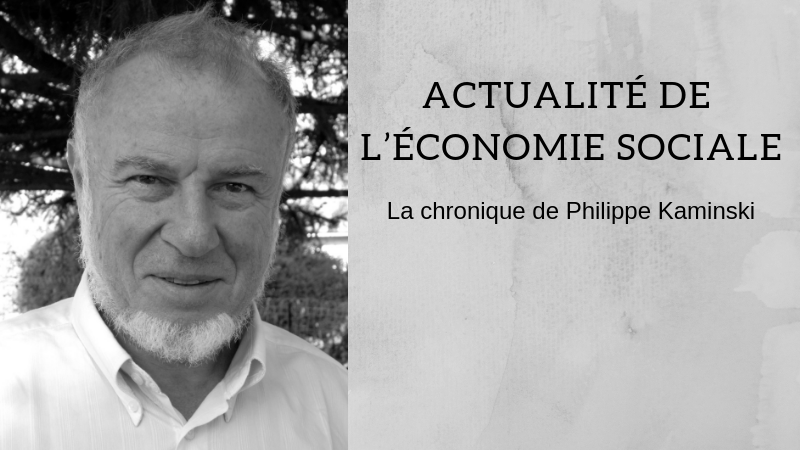
L’urbanisme aujourd’hui est vu sous le seul prisme « néo-libéral », au service de l’individu-consommateur. L’Économie Sociale y jure par son absence. Or c’est précisément l’introduction de la dimension coopérative dans l’habitat qui, seule, permettra de rendre la ville réellement vivable.
Actualité de l’économie sociale
Il existe un large consensus chez la plupart des urbanistes : il faut augmenter la densité des villes-centres, mettre un terme à l’étalement urbain, reconstruire les villes sur elles-mêmes plutôt que de les laisser envahir leurs périphéries au détriment des espaces naturels et des terres agricoles.
Ces idées sont déjà anciennes. À l’origine, elles partaient d’un constat de pure esthétique paysagère. Quoi de plus laid, en effet, que ces zones commerciales qui s’étendent à l’infini, sur un seul niveau, parsemées de vastes surfaces stérilisées par le stationnement, les mêmes enseignes se dupliquant d’une agglomération à l’autre ? Cela allait de pair avec des considérations économiques, notamment sur les transports. Au fil des ans, l’argumentation s’est nourrie d’analyses plus sociologiques, portant sur la ségrégation de l’habitat, d’où est issue l’expression désormais usuelle de France périphérique.
Dernier renfort en date, le commandement climatique, essentiellement polarisé sur la diabolisation de l’automobile. C’est le plus bruyant, mais à l’examen le moins convaincant. Il ne repose en effet que sur une comptabilité comparée des émissions de CO2 entre un scénario du pire et un scénario du meilleur qui sont également fictifs et réducteurs. Tout n’est pas dans le CO2.
Mais pourquoi, devant tant d’arguments convergents, que sont venues appuyer quelques normes et quelques lois récentes, l’étalement urbain se poursuit-il ? Pourquoi les centres-villes continuent-ils à se dépeupler et à perdre leurs activités ? Et, in fine, l’Économie Sociale aurait-elle un rôle à jouer ?
Je regrouperai en trois grandes catégories les forces qui jouent en sens contraire : d’abord l’inertie inhérente à tout ce qui touche au bâti, ensuite l’acquiescement, conscient ou subi, d’une majorité de la population, enfin la perversité de notre système de gouvernance urbaine et territoriale.
Il est évident qu’on ne remplace pas un bâtiment, a fortiori une rue ou un quartier, par un simple tour de passe-passe. Il faut du temps pour construire, encore plus de temps pour avoir l’autorisation de construire, et cela coûte cher, vingt ou trente ans d’épargne pour un acquéreur moyen. Lorsque s’y ajoutent des obligations de protection du patrimoine historique, les délais s’allongent au-delà du raisonnable. Certes, on peut déblayer une zone commerciale récente d’un coup de pelleteuse, mais dès qu’on touche au dur, c’est une autre affaire. On ne pourrait donc voir les effets d’un recentrage des villes sur leur noyau que progressivement et à long terme.
Encore faudrait-il que le marché, que les attentes des populations aillent en ce sens. Cela n’a rien d’évident. L’attrait pour la maison individuelle ne se dément pas ; elle reste le rêve d’une vie pour beaucoup de ménages. Si les commerces de périphérie ne plaisaient pas à tant de clients, ils ne se seraient pas ouverts. Enfin, l’instinct grégaire qui pousse chacun à se sentir mieux au milieu de ses semblables est bien plus fort que toutes les incantations sur les bienfaits de la mixité sociale et les dangers du communautarisme. Certes, tout citoyen, au sens de tout habitant d’une Cité, est soumis pour des raisons d’intérêt général à de multiples contraintes qu’il est bien obligé de subir, mais quand il s’agit pour lui d’exprimer ses préférences, c’est l’égoïsme qui prend le dessus, et en matière d’urbanisme, celui-ci ne va pas dans le sens souhaité.
Enfin, tout n’irait pas systématiquement pour le pire si notre système électoral ne donnait pas, en dernière instance, les pouvoirs urbanistiques aux seuls résidents permanents. Or, ne leur en déplaise, une ville n’est pas faite que pour ses habitants. Elle se doit, certes, de leur apporter les meilleurs services, de santé, d’éducation et de loisirs, mais ses devoirs ne s’arrêtent pas là. Elle a bien d’autres « parties prenantes », à commencer par ses entreprises, ses alentours péri-urbains et ruraux, et ses visiteurs extérieurs, les touristes bien sûr mais pas seulement eux. Et tout ce qu’elle pourra offrir à ces indispensables partenaires et apporteurs de richesses risquera de gêner le confort, l’entre-soi et la tranquillité des habitants permanents, qui sont les seuls à voter et donc à peser sur les décisions des élus.
Comment sortir de cette triple impasse ?
En première analyse, l’Économie Sociale, dont le tropisme est justement de regrouper des sociétaires aux intérêts communs, ne semble pas le meilleur instrument pour forcer ceux-ci à se mélanger avec d’autres afin d’œuvrer ensemble à la construction d’un prétendu intérêt général qui ne leur apparaît pas sous un jour très attractif.
L’Histoire a cependant montré que les grandes mutations sociales naissent souvent là où on ne les attend pas. Et pour débloquer la situation, pour inventer la ville de demain, il faut laisser la société trouver en elle-même des voies que ni les carcans administratifs ni les seules forces du marché ne sont en mesure de tracer.
La difficulté de la tâche, surtout son ampleur, a de quoi rebuter. Cela a toujours été ainsi, et il n’est pas étonnant de constater que la plupart des utopies ont commencé par un projet de « ville idéale ». Avant de se risquer à un tel exercice, prenons le temps d’une journée de méditation, à la Saline d’Arc et Senans, ou au Familistère de Guise… et restons-en à notre échelle, aussi réduite qu’elle puisse nous paraître.
Pourquoi, par exemple, est-on en France, notamment à Paris, aussi attaché aux immeubles de moyenne hauteur ? Ce n’est pas seulement parce que les constructions d’habitations en tours et en barres se sont soldées par autant d’échecs, esthétiques, urbanistiques et surtout sociaux. C’est parce que les alignements haussmanniens composent un paysage harmonieux qui certes nous est familier, mais qui est intrinsèquement beau et que nous avons intériorisé comme le modèle d’une ville élégante, prospère, agréable à vivre et à visiter.
Or ces immeubles datent d’un temps où il n’y avait pas d’ascenseur et où le dernier étage, le plus fatiguant à atteindre, était réservé aux chambres de bonne. Dans les villes où l’on bâtit aujourd’hui des tours, ce sont les appartements les plus hauts placés qui sont les plus chers et les plus demandés…
C’est dire que la technologie commande. Or dans tout ce que je puis lire sur les projets de « ville intelligente », l’individu est roi, mais l’individu n’y est qu’individu, que consommateur. Même lorsqu’il est question, à plus soif, de « ville inclusive et résiliente », tout n’y est vu qu’à travers un prisme « néo-libéral« . L’Économie Sociale y jure par son absence. Nous avons affaire à des inventeurs d’avenir qui n’en ont jamais entendu parler !
Pourtant, certains immeubles collectifs d’Amérique du Nord, pourtant la patrie de l’individualisme, nous donnent un exemple de ce qui est réalisable en matière de partage d’espace et, en conséquence, de densité de peuplement. Les copropriétaires y disposent d’une buanderie commune, de salons de réception qu’ils partagent, d’espaces sportifs et de détente communs… ce qui permet de réduire la surface purement privative des logements, sans nuire à leur intimité.
Alors, oui, il est temps non seulement de dépasser la « norme Haussmann » et ses chambres de bonne, mais d’introduire dans l’habitat une dimension coopérative qui seule, j’en ai la conviction, permettra de dompter les avancées technologiques qui s’annoncent et de les mettre au service d’une société et d’une ville réellement vivables.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Une Clef peut-elle en cacher une autre ?
– Champagne pour Railcoop
– L’économie circulaire dans le concret des déchets
– Peut-on résister à l’obsolescence programmée ?
– Circulaire ou solidaire, faudra-t-il choisir ?
.
Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































