
Créer son association ou son entreprise : pragmatisme ou planisme ?
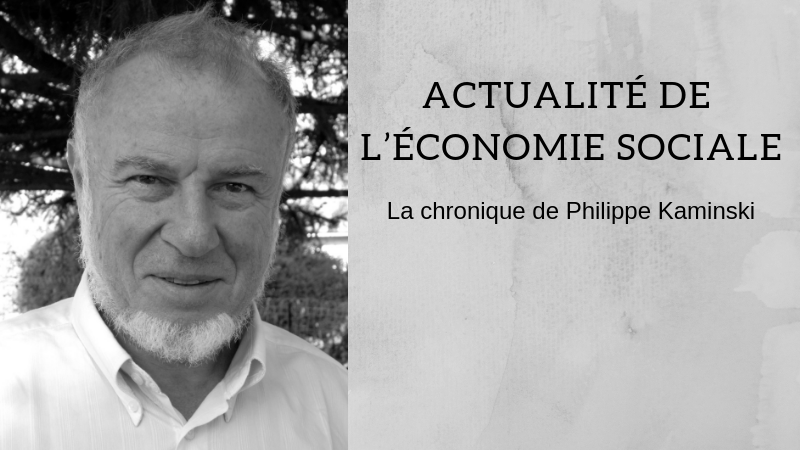
Les cimetières sont remplis d’associations mortes-nées, desséchées avant d’avoir fleuri, parce qu’on leur a dit d’obéir à un plan strict, au lieu de laisser vivre l’imagination, de laisser se déployer la vie dans sa réalité concrète. Analyse.
Actualité de l’économie sociale
Une fois n’est pas coutume : je reprends ici de larges extraits d’un texte publié sur un autre site par un autre chroniqueur. Je le fais, bien entendu, avec l’accord de l’auteur, car le point de vue qu’il développe sur un sujet qui n’est pas le mien, à savoir la création d’une entreprise, rejoint si ce n’est mot pour mot, du moins argument pour argument, ce que j’aurais voulu écrire sur un sujet qui m’est plus familier, la création d’une association.
Je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, d’en savoir plus long sur Philippe Silberzahn, qui est entre autres enseignant à HEC. Vous trouverez en ligne, du premier coup d’épuisette, tout ce que vous voudrez savoir sur ses travaux et publications.
En préambule, je dois préciser que je n’assimile pas du tout l’association à une entreprise. Ce sont à mon sens deux entités de nature bien différente. Et ceci dès le moment de leur création. Alors certes, certains discours, relayés par l’évolution du droit, se sont ingéniés à établir entre elles toute une gradation d’états intermédiaires, que ce soit l’entreprise associative ou l’entreprise sociale. Je me suis toujours élevé là-contre, et je n’ai pas changé d’avis. Une entreprise peut se vouloir solidaire ; dans ce cas, elle doit prendre la forme coopérative. Et inversement, si une association désire exercer une activité économique, il faut qu’elle prenne la forme coopérative. Et elle devient alors une entreprise, qui doit satisfaire ses clients et être rentable pour survivre. Cela a toujours été ma position.
Ce que Silberzahn vitupère, c’est le discours et la méthode des conseilleurs institutionnels qui se complaisent à vouloir enfermer les candidats à la création d’entreprise dans un carcan de « bonnes pratiques » qui les conduisent, avec les meilleures intentions du monde, à brider leur imagination, à freiner leur réactivité, à restreindre leur capacité d’adaptation aux changements.
Et en le lisant, j’ai vu défiler dans mes souvenirs tous ces guides, toutes ces brochures, tous ces conférenciers qui vous expliquent « comme réussir à créer votre association » et qui ne peuvent, si d’aventure vous suivez à la lettre leurs recommandations, que vous conduire dans le mur.
*
Siberzahn écrit :
Je reçois une très belle infographie intitulée « Créer son entreprise en six étapes ». On y découvre qu’il faut d’abord évaluer et valider l’idée, puis étudier le marché, puis chiffrer le projet, après quoi on le financera, puis on choisira la bonne structure et on pourra enfin créer l’entreprise. C’est beau. C’est logique. C’est impeccable. Ça ne marche pas, personne ne fait comme ça, c’est totalement contre-productif de procéder ainsi, et pourtant on continue à dire qu’il faut faire comme ça […]
On sait que la plupart des entrepreneurs ne démarrent pas avec une idée précise et ne suivent pas un plan bien ordonné, mais démarrent avec ce qu’ils ont sous la main et font progressivement émerger leur idée. On construit son produit en marchant.
Des centaines d’articles ont confirmé ce mode émergent de création d’entreprise, dans les journaux de recherche les plus prestigieux. Des centaines de cas l’ont documenté. Mais non. Aussi bien dans les écoles de commerce que dans les organismes d’accompagnement, on continue majoritairement à prétendre qu’il faut un plan précis et une idée claire pour entreprendre, qu’on démarre avec une idée puis qu’on la met en œuvre. Qu’il faut faire une étude de marché. Tout ça bien dans l’ordre, avec des étapes clairement délimitées et précises.
Définir et valider l’idée ?
L’infographie nous précise qu’avoir une idée c’est bien ; la définir et savoir l’expliquer c’est mieux. Pourquoi c’est mieux, personne ne sait […].
Pratiquement aucun projet entrepreneurial ne démarre avec une idée précise, et celle-ci change considérablement dès les premiers pas du projet. Non, avoir une idée n’est pas nécessaire, et on se fiche de savoir l’expliquer. L’expliquer à qui ? Au banquier qui ne vous prêtera pas d’argent ?
Faire son bilan personnel ?
C’est là qu’il faut une bonne « adéquation homme/projet ». Un pot et un couvercle. Deux objets séparés et immuables. Il y aurait un projet, désincarné, hors-sol, en sustentation, et il y aurait un homme, et il faudrait vérifier que les deux sont compatibles. Or on sait que le projet est l’émanation d’un individu et qu’au moment où celui-ci agit, nul ne peut savoir ce qui émergera de l’action.
En outre ce sont souvent les circonstances qui révèlent les talents […].
On enferme les gens dans des carcans avec de belles grilles d’analyses bien logiques et propres. L’adéquation homme-projet est un slogan creux qui n’a aucune base scientifique ; elle ne servira qu’à empêcher un talent de s’exprimer et réservant tel projet à quelqu’un qui proclamera une expertise dans le domaine. Elle sert à écarter les gueux.
L’étude de marché ?
La sacro-sainte. Et là c’est le festival des lieux communs. C’est à pleurer parce que tout a été dit sur le sujet depuis longtemps. Le langage employé est typique de modèles mentaux sous-jacents.
Il faut « s’insérer » dans le marché (faites-moi une place je vous prie…). Il faut « formaliser » son étude (pourquoi ? Mystère ! Mais formaliser c’est important !) Et, nous précise-t-on comme une évidence, « se faire accompagner est un gage de succès » (rien n’est moins sûr si on est accompagné par un imbécile cartésien).
Rappelons que des études de marché avaient « montré » qu’il n’y avait pas de marché pour la téléphonie mobile, pour Xerox, pour l’iPad et pour Nespresso, entre autres.
Le chiffrage ?
Présenté comme l’étape de vérité, alors que tout le monde sait qu’il s’agit le plus souvent d’un grand exercice de mensonge entre adultes consentants. Pas grave, faisons comme si. Puis on recherchera des financements, comme si la plupart des entreprises ne se créaient pas sans financement.
Et on termine par le florilège :
Donner vie à son entreprise ?
Parce que jusque-là, effectivement, il n’y avait rien de vivant. Des plans, des chiffres, des idées, un processus mécanique, des calculs, enfin bref la mort. Mais il faudrait passer par tout ça pour donner vie à son projet, modèle mental très fort qui distingue l’Homme et le projet alors que les deux ne font qu’un. Je me souviens d’un entrepreneur, à qui on demandait comment il équilibrait sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il avait répondu : Vous savez qu’il n’y a qu’une vie, n’est-ce pas ? […]
Du danger de se rendre prisonnier d’un modèle mental funeste
Combien de projets a-t-on ainsi tué parce que leurs porteurs n’étaient pas capables de se conformer au moule institutionnel du « tu auras une vision et un plan mon fils (ou ma fille) » ?
Combien de gens prometteurs a-t-on bloqué et continue-t-on de bloquer dans leur projet de vie parce qu’on exige d’eux une clarté de but, alors qu’on sait depuis longtemps que les buts émergent au fur et à mesure de notre action ? Autrement dit, ce n’est qu’en agissant que je découvre ce que je peux faire ?
Bill Hewlett et David Packard ont créé HP simplement parce qu’ils voulaient travailler ensemble. Ils ont trouvé quoi faire plusieurs années après, vivant de petits contrats en attendant. Ils se seraient fait jeter par les structures d’accompagnement et leurs conseillers cartésiens exigeant de l’ordre, de la méthode et de la rigueur, et surtout bon sang des idées claires !
Et on s’étonne de n’avoir généré aucun champion technologique mondial dans ce pays depuis vingt ans ? Croit-on que Facebook a suivi un plan en six étapes ? Amazon ? Tesla ? Apple ? AirBnB ?
Au-delà de s’obstiner à présenter une vision erronée de l’entrepreneuriat, l’idée d’une avancée en étapes traduit un modèle mental selon lequel il nous faut absolument un but clair et un processus tout aussi clair pour avancer dans la vie. Ce super-modèle mental façonne complètement notre façon de penser.
Nous persistons à expliquer aux entrepreneurs qu’ils doivent avoir un but et un plan d’action très clairs pour avancer. Nous expliquons aux étudiants qu’ils doivent avoir un objectif de carrière très clair avant de se lancer dans la vie, comme s’ils n’étaient pas déjà dans la vie. Nous demandons même à nos enfants dès la classe de quatrième de savoir ce qu’ils veulent faire plus tard.
Pas une stratégie d’entreprise qui ne soit complète sans son exercice de vision et ses cinq objectifs stratégiques. Pas un candidat à une élection qui ne puisse se présenter sans un programme. Pas un manager qui ne doive être clair sur ses objectifs pour l’année.
Comment peut-on persister avec cette obsession du but dans un monde aussi incertain, qui nous apporte surprise après surprise ? Qui casse nos modèles mentaux les uns après les autres ? Un monde qui demande plutôt une plongée joyeuse dans son incertitude, sa complexité et sa richesse ? Car qu’observe-t-on ? Le but vous éloigne de la vie. C’est son rôle d’ailleurs. Un but, un plan, ça sert à pointer « là-bas, dans longtemps ». Et puis la vie se rappelle immanquablement à vous sous forme d’une belle surprise qui ruine le but et le plan. Tous les entrepreneurs le savent. Tous les managers le savent. Tous les vivants le savent.
Et pourtant, les morts continuent d’expliquer aux vivants qu’ils devraient avoir des buts clairs. Qu’un entrepreneur, au lieu de partir de qui il est, de ce qu’il connaît, de qui il connaît, et de faire avec, ici et maintenant, devrait aborder son projet comme s’il devait monter un Lego en suivant un plan bien détaillé.
Qu’un étudiant à 18 ans devrait savoir exactement ce qu’il va faire plus tard. Qu’il faut être clair ! Qu’il faut savoir où on va ! Et pourquoi ? Parce qu’ils sont prisonniers de ce modèle mental. Ce modèle nous tue, tue nos enfants, tue toute initiative et génère frustration et angoisse. Alors que la vie n’exige aucun but hors elle-même. L’absence de but, c’est la liberté. L’absence de but c’est la vie. Mais la vie intéresse-t-elle les cartésiens vendeurs de plans ?
*
C’est bien envoyé. Et cela se transpose sans difficultés au monde associatif, où foisonnent les conseilleurs, car tout subventionneur est flanqué de conseilleurs. Ceux-ci vous expliqueront doctement qu’il faut d’abord définir son projet associatif. Il faut l’expliciter et savoir le défendre. Il faut étudier les conditions de sa réalisation, repérer les difficultés à surmonter, faire la liste des organisations sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Il faut bâtir un budget prévisionnel, après quoi vous pourrez vous lancer dans les parcours bureaucratiques qui vous conduiront vers les précieuses et indispensables subventions grâce auxquelles vous pourrez créer des emplois. Le nec plus ultra sera de co-construire avec les autorités compétentes, de développer des partenariats avec le secteur privé, et ainsi de faire naître une dynamique d’innovation sociale à fort impact.
Ils ne vous parleront jamais de ce qu’ils ne connaissent pas, à savoir intéresser, recruter et fidéliser des adhérents, leur transmettre le feu sacré, savoir faire avec les moyens du bord, sans salariés ni emplois aidés, assurer la formation et le renouvellement des élus, ne pas perdre son temps et son énergie en palabres statutaires et gérer avec parcimonie le produit des cotisations. Et c’est ainsi que les cimetières sont remplis d’associations mortes-nées, desséchées avant d’avoir fleuri, et que survivent maintes associations zombies, perfusées par de l’argent public et aussi peu imaginatives que la bureaucratie qui les nourrit et les Trissotins qui les encensent.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Art, culture et prophéties : catastrophe démographique à l’horizon
– Rerum Novarum et l’Économie Sociale
– Organiser l’Économie sociale en Francophonie
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.


































Bonjour,
Apparemment, Philippe Silberzahn intervient dans les deux institutions, ainsi qu’il l’écrit lui-même : https://philippesilberzahn.com/about/
Cordialement,
La Rédaction
Bonjour,
Je me permets de faire une petite rectification : Philippe Silberzahn est enseignant à emlyon business school et non à HEC
Bien cordialement,