
Chevauchées sur les rives du don (2/2)
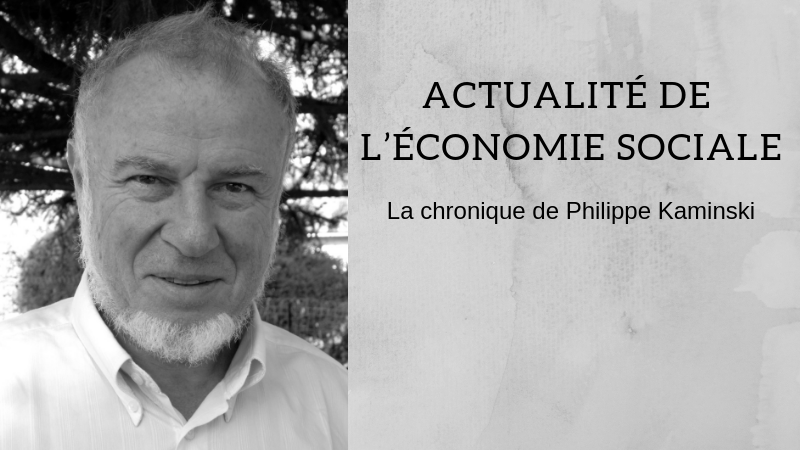
La politique de subvention des associations a connu une évolution rapide ces dernières décennies : du don au dû, jusqu’à devenir un droit, le rapport de force s’est inversé. Bénéficier d’une subvention, ce n’est ainsi plus recevoir un soutien, mais prendre sa part du festin alimenté par le généreux contribuable.
Actualité de l’économie sociale
.
Les recettes des associations relèvent de quatre grandes catégories : les cotisations, les subventions, les dons et les ventes marchandes. Il peut exister des cas intermédiaires, douteux, difficiles à classer, mais ils sont rares ; distinguer entre ces quatre rubriques devrait, normalement, tomber sous le sens. Et cependant tout semble se liguer pour entretenir ambiguïtés et confusions.
La volonté d’éclairer le magma associatif (et ses comptes) par des statistiques adéquates, assez peu soutenue par les pouvoirs publics, s’est au fil du temps heurtée à deux obstacles majeurs, d’une part les réticences maintes fois affirmées des principaux protagonistes, et d’autre part l’hétérogénéité, intrinsèque et rédhibitoire, du champ des associations. Pendant de longues années, ce débat s’était doublé d’un affrontement politique, voire métaphysique, entre une coalition de grandes associations faisant appel à la générosité publique et leur agresseur, un bouillant huguenot nommé Pierre-Patrick Kaltenbach. Il ne reste plus guère de séquelles de ces joutes aux relents picaresques. Aujourd’hui, tout le monde semble se satisfaire d’une information a minima, peu pertinente mais qui ménage les susceptibilités. D’ailleurs, plus personne ne se pose vraiment de question sur la légitimité du rôle et du financement des associations… mais cela pourra revenir un jour.
Pierre-Patrick Kaltenbach, PPK pour les intimes, était un énarque, conseiller maître à la Cour des Comptes, qui connut son heure de gloire le jour où il fit chuter le tout-puissant Jacques Crozemarie (fondateur de l’Association pour la Recherche contre le Cancer), dont il avait mis au grand jour les malversations. Porté par ses profondes convictions calvinistes, il voyait dans le détournement de l’argent public, ou de celui des donateurs, par des associations sous prétexte de « faire le Bien », le summum de l’offense au Créateur. Nos relations furent pour le moins tumultueuses. Il me traitait de « césaro-papiste » chaque fois que j’émettais une objection à ses diatribes. Il réussit à convertir à sa cause de nombreux parlementaires, mais il fut desservi par ses emportements et ses raccourcis excessifs. Après son décès, l’aréopage qu’il avait constitué se disloqua en un rien de temps, bientôt suivi par le front de défense des associations, qui n’avait plus d’objet. Il reste de lui quelques ouvrages polémiques, dont l’un en particulier, Associations lucratives sans but, mérite toujours d’être lu.
Le don charrie comme une casserole l’image surannée de l’aumône, où une personne riche nourrit et humilie en même temps une personne pauvre. Or s’agissant des associations, rien de tel. Deux situations se présentent (et seulement deux) : ou bien le don n’est qu’une cotisation augmentée et ne concerne que le cercle des adhérents, ou bien il fait suite à une campagne d’appel à la générosité publique, et dans cas, le jeu des déductions fiscales fait que chaque donateur oblige implicitement deux contribuables à soutenir la même cause que lui, pour un même montant. Ce mécanisme de socialisation de la générosité fonctionne d’ailleurs exactement de la même façon pour les cultes et les partis politiques. Dans tout cela, aucun contact n’a existé entre un riche et un pauvre, du moins entre un contributeur et un secouru ; pour que ceci commence à exister, il faut étendre la notion de don à celle d’engagement, de don de son temps. Certains préconisent une telle comptabilité, étendue à l’action bénévole ; mais c’est là un autre débat. Je veux rester ici dans le strict cadre des ressources financières des associations, et éclairer ce que j’appellerai la préférence pour la subvention par rapport au don.
*
Fondamentalement, le don aliène celui qui reçoit, non pas tant parce qu’il oblige celui-ci vis-à-vis du donateur, ou parce qu’il lui fait ressentir son statut social inférieur. Ces deux propositions sont vraies, mais ne viennent qu’en seconde ligne. Avant elles, et bien avant, il y a le fait que recevoir prive du plaisir de prendre soi-même.
Je me souviens d’une scène vécue à Genève, ville opulente et généreuse s’il en est. Je résidais dans un vieil hôtel du centre. C’était le début de l’été, le jour se levait très tôt. Je fus réveillé à l’heure où la nuit commençait de s’effacer par un bruit incessant de poubelles. Ma fenêtre donnait sur une petite place où je pus distinguer un groupe de personnes affairées à ouvrir chacun des conteneurs qui attendaient là leur ramassage, à inventorier tout ce qui y était déposé et à remplir leurs sacs de tout ce qu’ils estimaient bon à récupérer. Intrigué, j’enfilai rapidement un pantalon et descendis voir de plus près. Les manouches (car c’en était) ne me portèrent aucune attention et continuèrent leur bruyante besogne. Tout était bon à prendre, restants de pizza comme bouteilles vides. Puis ils disparurent, emportant leur butin et laissant derrière un peu de saletés, mais pas trop. Sans doute leur fallait-il vider les lieux avant de voir surgir une ronde de police.
À Genève, l’hygiène est roi, et certainement les services de collecte des ordures ne peuvent qu’y déplorer que des poubelles bien rangées aient été visitées et refermées ensuite n’importe comment. Les services sociaux y sont richement dotés et sans doute auraient-ils offert de grand cœur des paniers repas, bio et équilibrés, à tous les demandeurs qui se présenteraient à eux. Peut-être que les Roms que j’ai vus à l’œuvre émargeaient aussi à l’aide publique ; en tous cas, ils ne pouvaient se priver du plaisir d’aller trouver leur bonheur en triant eux-mêmes les déchets des bourgeois et des touristes.
Observez un enfant, ou un chat. Vous venez de lui acheter un jouet, un beau jouet, garanti fabriqué en France et exempt de bisphénol. Mais voilà que votre chéri le néglige, et préfère jouer avec une boule de chiffons qu’il a dérobée dans votre placard. Avec son larcin, il va s’amuser comme un fou. Ceci vous est arrivé dix fois, cent fois ; malgré tout, vous continuez à lui offrir des cadeaux, parce qu’ils vous ont plu à vous ; mais ils valent peu de chose aux yeux de leur destinataire, parce que celui-ci n’est pas allé les conquérir lui-même.
Fort bien, me dira-t-on. Mais vous critiquez Mauss parce qu’il croit décrypter les mécanismes de nos sociétés modernes à partir d’observations faites sur des peuplades primitives, et là vous faites bien pire, vous leur attribuez des comportements de bébés ou d’animaux de compagnie !
Eh oui ! Je ne leur attribue rien, je constate. Ce ne sont pas à des adultes responsables, conscients, éduqués et raisonneurs que nous avons affaire, mais à des personnes morales bizarres, pas tout à fait des communautés, pas tout à fait des entreprises. Les assoces, oui, se comportent volontiers comme un chat domestique, entièrement dépendant de son maître qui le nourrit, le soigne et le dorlote, mais affirmant en permanence son indépendance et ses préférences. Ce qu’il reçoit sans l’avoir demandé ne vaut rien, ce qu’on lui accorde après qu’il l’a demandé n’est que son dû, ce qu’il est allé chercher lui-même est un trophée qui vaut de l’or.
*
Lorsque la subvention était rare, peu de chose la distinguait du don. La seule différence était que le donateur était une entité publique, un ministère ou une ville. Tout le pouvoir était de son côté. L’association faisait une demande, on pourrait dire une supplique, et n’avait aucun recours en cas de refus. Puis, là encore à partir des années 1970, le rapport de force s’est progressivement inversé.
Pour une majorité de petites associations dont l’activité se limite au service des adhérents, comme les clubs sportifs amateurs, la subvention est restée ce qu’elle était, à savoir le soutien d’une autorité publique, soutien que l’on sollicite et qui permet d’équilibrer les comptes. Mais pour les petits-fils de Bloch Lainé et de Delors, elle est devenue un droit, le droit pour les assoces d’être financées par l’argent public et d’utiliser celui-ci en toute liberté. Les organisations associatives se sont ainsi dressées, vent debout, contre toutes les tentatives (provenant notamment du ministère de l’Intérieur) visant à privilégier les conventionnements et les appels d’offres au détriment des subventions. En fait, c’était l’affrontement de deux conceptions radicalement opposées de l’intérêt général et de la démocratie.
Pour les uns, l’argent du contribuable ne peut être dépensé selon le bon vouloir de quelques-uns, sans le contrôle de l’autorité publique. Les échelons territoriaux furent donc invités à transformer les subventions en achats de services, en faisant jouer la concurrence. Le bon usage des deniers publics devait ainsi être mieux garanti. Tel n’était pas, mais pas du tout, le point de vue des assoces. D’abord, elles sont le sel de la terre, l’avant garde éclairée de la masse des citoyens, et elles savent mieux qu’eux, mieux que leurs élus, à quoi consacrer cet argent public qui, dès qu’il passe entre leurs mains, prend une valeur sacrale. Ensuite, elles ne tolèrent aucun contrôle, car ce serait brider leur liberté, et par voie de conséquence brider le progrès social. Et c’est pourquoi, lors des discussions préparatoires à la loi Hamon de 2014, elles ont tant insisté pour que le texte « sanctuarise » le droit à la subvention.
Au cours de la dernière décennie, l’essor des discours sur la « co-construction » des politiques publiques (par les élus et les assoces, souvent rebaptisées en bloc « société civile » ou parfois « parties prenantes ») a sensiblement étayé ces revendications en donnant naissance à une « co-bureaucratie » qui voit les mêmes profils, les mêmes caractères, siéger de part et d’autre et parfois échanger leurs places, donnant clairement le sentiment de s’être attribués la « co-propriété » du magot. Par mimétisme, les fondations privées des grandes entreprises ont toutes adopté des procédures semblables, si bien que de plus en plus, bénéficier d’une subvention ce n’est plus recevoir un soutien, mais prendre sa part du festin alimenté par le généreux contribuable.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Chevauchées sur les rives du don (1/2)
– Violences et économie sociale
– Démographie, immigration et culture (2/2)
– Démographie, immigration et culture (1/2)
– La guerre des âges est-elle relancée ?
– États d’âme, ou état de fait ?
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































