
Chevauchées sur les rives du don (1/2)
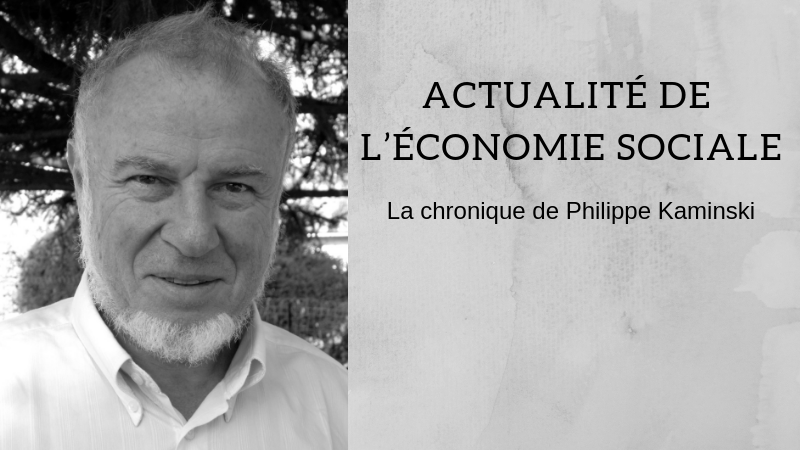
Tandis que le système américain privilégie les techniques du fundraising, le modèle français repose sur un État omniprésent, fiscaliste et jacobin, qui se méfie de tout ce qui n’est pas financé par lui. D’où ce « monde associatif », véritable construction intellectuelle tant il revêt des réalités trop diverses, drogué à la subvention.
Actualité de l’économie sociale
.
Je reviens aujourd’hui sur la question du don, à laquelle j’avais déjà consacré une chronique. C’était le 30 novembre 2020. Je m’y attachais pour l’essentiel à démolir les théories de Mauss, en fait plutôt leurs vulgarisations récentes. Ces approches privilégient l’analyse du comportement du donateur, et négligent trop le récipiendaire. Or c’est bien celui-ci, notamment lorsqu’il s’agit d’une association, qui doit retenir notre attention.
Le système américain aura imposé au monde entier, par le simple jeu de la puissance économique et financière, sa conception très particulière de la philanthropie, et ses techniques du fundraising, l’art de la collecte des dons, largement enseignées dans ses universités à l’égal de la gestion d’une PME ou du pilotage d’un projet informatique. Arrivé en France, ce corpus de pratiques et de certitudes d’avoir raison s’est heurté à notre État omniprésent, fiscaliste et jacobin, et à sa méfiance ancestrale de tout ce qui peut être financé par un autre que lui ; remontons, pour le plaisir, aux Templiers, à la mainmorte ou au surintendant Nicolas Fouquet…
De cette rencontre improbable est né le modèle français de l’association droguée à la subvention.
*
L’histoire officielle, mensongère comme toujours, fait naître l’association, en France et donc dans le monde qui tout entier nous envie, en 1901. C’est inexact ; la loi de 1901 fut en fait et avant tout une loi de spoliation des congrégations. Parmi nos plus anciennes associations toujours en vie, nombre d’entre elles ont été fondées bien avant 1901, et il n’y a pas eu, dans les années qui ont suivi la promulgation de la loi, de croissance significative du nombre de créations.
C’est dans les années 1970 qu’a pris corps la notion d’association telle que nous la connaissons aujourd’hui. Avant cette période charnière, les structures humanitaires ou caritatives habilitées à collecter des dons, bien qu’ayant pour la plupart opté pour la forme juridique d’associations, ne se reconnaissaient pas comme telles. Qu’elles soient d’origine religieuse ou laïque, elles se nommaient œuvres, œuvres sociales, œuvres de bienfaisance. Quant aux groupements de personnes partageant un même intérêt ou une même passion, ils se nommaient sociétés, sociétés savantes, sociétés protectrices des animaux, sociétés des amis, des disciples de telle ou telle célébrité. Dans le monde du sport et des loisirs collectifs, on ne connaissait que des clubs et des amicales. Et il n’y avait guère de relations horizontales entre les œuvres, les sociétés et les clubs.
À cette même époque, les organisations d’encadrement de la jeunesse qui se partageaient depuis la Libération entre l’Église catholique et le Parti communiste français achevaient de se désintégrer. Ce mouvement très rapide laissait la place libre à de nouveaux arrivants. Ceux-ci, venant de partout et portés par les transformations massives de la société d’alors, se reconnurent sous le nom générique d’associations. Quelqu’un leur avait-il soufflé le mot ? Cela aurait pu être autre chose, plus joli, ou plus court. Assez vite, on se mit à parler des assoces.
Les assoces, soit. Mais elles ne seraient rien, elles n’auraient pas pesé bien lourd, si elles n’avaient pas été portées par l’idée d’un mouvement associatif. Paradoxalement, la force de cette idée fut de ne jamais être dominante, de ne toujours apparaître qu’en seconde ou en troisième référence, et donc de n’avoir pas à justifier d’une théorie complète et argumentée. Les mouvements autogestionnaires et leurs sympathisants, à l’origine d’une croissance spectaculaire du nombre d’associations militantes, en dehors des partis politiques classiques et souvent en vue d’un renouvellement des municipalités, ont créé le mouvement associatif en marchant, mais telle n’était pas leur intention première.
*
Deux personnalités émergent parmi les nombreux essayistes, penseurs et sociologues qui ont donné consistance au « mythe associatif » et lui ont écrit ses lettres de noblesse. Il y eut d’abord François Bloch-Lainé, haut fonctionnaire qui de toute sa vie ne connut que les ors et les honneurs du cœur de l’État et qui gagna la célébrité publique en signant un livre sur la réforme de l’entreprise, combat qu’il délaissa très vite au profit de la promotion des associations de progrès. Il n’avait jamais mis les pieds dans une entreprise, pas plus que dans une association « de base », mais il savait en parler et convaincre. Très vite, c’est-à-dire en moins de dix ans, il avait amené à ses vues une part importante des élites françaises, aussi bien chez les catholiques que chez les francs-maçons, chez les gaullistes comme chez les socialistes. C’est grâce à lui que les œuvres se découvrirent, ou feignirent de se découvrir, une âme associative, et que les sociétés, clubs et amicales durent monter, de gré ou de force, dans le même train du progrès. Tout ce monde-là mis bout à bout révélait, en nombre de salariés, en nombre d’adhérents, une force potentiellement impressionnante. Ce mythe dure toujours.
Le second grand inspirateur fut Jacques Delors. Pour cet esprit missionnaire sanglé d’un uniforme de technocrate, qui savait passer en une fraction de seconde du sermon halluciné à la froide rigueur de la circulaire administrative, l’engagement dans une association était un geste rédempteur. C’est par le biais associatif que s’opérera la régénération de la société vers plus de justice, plus d’amitié, plus de bonheur collectif. Sel de la terre, fruit immaculé de la Démocratie, le tissu associatif ne pouvait se tromper, ne pouvait qu’indiquer les voies à suivre pour une politique sociale efficace et bénévolente. Il fit des émules en quantité, dans les milieux les plus divers.
Bien que leur influence ait été très forte par toute la mitterandie, Bloch-Lainé et Delors tirèrent surtout les marrons du feu pour Michel Rocard. Éternel jeune plein d’avenir, porteur en permanence des idées nouvelles, notre Poulidor de la politique française vécut une longue carrière, persuadé de porter en tous temps et en tous lieux les espoirs d’une innombrable armée de l’ombre constituée par les associations.
*
Depuis les années 1970, le choc des réalités s’est à maintes reprises dressé en travers de ces fades illusions, mais sans jamais les faire disparaître. Telles des buissons d’adventices, elles repoussent à chaque fois, certes de taille réduite, mais toujours aussi épaisses et vivaces. Et l’on continue à évoquer le fait associatif, le mouvement associatif, la vitalité associative, sans se soucier de voir qu’il ne s’agit que d’une construction intellectuelle franco-française qui tend à agglutiner des éléments disparates qui n’ont entre eux ni intérêts communs ni complicités actives.
Et c’est au sein de ce « pâté associatif » que s’épanouit, à l’ombre de l’alouette du don privé, le cheval de la subvention publique.
(à suivre)
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Violences et économie sociale
– Démographie, immigration et culture (2/2)
– Démographie, immigration et culture (1/2)
– La guerre des âges est-elle relancée ?
– États d’âme, ou état de fait ?
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































