
Chanvre d’amis et chanvre de députés
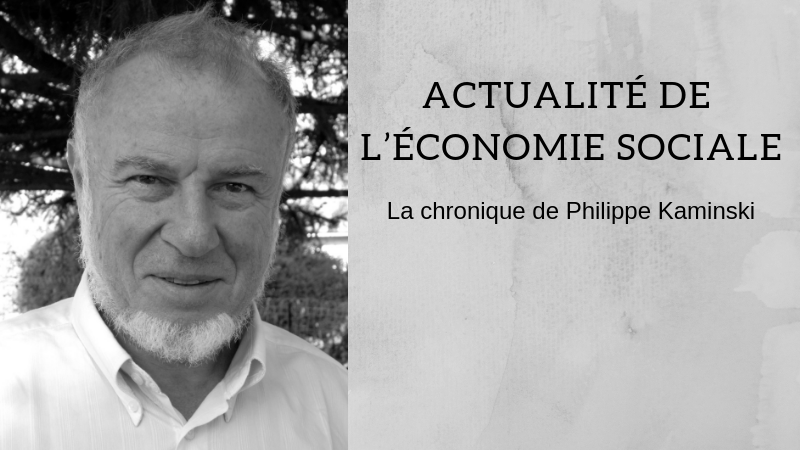
Le Gouvernement a décidé de s’attaquer directement aux consommateurs de cannabis. La mise en place d’une amende forfaitaire changera-t-elle quelque chose à l’économie du chanvre, à la vie dans les quartiers voués au trafic ou à l’attrait de l’interdit ? On en doute… car « chaque nouvelle norme, chaque nouvelle restriction à nos libertés, chaque nouveau coup sur la tronche, chaque nouveau radar, chaque nouvel impôt, c’est du besoin de cannabis ou de psychotropes en plus », selon notre chroniqueur.
Actualités de l’économie sociale
S’il n’y avait pas de demande, il n’y aurait pas d’offre : se fondant sur cette apparente tautologie, le Gouvernement a décidé de s’attaquer directement aux consommateurs de cannabis. Annoncée avec force roulements de tambour, la mise en place d’une amende forfaitaire devant frapper tout détenteur de quelque dérivé de cette plante changera-t-elle quelque chose à l’économie du chanvre, à la vie dans les quartiers voués au trafic ou à l’attrait de l’interdit ? Les partisans de la légalisation y voient un coup d’épée dans l’eau de plus, et les sceptiques se gaussent par avance de l’impossibilité qu’il y aura à mettre réellement cette mesure en pratique. Qui croire ?
La situation, et les débats qu’elle suscite, pourrissent depuis trop longtemps pour qu’il soit possible d’y voir facilement clair, que ce soit par des propos à l’emporte-pièce ou par des diagnostics ne portant que sur un petit aspect du problème. Je laisse les sociologues, les toxicologues, les addictologues et les bidulologues en tous genres se répandre en analyses, en hypothèses et en déclarations filandreuses. Pour ma part, n’étant ni flic, ni consommateur, ni habitant des « cités », ni médecin, ni exploitant de boîte de nuit, je me garderais bien d’entrer sur les plates-bandes des spécialistes. J’assume mon ignorance de la réalité rapprochée. Mais l’on ne voit pas la même chose selon qu’on regarde de près ou de loin, et rien n’interdit de se limiter à un regard de loin. En particulier, seul un recul suffisant permet de juger de la vraisemblance des chiffres et des statistiques que l’on assène çà et là pour étayer la cause que l’on souhaite défendre.
Il est vrai qu’il n’y a pas de demande sans offre, et vice-versa. C’est surtout vrai ex post ; car dans une optique dynamique, toute demande potentielle finit par rencontrer un inventeur qui lui fournira l’offre correspondante, et toute offre orpheline trouvera un publicitaire qui lui fabriquera ex nihilo une demande abondante. Il n’est donc pas stupide, constatant que la lutte contre l’offre seule n’a rien donné, ou si peu, de s’attaquer aussi à la demande. Mais le problème est que l’on s’y prend bien tard, et qu’il ne s’agit plus, depuis longtemps, d’une demande nouvelle, fragile, susceptible de reculer à la première intimidation. C’est au contraire une demande solide, installée, ayant tissé avec l’offre de multiples liens de complicité.
Ce n’est donc pas tant à la demande qu’il faut s’intéresser, mais à ce qui la sous-tend, ce qui la nourrit, ce qui l’entretient. Il paraît que c’est en France qu’on consomme le plus de chanvre, et il en est de même pour les médicaments psychotropes. Cela ne peut pas être le seul fait du hasard. S’il existe, en amont de la consommation, un besoin social de produits hallucinogènes, c’est là qu’il faut faire porter la prévention et c’est là qu’il faut rechercher les causes premières du « record français ».
Il y a de multiples catégories de consommateurs, du festif occasionnel au fumeur régulier, et de multiples raisons qui les ont amenés là où ils sont. Ce qui compte, ce ne sont pas les trajectoires de vie des uns ou des autres, mais le climat général, le tropisme qui pousse à l’usage du cannabis et à la déculpabilisation de cet usage. Lorsqu’on analyse les arguments des défenseurs du chanvre, outre qu’ils affirment assez péremptoirement qu’une légalisation mettrait fin aux trafics et à l’économie souterraine, il en est deux qui reviennent en boucle : d’une part le cannabis permet de se sentir bien, de s’évader des tracas du monde, de rendre la vie supportable, et d’autre part il le fait sans danger. En tous cas, avec moins de dangers que l’alcool, qui pourtant est autorisé.
Commençons par le second argument. Cette insistance à se démarquer de l’alcool contredit l’image, souvent mise en avant depuis des décennies, de ces soirées en plein air, avec ou sans musique, où l’ivresse de la boisson se conjugue avec la fumée des joints pour abrutir une jeunesse en perdition. Les chiffres les plus délirants viennent étayer la thèse. Le cannabis tuerait 57 fois moins que l’alcoolisme ; et pourquoi pas, tant qu’on y est, 133 fois moins que le rhume des foins ou 412 fois moins que la malaria. En fait, ce qui en ressort, c’est qu’il n’y a pas de concurrence, ni de substitution possible, entre alcool et cannabis. Les deux produits chassent sur des terrains différents.
Mais comment se fait-il qu’il ne soit guère fait allusion au tabac ? C’est justement parce que là, il y a une substitution naturelle. Quand Baudelaire, ou Théophile Gauthier, nous décrivent les « paradis artificiels » de leur époque, nous apprenons que le haschisch était alors une « confiture » qui se consommait lors de soirées initiatiques. Quant au tabac, il se fumait certes, mais se prisait ou se chiquait également. Aujourd’hui, tabac comme cannabis se fument tous deux, et quasiment de la même façon ; il y a un passage continu de l’un à l’autre, car la forme du produit et son mode de consommation importent autant, sinon plus que sa composition chimique ou ses effets cliniques.
Or le tabac est vilipendé, pourchassé, dénoncé depuis maintenant assez longtemps pour que cela ait marqué les esprits ; il n’a personne pour plaider sa cause, contrairement à l’alcool que des intérêts puissants savent défendre. Le recul et la perte de prestige du tabac ont ainsi frayé le chemin au cannabis, produit « à peine plus fort » mais paré d’autres vertus, souvent moins cher et qui ne se présente pas en paquets anonymes couverts d’images repoussantes et de slogans terrifiants. Au fond, je ne crois pas que les campagnes anti-tabac aient tant que cela servi la santé publique !
On pourrait en dire autant des campagnes anti-alcool, qui ont conduit à des effets comparables mais en empruntant un cheminement logique tout différent. Il était tout à fait légitime, jadis, de lutter contre les ravages de l’alcoolisme, surtout en milieu ouvrier. Mais l’effort a été poursuivi, par routine, alors que le fléau avait beaucoup reculé et surtout avait changé de nature. Du coup c’est l’art de vivre, la culture, le goût et la distinction attachés au vin et aux eaux de vie de qualité qui se sont trouvés attaqués. L’école porte en la matière une lourde part de responsabilité. Au lieu de s’en tenir à un juste milieu, on est tombé dans l’excès inverse. Une part croissante de la population a tellement été mise en garde contre l’alcool qu’elle est devenue un terrain vierge de toute expérience peu ou prou euphorique ; donc un terrain libre pour la propagation du cannabis.
La nature a horreur du vide, et quand on n’a pas accès à une consommation maîtrisée d’une drogue apprivoisée par des siècles de civilisation, on va chercher sa drogue ailleurs. Et c’est le cannabis qui a profité de cet appel d’air.
Mais reste à savoir pourquoi notre société a besoin de produits hallucinogènes, pourquoi de plus en plus de personnes ne peuvent y survivre sans avoir recours à des substances narcotiques. Poser la question, c’est y répondre ; notre société est de plus en plus anxiogène, et les interventions de la puissance publique, pourtant censées vouloir notre bien, ne font à chaque fois que nous pousser encore davantage sur le chemin de l’angoisse. À force d’interdire, de menacer, de culpabiliser et de punir, à force de ne plus savoir rassurer, encourager, gratifier, faire confiance, nos gouvernants suscitent et entretiennent un besoin toujours plus fort de compensations euphorisantes.
Est-ce une tare de notre système politique, une perversité de nos institutions, ou un travers funeste de notre époque ? Il est certain qu’une société qui consomme de plus en plus de drogues est une société malade, mais c’est une chose de le dire, et c’en est une autre de cesser d’alimenter cette spirale perverse. Chaque nouvelle norme, chaque nouvelle restriction à nos libertés, chaque nouveau coup sur la tronche, chaque nouveau radar, chaque nouvel impôt, c’est du besoin de cannabis ou de psychotropes en plus. Chaque nouveau message public anxiogène, diffusé urbi et orbi et payé par nos impôts, c’est un peu plus de demande de cannabis ou de psychotropes. Et s’il y a un endroit où il faudrait porter la répression, c’est sur ces politiques, sur ces élus, qui nous flanquent chaque jour un peu plus d’angoisse et de détresse. Qu’on arrête le bras de ces empoisonneurs !
Je retrouve un joli texte de Colette. Elle y évoque ses souvenirs d’enfance en Puisaye. Publié juste trois ans avant sa mort, dans la revue des professionnels du lin, il doit certainement être inconnu des libraires. La scène se passe vers 1880, et j’y ai découvert, à mon grand étonnement, que le chanvre ordinaire de nos contrées n’était pas inoffensif :
[…] Autrefois, lorsqu’après l’école les enfants s’en allaient promener en bandes, emportant le petit panier du goûter, un cri d’alarme maternelle les poursuivait jusqu’au bout de la rue :
– Défense de s’asseoir à côté du chanvre !
Chose étrange, nous obéissions. Nous nous écartions des enclos qu’emplissait le chanvre, lourdement agrainé de chênevis, assiégé par les oiseaux. Sa senteur puissante, l’intoxication qu’elle provoquait nous effrayait un peu. Nous nous rassurions à sa maturité, lorsque le rouissage immergeait la récolte dans une eau épaisse et noire. Tout ce que réclamait alors le chanvre nous était familier. Pas une gobette de mon pays qui ne fût une bonne teilleuse, adroite à détacher de la chênevotte sa fibre extérieure. Puis intervenaient des mains plus habiles, qui la nouaient en queue de percheron, avant de céder la place à la quenouille […].
Après quoi notre chanvre ne faisait plus que franchir la largeur de la rue ; juste en face de notre maison gîtaient le tisserand et son métier à main.
Un peu bossu, un peu tordu, tout près de la terre, le tisserand tissait. Ses mains suscitaient ce grand bruit rythmé qui n’incommodait personne, la brutale et agréable chanson du métier.
De son seuil surbaissé, il interpellait parfois ma mère :
– Une jolie paire de draps, madame Colette, ça ne vous fait pas défaut ?
Mais ma mère, comme les femmes de son époque, préférait le lin.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Mélancolie de Président
– PLAN, PLAN, PLAN, RANTAMPLAN
– Sur trois figures de l’économie sociale : Charles Gide et Henri Desroche (2/2)
– Sur trois figures de l’économie sociale : le combat de Frédéric Le Play (1/2)
– Un bel Août, sans nul doute !
– Balles masquées
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































