
Trop d’État, pas assez de libertés !
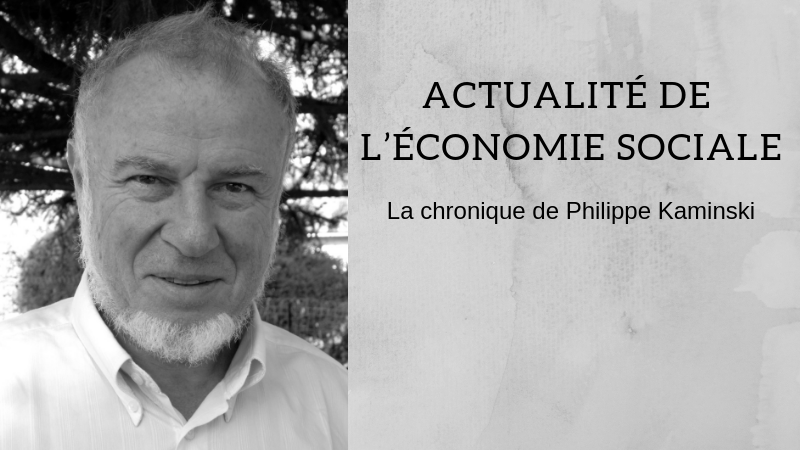
Quelle liberté pour les entreprises de l’économie sociale ? Entre tenants du libéralismes acharnés et défenseurs d’un jacobinisme bien concentré, notre chroniqueur et expert tente d’affirmer une troisième voie : une véritable subsidiarité.
Tribune libre et hebdomadaire de Philippe Kaminski
Il m’est souvent arrivé, y compris dans les présentes colonnes, de vitupérer l’omniprésence d’un État voulant se mêler de tout, et de souhaiter que celui-ci intervienne le moins possible dans les affaires de l’économie sociale. Ce faisant, je me suis fait traiter par certains de « libéral », sachant que ce mot devenu pour le moins ambivalent n’est pas en général asséné en guise de compliment.
Or il ne suffit pas de s’opposer au jacobinisme et de déplorer l’obésité de la puissance publique, comme je le fais sans relâche, pour être libéral. En l’occurrence, ma démarche s’inspire beaucoup plus de Proudhon que de Bastiat. On pourrait dès lors me taxer d’anarchisme, ce que je récuserais également, mais ce serait moins absurde que de m’accuser de libéralisme.
Il existait jadis une distinction nette entre les trois formes de libéralisme, le politique, le religieux (en fait presque exclusivement catholique) et l’économique. Le libéralisme politique s’est banalisé, dissous dans une acception bourgeoise de la démocratie parlementaire. N’ayant plus d’adversaires déclarés, il n’a plus de partisans. On pourrait dire la même chose du libéralisme religieux, qui a connu une certaine radicalisation sous la forme du modernisme ; les querelles intellectuelles qu’il a nourries ont quitté le devant de la scène. Il ne reste plus que le libéralisme économique, qui pourrait se limiter à la défense de la libre entreprise, ce que je verrais avec sympathie, ou s’étendre à celle du système capitaliste tout entier, ce qui susciterait en moi plus que de la méfiance.
Mais ce n’est pas le cas. Nombre des théoriciens actuels du libéralisme, notamment leur frange la plus radicale (les « libertariens »), refusent d’en rester là et intègrent dans leur apologie des libertés économiques l’héritage laissé en relative déshérence par les maîtres anciens des libéralismes politique et religieux. Ils poussent cet héritage à l’extrême, dans un contexte devenu totalement autre, conférant ainsi un horizon prométhéen voire démiurgique au parcours terrestre de l’homme-individu, libéré par la science de toute servitude matérielle ou biologique, et libéré par l’idéologie de tout devoir de solidarité collective.
Certes. Mais il ne faudrait tout de même pas que l’évocation des chimères du transhumanisme nous fasse oublier que la libre entreprise a des vertus, et que les entreprises de l’économie sociale ont besoin de cette liberté, non seulement pour se développer à l’instar des entreprises capitalistes, mais aussi pour tisser, telle l’araignée, la toile de solidarités qui leur est consubstantielle. Et si l’État doit à tout moment leur dicter comment il faut se financer, comment il faut se gouverner, avec qui il convient de nouer des partenariats, elle n’auront pas cette liberté, et ne produiront pas leur toile de solidarités. Dire cela, ce n’est pas du libéralisme, c’est du proudhonisme !
Redescendons des grands principes, et regardons les réalités au ras du sol.
Je lis dans le Journal Officiel du 17 Juillet que le ministère de la transition écologique et solidaire, que je répugne à doter de lettres majuscules, vient de prendre un arrêté autorisant une SCOP des environs de Marseille à sortir du statut coopératif. Ignorant tout de l’entreprise en question, je suis allé consulter les renseignements commerciaux, pour apprendre qu’elle n’a plus que deux salariés, pour un chiffre d’affaires (dans l’installation électrique) permettant tout juste de les faire vivre. Bref, une micro-boîte comme il en existe des dizaines de milliers, qui périclite et qui, pour éviter de fermer totalement, cherche à se faire absorber par une autre ; mais pour cela il lui faut garantir la poursuite du caractère impartageable de ses réserves. Une broutille juridique.
Non curat de minimis praetor. Il ne s’agit là même pas de minimis, mais de micromis, voire de nanomis. Eh bien les préteurs s’y sont mis à trois. Le ministre d’État, depuis démissionnaire, qui a la tutelle de l’économie sociale, signataire de l’arrêté. La ministre des solidarités et de la santé, cosignataire. Et le directeur général de la cohésion sociale, chargé de l’exécution du présent arrêté.
Vous aurez remarqué au passage qu’il existe une Direction Générale de la Cohésion Sociale, à qui j’ai l’honneur de mettre les majuscules qui doivent lui revenir. Chacun d’entre nous a certainement eu à bénéficier de ses nombreux et bienfaisants services. L’État s’occupe, au plus haut niveau, de notre cohésion. Nous voici rassurés. Dans quelle misère serions-nous si ce n’était pas le cas ?
L’exécutif et l’administration participent joyeusement de cette pantalonnade. Mais il ne faut pas oublier le législatif. Il a bien fallu que le Parlement vote un texte de loi qui stipule que lorsqu’une SARL de deux salariés va se faire racheter par un concurrent, il faut s’il s’agit d’une SCOP que deux des plus importants ministres en décident, et qu’une Direction Générale suive l’affaire.
Tout ceci, certainement, avec les meilleures intentions du monde. Parce qu’il faut apporter des garanties. Parce qu’il faut veiller à ce que tout se fasse dans les règles. Parce qu’il faut… tout ce qu’un Courteline aurait pu imaginer et mettre en scène.
Je ne suis pas libéral… Mais je ne veux plus de cet État-là.
La décentralisation n’a pas apporté grand-chose. Certes, en laissant aux régions l’essentiel des décisions de la puissance publique concernant l’économie sociale, l’État a permis à l’instance de décision de se rapprocher des administrés. Mais ceux-ci restent des administrés, soumis aux mêmes rites de tutelle, d’agréments, de subventions, de programmes et d’objectifs. Et les élus restent des élus, soumis aux mêmes contraintes de réélection, qui pèsent autant sur leur échéancier que sur leur façon d’apprécier leurs résultats.
Ce n’est pas tant de décentralisation (d’ailleurs mise à mal dans les régions qui ont dû fusionner) dont l’économie sociale a besoin, mais d’une véritable subsidiarité. À l’État ce qu’il sait faire, au marché ce qu’il sait faire, à l’économie sociale ce qu’elle sait faire, sans autre contrôle que celui, organique, de ses sociétaires. Et rappelons que l’économie sociale relève pour une part des activités de marché, mais qu’elle y apporte un supplément de solidarité, et que pour son autre part elle couvre la quasi-totalité du secteur non marchand privé. De la diversité, donc, et surtout de l’unité, choses que les services de l’État n’ont jamais réellement comprises.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
- Fractures sociales et économie sociale (15/07)
- Potence pour l’ennemi public : l’huile de palme ! (01/07)
- Sur une résurrection : le train de la réunification franco-suisse en marche (24/06)
- Inclusif, décent et durable : le Travail nouveau est-il arrivé ? (17/06)
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, notamment en lien avec l’ESS.

































