
« Annele Balthasar » de Nathan Katz : un chant d’amour au tribunal des maléfices

Annele Balthasar est le chef-d’œuvre du grand poète alsacien Nathan Katz (1892-1981), qui fut l’ami d’autres grands poètes tels que Guillevic et Jean-Paul de Dadelsen. Les éditions Arfuyen le rééditent aujourd’hui accompagné de textes liminaires qui en éclairent l’origine personnelle et historique.
Paru en 1924, ce poème dramatique écrit en alémanique, que l’auteur définit comme un « poème populaire » et comme un « chant populaire dialogué », est surtout un « chant d’amour » rendant hommage à la douceur de sa terre, le Sundgau ou comté du Sud situé à l’extrême sud de l’Alsace, aux confins de l’Allemagne (Fribourg-en-Brisgau) et de la Suisse (Bâle). C’est dans une manière élégiaque et parfois mélancolique que cette douceur est dite tout au long de ce chant dialogué qui se présente formellement comme une pièce de théâtre.
Acquittée mais rendue folle par le tribunal des maléfices
Mais ce chant d’amour est aussi celui d’Annele Balthasar et de Doni, fils du maire de Willer, promis l’un à l’autre dans, pour reprendre Rimbaud (“Matinée d’ivresse”), un « très pur amour », mais prématurément et cruellement séparés par la mort d’Annele. Car le chant d’amour se déploie, de façon paradoxale et contrastée, sur un grand fond de douleur, plongeant son motif et sa trame dans l’une des périodes les plus sombres de l’histoire alsacienne, celle de la Grande Chasse aux sorcières qui, du début du quinzième siècle (bien avant la possession de Loudun, 1630, et les sorcières de Salem, 1692) au début du dix-huitième, fit périr sur le bûcher des dizaines de milliers de femmes accusées de sorcellerie. C’est d’un fait historique que s’inspire Nathan Katz, le procès d’Annele Balthasar de Willer qui eut lieu en 1589 à Altkirch.
La pièce en acquiert une dimension tragique, montrant comment une religion dégradée en superstition, une justice pervertie en vengeance et châtiment, peuvent mener aux procès les plus iniques et les plus meurtriers. Nathan Katz sait montrer, de façon simple et comme déjà miséricordieuse et lumineuse, sans outrances ni grandiloquence (la représentation de la superstition suffisant elle-même à en manifester l’erreur), la justice et la religion devenues folles.
Folie contagieuse qui va emporter Annele Balthasar car, bien qu’acquittée, elle meurt sitôt le procès achevé, tant celui-ci, et les tortures qui l’ont probablement précédé, l’ont affaiblie et lui ont fait perdre la raison. Pourtant, son amant, Doni, dont l’immense douleur n’a pas éteint l’espérance, entrevoit à la fin de la pièce la promesse d’un lieu, d’une « petite parcelle du monde » où leur amour fleurira vraiment et durera, éternel, inaltérable. C’est que, pour Nathan Katz, l’amour est fort comme la mort, et même : l’amour passe la mort.
Aux origines de la grande chasse aux sorcières
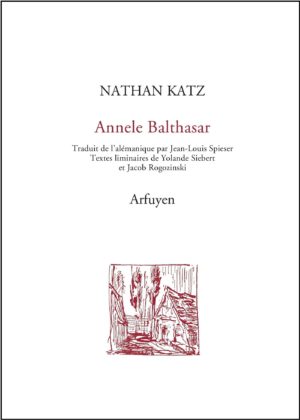 L’un des premiers mérites de la pièce est de décrire le climat de suspicion généralisée, de délation et de terreur qui régna en Alsace et dans le Saint-Empire germanique durant les trois siècles que dura la grande chasse aux sorcières, dont « l’apogée » sera atteinte aux seizième et dix-septième siècles.
L’un des premiers mérites de la pièce est de décrire le climat de suspicion généralisée, de délation et de terreur qui régna en Alsace et dans le Saint-Empire germanique durant les trois siècles que dura la grande chasse aux sorcières, dont « l’apogée » sera atteinte aux seizième et dix-septième siècles.
Le texte liminaire de Jacob Rogozinski indique que la dernière exécution d’une « sorcière » eut lieu en Suisse en 1782. Il précise également que la poursuite des « sectes sataniques » a trouvé son fondement religieux, sa justification et sa promotion dans plusieurs traités de démonologie dont le Marteau des sorcières publié en 1487 à Strasbourg, qui fit longtemps autorité et servit de référence lors des procès. Les divers méfaits et travestissements des démons y sont décrits ainsi que les assemblées, souvent nocturnes, auxquelles participent les sorcières, assemblées au cours desquelles, selon le traité, elles copulent avec des démons, profanent les sacrements chrétiens et sacrifient des enfants à Satan. Ces assemblées sont appelées « sabbats », terme issu de l’hébreu “shabbat” qui, comme chacun sait, désigne la journée sainte consacrée à Dieu en mémoire du (septième) Jour de son repos. Cette curieuse confusion du jour saint juif et des assemblées démoniaques manifeste l’assimilation courante au Moyen-Âge, et même durant la Renaissance, entre les sorciers et les Juifs, accusés de pratiquer la magie noire, de commettre des meurtres rituels et d’adorer le diable. On peut d’ailleurs trouver les traces d’une telle diabolisation dans le personnage shakespearien de Shylock (Le Marchand de Venise). Dans son livre L’Autre dans la conscience juive, Emmanuel Levinas évoque ainsi de façon ironique et amère « ceux qui appelèrent délicatement Shabbat les rendez-vous des sorcières ! ».
Comme le souligne Jacob Rogozinski, toute cette démonologie permit pendant longtemps de répondre au besoin des hommes de trouver des coupables aux diverses calamités personnelles ou naturelles qui les frappaient : orages de grêles détruisant les récoltes, épidémies diverses, décès prématurés des enfants. Les tribunaux, y compris les tribunaux civils (comme l’est celui d’Altkirch dans Annele Balthasar), souvent saisis par voie de délation et menant une enquête qui faisait une large part à la « question » (c’est-à-dire la torture comme technique d’enquête judiciaire), trouvaient aisément des preuves de culpabilité : avoir recraché un morceau d’hostie après la communion, bégayé en récitant ses prières ou s’être signé de la main gauche suffisaient pour établir la « qualité » de sorcière, car, dans l’immense majorité des cas, ce sont des femmes qui furent convaincues de sorcellerie. Ces tribunaux, appelés « tribunaux des maléfices » (Malefizgricht : l’alémanique élude le e du mot allemand Gericht), pratiquaient donc des « techniques judiciaires » que l’on retrouvera dans les procès politiques comme les procès de Moscou : instruction à charge, absence d’avocat et « religion de l’aveu » (on parlera sous l’époque stalinienne de « confession », ce qui inspirera fortement Orwell dans 1984), un aveu souvent obtenu par la torture. L’on peut retrouver aujourd’hui les deux premiers éléments dans certains « procès » intentés par les médias et les réseaux sociaux…
Une « justice » délirante
L’émotion suscitée par la représentation du procès d’Annele Balthasar tire en grande partie sa force du contraste manifesté entre, d’un côté, la douceur et l’innocence résignée de la jeune femme et, de l’autre, les accusations proprement délirantes portées contre elle. L’acte d’accusation indique ainsi qu’elle a conclu un pacte avec le diable et « reconnaît avoir empoisonné une étable… fait du mal à un enfant dans son berceau (qui) a agonisé pendant quatre semaines… avoir renié Dieu et les saints et avoir pris part, de nuit, aux danses obscènes des sorcières ». Bien entendu, rien de tout cela n’est vrai, et Nathan Katz le suggère de façon éloquente en énonçant ces accusations à l’encontre d’une jeune femme dont il a auparavant représenté toute la pureté « courtoise », mais tout a été avoué, sous la torture, par l’intéressée.
C’est que, pour tous, pour les accusateurs et les juges comme pour tout le peuple, prévaut la religion de l’aveu : ce qui est avoué est forcément vrai. Une paysanne déclare ainsi à propos d’une jeune fille de quinze ans brûlée comme sorcière :
« Tous les gens auraient dit que c’était l’âme la plus pure du village. Même à un petit animal elle n’aurait fait de mal. Mon Dieu ! Tout ce qu’elle a pourtant reconnu devant le tribunal !… Je me souviens de l’agitation du bétail la nuit… Devant le tribunal, elle a bien reconnu avoir ensorcelé notre maison à la demande du malin. Et pendant ce temps, elle se faisait passer pour une sainte. »
C’est le personnage de Doni qui dénonce avec le plus de force et de hauteur cette justice délirante qui, voulant traquer les possédés, voit le mal partout, au point de se confondre avec lui et de devenir elle-même possédée. Son discours adressé, après la mort d’Annele, à toutes les personnes présentes au procès est l’un des sommets de la pièce, tant il énonce clairement la perversion (et l’inversion) de cette justice délirante ainsi que le dévoiement de la foi qui la sous-tend :
« Vous avez imaginé des horreurs : sorcellerie… possession par l’esprit malin. C’est vous qui êtes tous possédés, tous, par un esprit mauvais… à tel point que le soleil voudrait s’éteindre !… Vous avez trouvé des mots atroces : droit !… justice divine !… De tous les cimetières s’élève un cri contre votre justice ! Vous élaborez dans vos têtes des milliers et des milliers de choses savantes, et malgré cela, vous ne savez pas au juste ce que vous voulez et dans tout ennemi de vos croyances, vous voyez un ennemi de Dieu… Et vous ne savez même pas que Dieu, vous l’avez perdu ! Plus vous le cherchiez, plus vous aviez son nom à la bouche, plus vous le perdiez dans vos cœurs. »
Ambiguïté de la folie
Habilement, car cela conduit un temps le lecteur à la croire coupable et à penser qu’elle sera certainement condamnée, Nathan Katz place dans la bouche d’Annele Balthasar un discours équivoque, une folie ambiguë dont on peut penser qu’elle est une réponse à la folie de son accusation et à la douleur de la torture, une séquelle de celles-ci. Car Annele dit tout à la fois sa rencontre avec Dieu dans la douceur de la nature alsacienne (« Le Bon Dieu passe dans nos vergers. Père, on l’entend bien lorsqu’il passe : plus un rameau ne bouge aux arbres… Quel silence dans les vergers »), la crainte du diable rôdant autour de sa maison la nuit et les sabbats, littéralement, endiablés auxquels elle participe :
« Nous avons chevauché dans la nuit… sorties par la cheminée… sur un manche à balai !… nous avons dansé autour du gibet… Quelqu’un est en train de mourir !… Au clair de lune… les sorcières ! … Le malin… Il est tout habillé de rouge… Elles dansent nues… »
Il semble que le délire d’Annele soit la seule réponse qu’une âme naïve, innocente et pure mais affaiblie puisse faire à la folie d’une justice savante et délirante égarée dans la défense meurtrière d’une foi pervertie : car si Annele, acquittée, ne périt pas sur le bûcher, elle meurt néanmoins, follement épuisée, du procès inique qui lui a été fait.
Un long poème d’amour
Mais Annele Balthasar est aussi un long poème d’amour. Cet amour est avant tout, bien sûr, celui qui unit Annele à Doni, un amour qui, dans sa profondeur et son intimité en même temps que dans sa simplicité, atteint une dimension, une douceur et une vérité, cosmiques. Attendant son promis, Annele dit ainsi :
« Je voudrais être assise en silence à côté de lui et ne rien faire d’autre que regarder la nuit descendre autour de nous. Regarder se fondre en un tout les images saintes au mur, les fleurs à la fenêtre, l’armoire et la couche… Ah ! Quand le silence se fait dehors dans les rues… »
Ce « regarder la nuit descendre autour de nous » dit de façon magnifique l’intimité amoureuse. La réponse de Doni est aussi belle :
« Il doit y avoir une vie plus élevée !… Quelque chose qui tiendrait du dernier éclat de la floraison dans nos vergers… être uni à quelque chose qui n’est qu’âme… dans un grand amour. »
C’est qu’Annele Balthasar est aussi le chant d’amour offert par Nathan Katz à son Sundgau doux et fertile : en faisant se déployer la tragique histoire d’Annele sur le fond de ses profonds vergers, le poète semble demander à la nature alsacienne de conserver la mémoire de ce procès fatal et de cette sombre époque mais aussi, en quelque sorte, de les fondre et convertir en sa douceur quasi-miséricordieuse.
Nathan Katz, Annele Balthasar, trad. Jean-Louis Spieser, Arfuyen, 2018, 200 pages, 18 €.

































