
Au revoir Monsieur Socrate
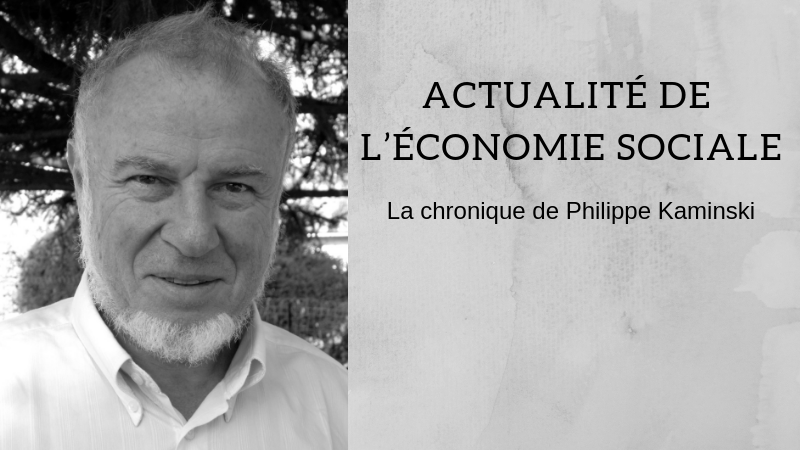
À l’occasion de la mort du haut fonctionnaire Jacques Fournier, petit retour sur l’aventure du CIRIEC, de l’économie collective et du service public, à la lumière de l’économie sociale.
Actualité de l’économie sociale
Nous avons appris, en cet été 2021, le décès de Jacques Fournier. Les nécrologies ne contenaient que des éloges convenus, grand serviteur de l’État, homme d’écoute et de dialogue, défenseur du service public. Rien qui concerne l’Économie Sociale… et pour cause ! Il portait tous les titres pour s’en revendiquer, et ne s’est jamais donné la peine d’aller la découvrir.
Il faut d’abord dire quelques mots de cette curieuse chimère qu’est le CIRIEC, dont la section française a récemment passé ses 70 ans. Et remonter jusqu’à son fondateur Edgard Milhaud, ce qui nous plonge dans un passé lointain et nébuleux.
Né en 1873 à Nîmes, ce qui fait penser à Charles Gide, Edgard Milhaud s’engagea très jeune dans le combat socialiste, pour ne plus le quitter jusqu’à sa disparition en 1964. Ce sont ses rares biographies qui emploient le mot socialisme, que l’on lit avec son sens actuel, alors qu’il faudrait plutôt évoquer le collectivisme, terme qui fut souvent utilisé par Jean Jaurès. Très jeune également, il alla s’installer à Genève, et cette fois nous pensons naturellement à Jean-Jacques. Il nous est difficile de cerner sa personnalité, faute de témoignages directs (du moins n’en ai-je jamais trouvés) ; à tenter de lire entre les lignes de ce dont nous disposons, c’est-à-dire quelques résumés hagiographiques de circonstance, il m’apparaît comme quelqu’un qui a tout tenté, en politique, dans le syndicalisme, dans la littérature, par tous les moyens, sans jamais réussir à s’imposer au premier plan. Je ne sais ce que Charles Gide ou Jean Jaurès pensaient réellement de lui.
Par la force des choses, Edgard Milhaud mena donc sa carrière en solitaire, hors des sentiers de gloire de la Politique et de l’Université. Après la Grande Guerre, la fondation à Genève de la Société des nations et surtout du Bureau international du travail lui permit d’asseoir sa situation et d’acquérir un statut d’éminence grise du pacifisme et du collectivisme à travers toute l’Europe.
Après la Libération, il se retrouva comme au temps de sa jeunesse, à l’écart des grands mouvements de recomposition du monde et de la pensée sociale. Mais il avait gardé de l’énergie et, à 74 ans, il réussit à fonder un mouvement international destiné à perpétuer ses idées et à continuer ses combats après sa disparition. C’est ainsi que naquit le CIRIEC, lieu se voulant autant d’influence que de recherche, associant pour ce faire politiques et universitaires. Et son fondateur survécut encore 17 ans à la création de ce qui était son testament.
Le CIRIEC existe toujours, et Edgard Milhaud y est momifié comme Henry Dunant peut l’être à la Croix Rouge : une divinité tutélaire dont personne ne cherche à retracer la vie ni à étudier les écrits. Il ne reste de lui qu’un commandement, une direction à suivre : faire la promotion de l’économie collective, étant entendu que la perspective de voir celle-ci s’imposer partout sur le globe et y apporter pour toujours justice, paix et prospérité n’est plus guère de mise, même dans les motions finales de congrès.
Fort bien, mais qu’est-ce que l’économie collective ? Edgard Milhaud la concevait il y a plus d’un siècle comme un réseau de régies municipales et régionales assurant de façon à la fois décentralisée et monopolistique la fourniture de l’ensemble des services nécessaires à la vie des populations. Il voyait les coopératives comme une étape vers ce but à atteindre, mais simplement une étape appelée à disparaître le moment venu, une préfiguration, en quelque sorte une école du collectivisme, dont l’un des avantages est de former les administrateurs du futur système.
Le premier volet de ce credo aura inspiré les pays germaniques, où les sections nationales du CIRIEC regroupent les nombreuses régies urbaines qui y assurent les transports, la distribution de l’eau ou la gestion des déchets. Quant au second volet, il est bien clair qu’il n’a jamais été accepté par l’Alliance coopérative internationale (fondée en 1895) et qu’il est resté lettre morte.
La situation en France, où de grands monopoles d’État ont profondément marqué la société, ne peut se comparer à celle de l’Allemagne. La section française du CIRIEC, grâce à des contributions généreuses venant notamment d’EDF et de la SNCF, pouvait vivre confortablement sans chercher à évangéliser de nouveaux territoires. Elle fut préemptée par le syndicat FO qui s’y installa en terrain conquis.
Le CIRIEC connut des hauts et des bas, mais il existait depuis longtemps déjà quand apparut l’Économie Sociale, d’abord en France (le mot y fut introduit en 1977, officialisé en 1982). La section française explicita alors « économie collective », les deux dernières lettres de l’acronyme CIRIEC, par « économie publique, sociale et coopérative ». Les choses auraient pu en rester là, l’économie publique y figurant le cheval, et les coopératives l’alouette. Mais l’Économie Sociale gagna rapidement d’autres pays, particulièrement l’Espagne et le Québec. Il se trouve que dans ces deux cas, il existait une section CIRIEC peu peuplée, et l’Économie Sociale choisit de l’investir et d’en faire son principal instrument de visibilité.
Cela modifia considérablement le centre de gravité du CIRIEC international. L’économie publique et l’Économie Sociale y cohabitaient désormais à forces comparables. Sa structure confédérale permit à l’ensemble d’éviter l’éclatement, les sections nationales étant soit tout l’une, soit tout l’autre. Seule la section française aurait pu parvenir à un équilibre ; celui-ci a peut-être été obtenu, mais longtemps après et en mode bien dégradé, car FO avait des intérêts qui n’allaient pas en ce sens. C’est là que Jacques Fournier aurait pu intervenir, mais il n’avait aucune inclination à le faire.
*
Venons-en donc à notre défunt. Après avoir rempli ses mandats à la tête de Gaz de France, puis de la SNCF, Jacques Fournier prit sa retraite et se consacra presque exclusivement à la présidence du CIRIEC, tant français qu’international. Son attachement à l’économie publique, entendue comme réunion de monopoles d’entreprises d’État, toutes vertueuses et dévouées à l’intérêt général, était quasiment mystique. Et pour ce qui est de l’Économie Sociale, il était entièrement dans la ligne d’Edgard Milhaud ; ce ne pouvait être que bourgeons sympathiques, symptômes de l’insatisfaction du peuple vis-à-vis du capitalisme, et annonciateurs d’un avenir radieux parce que collectiviste.
Sa mission était toute tracée : la SNCF idéale dont il n’avait pu que rêver, il allait en préparer l’avènement, étendu à toutes les autres branches d’activité. Face à ce défi prométhéen, il n’y avait guère de place pour les escarmouches d’échelle villageoise, et l’Économie Sociale en était, sans qu’il soit besoin d’argumenter davantage. Alors certes, elle faisait partie du contenu de son escarcelle ; mais c’était à lui, en toute lucidité bien comprise, d’en faire le tri et de distinguer l’essentiel de l’accessoire.
Je lis que Jacques Fournier était un homme chaleureux, bon négociateur et d’accès facile. Mais qui a émis cette opinion, copiée-collée à l’unisson ? Pour ma part je n’ai le souvenir que d’un grand bourgeois hautain (servi en cela par sa grande taille), perdu dans ses nuées, généreux en paroles et procédurier en actes.
Il était socialiste jusqu’au bout des ongles, et de son passage au secrétariat général de l’Élysée, il avait gardé une vénération sans nuance pour François Mitterrand. Tout ce qui pouvait avoir l’air rocardien éveillait chez lui méfiance et circonspection. L’Économie Sociale ne pouvait que pâtir de ce type de préjugé.
Il aurait commencé sa vie politique par le CERES. Il faudrait savoir combien de temps il y est resté et le rôle qu’il a pu y jouer ; cela ne laissait pas de m’étonner, car ses penchants europhiles, voire eurofanatiques, n’avaient rien de chevènementiste. Lors du référendum de 2005, il exhortait tout un chacun à voter pour la constitution européenne, rencontrant autour de lui un scepticisme qu’il n’arrivait pas à comprendre. J’ai su plus tard, par une confidence privée de Marc Blondel, que le bureau confédéral de FO avait choisi de faire voter NON, mais de n’en rien laisser paraître en public.
Jacques Fournier aurait pu être désarçonné par le parti-pris bruxellois en faveur de la concurrence et du démantèlement des monopoles nationaux. Mais il était tellement persuadé d’avoir raison que ces contradictions ne l’effleuraient pas. Il voulait à la fois plus d’Europe et plus de nationalisations. Pour avoir les deux, il lui suffirait de convaincre, et il s’y employait, du matin au soir et du soir au matin. Avec des résultats pour le moins mitigés.
*
Les animateurs du CIRIEC voyageaient beaucoup. Congrès et symposiums remplissaient leurs agendas. Mais aucun d’entre eux ne semblait avoir pu, ne serait-ce qu’une seule fois, subir les affres de ce qui faisait le douloureux quotidien de l’usager de base de la SNCF. Moi, si, et plus souvent qu’à mon tour. Celui que j’appelais en mon for intérieur Monsieur Socrate n’avait jamais été interpellé, du moins en ma présence, par un membre de son Bureau au sujet de cet épisode calamiteux de la « modernisation » de notre système ferroviaire.
Alors que l’informatique était encore balbutiante, que les réseaux de transmission de données étaient à l’âge de pierre, la SNCF décida d’acheter en Amérique un logiciel de réservation de billets d’avion et de l’imposer aux utilisateurs des TGV, puis des autres trajets grandes lignes. Les équipements n’étaient pas au point, le personnel n’était pas formé, le système ignorait certaines gares, et les prix connaissaient des hausses aléatoires, parfois conséquentes. Le désastre était total !
En dehors de colossales pertes de temps et de vives crises de nerfs, je suis certain que Socrate a précipité certaines démissions, certains divorces, voire certains suicides. À l’époque, nul n’aurait songé à en rendre Jacques Fournier responsable ; après tout, il était sous l’autorité d’un ministre, et il avait autour de lui, lui le seul énarque de l’entreprise, toute une brochette de polytechniciens intouchables qui n’en faisaient qu’à leur tête. Malgré tout, cela ne l’exonère en rien, car il ne montra, ni pendant la crise ni après, aucune empathie envers les milliers d’usagers captifs du rail qui ont été victimes des graves dysfonctionnements de Socrate.
Il y a eu, depuis, bien d’autres « grands projets informatiques » du secteur public qui se sont plantés. Avec des dommages collatéraux souvent considérables. On n’en tire pas toujours les leçons, mais je veux bien comprendre que si la critique est aisée, l’art est difficile…
C’est pourquoi en cette matière l’humilité est essentielle. Défendre les services publics, jusqu’à s’en faire une religion, c’est bien beau. Mais conserver sa morgue et sa suffisance ne l’est guère.
Au revoir, Monsieur Socrate.
.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– La francophonie des affaires, enfin ?
– Brèves estivales (seconde semaine)
– Brèves estivales
– Contre l’isomorphisme climato-correct
.
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.

































