
Histoires de délivrances
Dans son nouveau roman, Rompre les digues, paru aux éditions Philippe Rey, Emmanuelle Pirotte s’attache à définir les exils, qu’ils soient géographiques ou intérieurs. Elle nous plonge au plus profond de l’âme humaine dans ce qu’elle peut avoir de plus trouble comme de plus lumineux. Sa plume allie le piquant au tendre pour nous montrer qu’il est possible de ne pas sombrer dans un monde qui fait naufrage.
Renaud de Jaeger vit à Ostende, la ville de James Ensor, peintre des masques et de la mort, et Renaud porte tant de masques, se saborde d’alcool et de drogues, le cœur devenu cynique. Il est le fils unique d’une famille aristocratique. Sa mère, « blonde héritière de la famille Vanspiegelaar de Courtrai, propriétaire d’un groupe pharmaceutique, une des familles les plus riches de Belgique », l’a mis au monde pour ne plus s’en occuper ensuite, toute dévouée à ses amies, ses voyages, son yoga, son développement personnel, son shopping – « C’était une femme idiote et creuse, et la simple réalité de son passage sur terre questionnait douloureusement le sens de la vie humaine. »
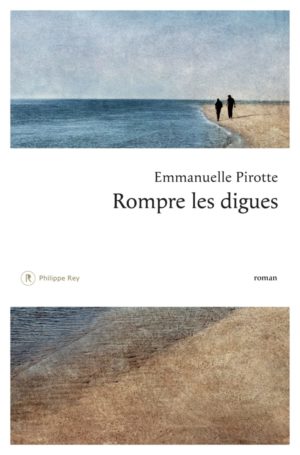 Son père était « une figure encore plus consternante et fantomatique ; ses rares moments de présence généraient une atmosphère de tension insoutenable. L’homme ne vivait que par l’intermédiaire du téléphone, du fax qui turbinait à plein régime dans un grésillement poussif, de divers journaux qui l’informaient des fluctuations de la bourse […] Rien ni personne n’avait le pouvoir de susciter son intérêt autant que ces trois choses […] Le père de Renaud était un avant-gardiste de la connexion, une saisissante préfiguration de l’homme du XXIe siècle […] il avait hérité d’une grosse fortune qui prospérait grâce à une équipe de financiers et d’avocats redoutables. » Le charmant couple, dévoré par une pressante envie de se débarrasser de leur fils, l’envoie à treize ans dans un pensionnat de l’île de Man, morceau de terre désolé et noyé de pluies que Renaud ne sait même pas situer sur une carte. Il s’enfuit après deux ans et supplie ses parents de le laisser rentrer à Bruxelles, déchirant cri de souffrance qui n’est pas entendu – « Crois-tu que ta mère et moi avons envie de tomber malades à cause de toi ? Les gens de ton espèce donnent des cancers. » Et puis, la meilleure éducation est anglaise ! Renaud entre donc à la King’s School de Canterbury, proche de la demeure de sa tante Clarisse, la sœur de son père avec laquelle ce dernier ne s’est jamais entendu. Clarisse, qui écoute Bowie et les Clash mais vit comme dans un roman de Dickens, devient son phare ; elle repousse les ténèbres qui entourent Renaud et font naître en lui des pulsions de mort
Son père était « une figure encore plus consternante et fantomatique ; ses rares moments de présence généraient une atmosphère de tension insoutenable. L’homme ne vivait que par l’intermédiaire du téléphone, du fax qui turbinait à plein régime dans un grésillement poussif, de divers journaux qui l’informaient des fluctuations de la bourse […] Rien ni personne n’avait le pouvoir de susciter son intérêt autant que ces trois choses […] Le père de Renaud était un avant-gardiste de la connexion, une saisissante préfiguration de l’homme du XXIe siècle […] il avait hérité d’une grosse fortune qui prospérait grâce à une équipe de financiers et d’avocats redoutables. » Le charmant couple, dévoré par une pressante envie de se débarrasser de leur fils, l’envoie à treize ans dans un pensionnat de l’île de Man, morceau de terre désolé et noyé de pluies que Renaud ne sait même pas situer sur une carte. Il s’enfuit après deux ans et supplie ses parents de le laisser rentrer à Bruxelles, déchirant cri de souffrance qui n’est pas entendu – « Crois-tu que ta mère et moi avons envie de tomber malades à cause de toi ? Les gens de ton espèce donnent des cancers. » Et puis, la meilleure éducation est anglaise ! Renaud entre donc à la King’s School de Canterbury, proche de la demeure de sa tante Clarisse, la sœur de son père avec laquelle ce dernier ne s’est jamais entendu. Clarisse, qui écoute Bowie et les Clash mais vit comme dans un roman de Dickens, devient son phare ; elle repousse les ténèbres qui entourent Renaud et font naître en lui des pulsions de mort
Renaud, flanqué de diplômes d’histoire et de philosophie qui ne lui ont servi à rien, vit de ses rentes, oisif, triste et las, prisonnier de son mal de vivre. À l’âge de vingt ans, il a tenté le geste hautement romanesque d’un suicide aux barbituriques, empêché dans sa réussite certaine par l’intervention inopinée, proprement miraculeuse, de sa mère. Aujourd’hui, l’acte qui ne possède plus l’aura de sublime dont il se parait alors ne serait que pathétique.
« À quarante-huit ans, on peut juste envisager de s’en aller lentement à petites doses d’alcool, de tabac, de cocaïne et d’amphétamines, de nuits sans sommeil. Comme ça, l’air de rien, l’air de succomber un peu malgré soi, de subir. Sans panache. »
Las ! Son corps résiste.
Quand Angèle, la domestique qui semble être dans la famille depuis la nuit des temps, meurt, Renaud perd avec elle sa plus puissante raison de rester en vie ; Angèle était sa blessure secrète, celle qui nourrissait sa haine féroce et vitale. Il l’avait surnommée « Staline » parce que, quand il avait sept ans, elle l’avait enfermé des heures à la cave pour avoir laissé entrer un chaton à la cuisine.
« Son cœur blessé d’enfant instruit avait quand même préféré Staline à Hitler. Il aurait pu choisir Franco, car Angèle et le tyran étaient de la même race de bouffeurs de paëlla, de joueurs de castagnettes et de sacrificateurs de taureaux. Mais Franco ne lui semblait pas assez cruel pour soutenir la comparaison avec la bonne. »
Il lui faut remplacer Angèle. C’est de François Loiseau, son ami d’enfance, que vient la solution ; François, qui est le fils de la cuisinière qui travaillait pour la famille de Jaeger et pour lequel il eut un véritable coup de foudre amical, au grand dam de sa mère ; François, licencié de la société d’assurances qui l’employait sous le prétexte de restructuration, en vérité parce qu’il était devenu incapable de rien après la mort de son épouse adorée ; François, expulsé du chômage en raison de sa léthargie ; François qui tombe amoureux de celle qui l’a rayé de la liste des bénéficiaires d’allocations. François donc, pourvoyeur d’une solution qui apportera à Renaud bien plus que de simples coups de chiffon en lui présentant Teodora Paz, femme à tout faire dont sa belle-sœur ne veut plus depuis que la tentative de suicide de Teodora est venue entacher son luxueux paysage.
Teodora a fui le San Salvador et la violence du gang dont elle faisait partie, abandonnant Alma, la niña née d’un viol. Refusant de subir, elle a « préféré donner son âme au diable plutôt que de perdre toute dignité. Elle a préféré la destruction, la violence et le néant à une existence d’agneau sacrifié. Elle avait seize ans. » Renaud est dérouté par la jeune femme hautaine et orgueilleuse, « extraordinairement présente dans son opacité », ne donnant accès à rien. Il ne trouve « rien de doux dans ce visage, seulement des arêtes vives, des droites, des diagonales. C’est une peinture cubiste, un visage humain revu par Braque ou Juan Gris ». Il aimerait engager la conversation mais il se dégonfle, tétanisé « devant son aspect de forteresse imprenable, devant son repli furieux ». Alors il lui invente un destin tragique, fantasme sa vie, comme il le fait avec toutes les personnes de son entourage.
« Renaud pensa à tous les êtres qui peuplaient sa vie, qu’il habillait de costumes qui n’étaient pas les leurs, emprisonnait dans des contes inventés par lui seul, à partir de ses propres désirs, de petites tranches de leurs vies, de leurs manies, de leurs faiblesses et, plus rarement, de ce qui était capable de l’émouvoir en eux […] il était incapable de considérer les autres autrement que comme des objets dans son paysage, des pions sur l’échiquier tronqué de son existence. »
La farouche Teodora vient changer la donne et bousculer sa vision du monde, ébranler le scorpion qu’il est, qui « détruisait ce qu’il aimait, ce qui le rendait meilleur, et se détruisait par la même occasion ». Renaud est, aux yeux de Teodora qui vient pourtant des enfers, ce qu’elle a observé « de plus énigmatique et de plus désespéré en matière d’être humain ». Elle ne sait pas s’il l’agace ou s’il lui fait pitié. Chez lui, elle redécouvre la lenteur des heures, un rythme ancien oublié, l’absence d’urgence. Elle se défait des souvenirs cauchemardesques et s’autorise à être elle-même, refusant d’être un animal de cirque, « la brave ‘chica’ inculte qui se glisse dans la peau d’une Blanche, parce que c’est le seul modèle acceptable, la seule voie souhaitable, le grand rêve de tout habitant de cette planète qui n’est pas né avec un visage pâle ». Elle et Renaud ont plus en commun qu’ils ne le pensent.
« Teodora et Renaud étaient prisonniers d’une solitude abyssale. Ils partageaient un sort identique face à la nécessité de vivre, une sorte de fatalité, comme si un dieu antique les avait punis en les condamnant à une forme d’exil permanent, hors d’eux-mêmes et du monde. »
En eux sommeillent des monstres dont ils peuvent se libérer l’un l’autre.
Dans la bulle de Renaud gravitent des personnages bienveillants, mains tendues qui lui donnent l’occasion de voir la vie sous un angle différent. Il y a Tarik, rencontré un soir de perdition, Tarik l’ange gardien.
« Tarik aurait dû être son père. Un père adoptif, jeune, vif, et de surcroît parfaitement clean. Car Renaud avait immédiatement su que Tarik n’était pas un camé. Il veillait, c’est tout. Ce gars était un guide pour la vie, une épaule sur laquelle se reposer, un pourvoyeur de lucidité et d’oubli. Tarik, son nouveau “best friend”. »
Il y a Brigitte qui passe sa vie à s’occuper de migrants, suscitant la colère de sa fille Juliette qui lui reproche ses dépenses. Brigitte a une foi inébranlable dans le vivre-ensemble et reste consciente que ses actions la menacent de la prison. Brigitte, à « la vie bancale de préménopausée anxieuse », héberge Habtamu, un Érythréen qui partage son lit et qu’elle redoute de voir partir.
« Il y a cette terre d’asile, là-bas, cette terre promise, et tout ce que vous pouvez leur offrir, votre toit, votre argent, votre lit, vos cinquante ans chargés de pauvres rêves et gorgés d’amour inexprimé ne peuvent rivaliser avec les promesses de cet ailleurs fantasmé. »
Emmanuelle Pirotte est historienne et scénariste, ce qui se ressent à la lecture de ses romans. Elle a le talent de mener son intrigue en séquences fluides qui évitent d’ennuyer le lecteur, le régalant d’un humour fin et piquant. Sa plume est acérée et ronde à la fois, une petite musique séduisante diablement efficace. Elle nous parle d’exils, géographiques et intérieurs, ceux qui nous font nous perdre à nous-mêmes et nous transforment en fauves ; des événements qui viennent bousculer le connu et nous font sortir de notre zone de confort, mélodie du hasard ; de la différence et de l’indifférence, celle envers les échoués qui possèdent parfois un don pour la vie plus intense ; de la compassion et de la valeur inestimable d’une main tendue avant le naufrage ; de notre besoin de croire, de penser et de ressentir en contrepoint de tout ce que nous ne pouvons mesurer. L’auteure a ceci de particulier qu’elle aime les fins heureuses, toujours – et pourquoi pas –, et elle évite le mièvre en leur insufflant une profonde humanité, mettant en lumière le pouvoir que nous donne la possibilité que nous avons de choisir. Il suffit d’oser rompre les digues – qu’elles soient sociales, culturelles, familiales, émotionnelles -, briser les barrières, néantiser les empêchements, envoyer valdinguer les contraintes, vaincre les séparations… se délivrer.
.
Emmanuelle Pirotte, Rompre les digues, Éditions Philippe Rey, 2021, 272 p., 20 €
.
Voir toutes nos critiques de livres

































