
La dérive néolibérale des politiques culturelles

Avec La langue retournée de la culture, Michel Simonot nous présente un court essai stimulant qui reprend l’évolution des politiques culturelles à travers la question terminologique. L’enjeu n’est rien de moins que la dépolitisation de la politique culturelle publique qu’entraîne chaque glissement de mots, de sens, de vision.
Sous la forme d’un dictionnaire critique, Michel Simonot analyse en sociologue – voire en sémiologue – le retournement du langage que subissent les politiques culturelles depuis une trentaine d’année, sous l’influence d’un libéralisme qui se cache de moins en moins – les programmes de deux candidats majeurs de l’élection présidentielle en cours, François Fillon et Emmanuel Macron, n’en sont-ils pas des signes patents ? En ce sens, Michel Simonot fait œuvre bénéfique.
Rien de mieux que l’histoire, pour retrouver le sens des choses, des mots. Une critique pourrait être opposé à l’auteur d’entrée de jeu : pourquoi commencer cette histoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Dans son préambule, Michel Simonot répond que « cette langue retournée est celle des politiques culturelles publiques : celle qui a pris naissance, en France, à la fin de la deuxième guerre mondiale et demeure toujours notre cadre fondateur. » S’il reconnaît que les politiques publiques, dans son sens le plus large, ont « une bien plus longue histoire », il réaffirme avec justesse que la politique culturelle est née avec la « décentralisation dramatique » d’après-guerre.
L’impossibilité du débat politique sur la culture…
 L’enjeu est dès lors de saisir comment le néolibéralisme a progressivement envahi la sphère artistique, au détriment du rôle de l’État, garant de cette politique culturelle. Cette approche, parfaitement légitime comme telle, appelle néanmoins une nuance distanciée : à aucun moment Michel Simonot ne remet en cause la vision même développée par l’État, du moins jusqu’aux années 1990. Nous avons comme l’impression de nous retrouver devant un âge d’or quelque peu fantasmé, qui s’étendrait – grossièrement – d’André Malraux à Jacques Lang.
L’enjeu est dès lors de saisir comment le néolibéralisme a progressivement envahi la sphère artistique, au détriment du rôle de l’État, garant de cette politique culturelle. Cette approche, parfaitement légitime comme telle, appelle néanmoins une nuance distanciée : à aucun moment Michel Simonot ne remet en cause la vision même développée par l’État, du moins jusqu’aux années 1990. Nous avons comme l’impression de nous retrouver devant un âge d’or quelque peu fantasmé, qui s’étendrait – grossièrement – d’André Malraux à Jacques Lang.
Or il apparaît assez clairement qu’une partie des Français ne se sont pas reconnus dans cette vision artistique et culturelle promue par l’État. Si Michel Simonot vante la liberté artistique défendue par l’État, d’autres reprochent que celle-ci ne fut réelle que pour une catégorie bien spécifique d’artistes, ceux inscrits dans une même ligne idéologique. Il ne s’agit pas ici de trancher le débat, autrement complexe, mais de remarquer que l’autocritique de cette période est totalement absente.
Si je soulève ici ce point, c’est au regard des importantes oppositions que nous avons décelées dans les différents projets culturels proposés par les candidats à la présidentielle, qui apparaissent comme une mauvaise cristallisation contemporaine de débats enracinés.
Nous ne saurions reprocher directement ce silence à l’auteur, dont le propos est tout autre. Pourquoi ? Parce que Michel Simonot serait probablement le premier à accepter la contradiction au sein d’un débat sur la politique culturelle, d’autant que lui et moi nous rejoignons sur les dangers d’un art dépendant du seul politique – les nazis en sont l’expression ultime. Le problème est que ce débat est devenu sinon impossible, du moins hypothétique, du fait de la prédominance économique qui rend toute vision politique secondaire. La néolibéralisation de notre société repose, non pas d’abord sur l’invasion de l’économie dans la culture, mais sur la démission du politique.
… du fait de la démission du politique lui-même
Au fur et à mesure des courts chapitres (une à trois pages), Michel Simonot souligne l’effondrement du rôle des arts et de la culture, réduit à la rentabilité de l’action sociale, par volonté politique : « Le temps artistique, le temps culturel sont asservis au temps politique », constate amèrement l’auteur. Il faut faire vite, pour l’image, pour des enjeux de communication ; il faut des projets, des moteurs visibles qui transforment le politique en une vaste dynamique sans racines ni horizon – une mécanique désespérément vide. La subvention artistique n’est dès lors plus qu’une condescendance d’un monde politique en manque d’image. L’analyse est d’une terrifiante précision :
« Dans un monde politique baigné de néolibéralisme (y compris sous des formes adoucies et colorées de préoccupations sociales), il est devenu difficile d’afficher un intérêt pour (et de communiquer sur) une rentabilité différée, donc, d’un effet dans le temps long. Il y a une autre raison à cela : le temps politique est celui, maintenant raccourci, des échéances électorales. »
Les résultats statistiques ont remplacé la création artistique : il faut faire société ; l’éducation devient prioritaire ; le remplissage des salles a supplanté les enjeux de fréquentation… Le seul art qui demeure est celui de la communication, au détriment du savoir-faire, de l’artiste-artisan. L’intérêt artistique s’incline devant la rentabilité sociale, le sacro-saint devoir de faire société, du vivre ensemble : « L’appréciation artistique devient seconde, voire secondaire, accessoire par rapport à son efficacité supposée dans la société. »
Une culture sans art
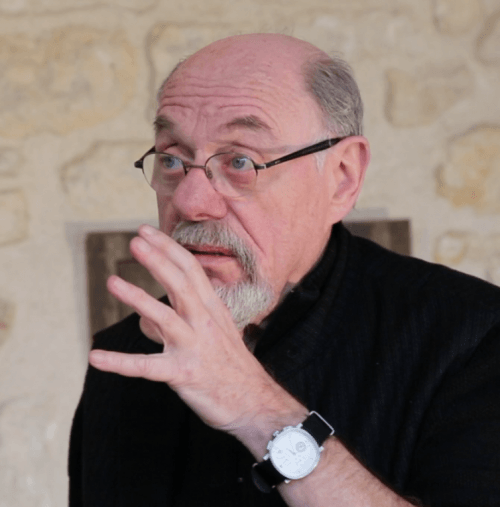 Michel Simonot conclut lapidairement : « Les politiques n’ont plus à s’y intéresser. » L’hégémonie néolibérale est synonyme de démission du politique. Le mot culture a tout envahi, sans que son sens soit clairement défini, au détriment de l’art. Comme l’écrivait Sylvain Métafiot dans une analyse éclairée par Pier Paolo Pasolini, publiée dans Profession Spectacle et amplement relayée sur internet : « La culture a tué l’art ! »
Michel Simonot conclut lapidairement : « Les politiques n’ont plus à s’y intéresser. » L’hégémonie néolibérale est synonyme de démission du politique. Le mot culture a tout envahi, sans que son sens soit clairement défini, au détriment de l’art. Comme l’écrivait Sylvain Métafiot dans une analyse éclairée par Pier Paolo Pasolini, publiée dans Profession Spectacle et amplement relayée sur internet : « La culture a tué l’art ! »
Le néolibéralisme a conduit à une nouvelle forme, plus insidieuse, d’utilitarisme. Le monde – y compris celui de la culture – s’est concentré sur l’ennemi totalitaire, rouge et brun, sans percevoir qu’une hydre non moins dangereuse, peut-être même davantage parce qu’au visage masqué, l’attaquait à revers, sur son flanc le plus vulnérable – celui où réside le porte-monnaie des citoyens. Et « c’est Mozart qu’on assassine », pour reprendre l’expression d’Antoine de Saint-Exupéry (Terre des hommes).
Michel Simonot ne dit pas autre chose lorsqu’il proclame la mort de l’œuvre, de la création, c’est-à-dire la mort de l’art, au nom de la culture :
« Dans les politiques publiques, on considère qu’un artiste ne fait plus d’œuvres, pas plus qu’il ne fait œuvre. Ce qu’il produit est considéré comme secondaire, voire accessoire, par rapport à ses effets, son utilité. Tout au plus fait-il des œuvres au pluriel, réduites à des productions instantanées, isolées, au sens de réalisations, indépendantes d’une démarche artistique et dont la valeur est mesurée à ses effets (politiques, médiatiques…) et sa rentabilité immédiate (symbolique, de notoriété, y compris financière pour le marché de l’art et les industrielles culturelles. »
La place de l’art dans la culture
Ce petit livre est précieux pour qui veut comprendre les glissements sémantiques qui habitent chacune des conversations relatives à l’art, à la création, à la culture. Il est réellement stimulant pour qui souhaiterait voir renaître des débats autour des politiques culturelles elles-mêmes, débats rendus impossibles – ou pour le moins inactuels – par la servile prosternation du politique devant l’économie.
Au terme de ce court dictionnaire, Michel Simonot a la bonne idée d’aborder la distinction – complètement oubliée – entre art et culture, telle une ressaisie des différents termes abordés à travers un angle de vue plus global, un regard de sagesse. Certaines lignes seraient à imprimer et à placarder en bien des lieux, tant elles rappellent des évidences. Nous ne résistons pas à lui céder une dernière fois la parole, au moment de conclure.
« Une culture qui inclut, c’est une culture qui inclut le débat, les confrontations, les construit, les nourrit, les rend productifs de relations d’intelligence. L’art en est partie prenante, au premier chef, comme la littérature, la philosophie, les connaissances. […]
L’art est quelque part dans la culture, mais il la met en crise. L’art est à un endroit qui permet à la culture de ne pas se figer dans un consensus, dans l’harmonie, qui la questionne, qui lui injecte de l’incertitude. Au politique également, donc. »
.
Michel SIMONOT, La langue retournée de la culture, Éditions Excès, Romainville, 2017, 109 p., 10 €
.

































